Résumé
Le 24 juin 2022, près de deux-mille personnes migrantes ont tenté de traverser la barrière-frontalière séparant la ville de Nador, au Nord du Maroc, de Melilla, enclave sous contrôle espagnol. La répression violente qui leur a été infligée par les forces de l’ordre marocaines et espagnoles a transformé le poste-frontière de Barrio Chino en piège mortel, et a abouti à un véritable charnier. Les autorités marocaines ont reconnu 23 décès, mais l’Association Marocaine des Droits Humains à Nador a dénombré au moins 27 personnes tuées lors de cette journée, et plus de 70 personnes demeurent disparues jusqu’à aujourd’hui. Que s’est-il passé le 24 juin 2022 ? Comment et par qui le poste frontière de Barrio Chino a-t-il été transformé en piège mortel ?
Pour répondre à ces questions, Border Forensics a enquêté pendant plus d’un an avec Irídia, l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) et d’autres acteurs de la société civile des deux côtés de la frontière. Par ailleurs, nous avons bénéficié des conseils complémentaires du Centre Européen pour les Droits Constitutionnels et Humains (ECCHR). En articulant notre analyse du massacre à travers différentes échelles spatiales et temporelles, nous avons tenté de comprendre non seulement l’enchainement des évènements et les pratiques des acteurs présents sur place le 24 juin 2022, mais également les conditions structurelles qui ont rendu ce massacre possible. Nous analysons aussi la violence qui a continué après le 24 juin à travers l’absence d’identification des morts et des disparus, l’impunité et l’acharnement judiciaire contre les personnes migrantes elles-mêmes.
Bien que des zones d’ombre subsistent, les faits que nous avons reconstitués en croisant de nombreux éléments de preuve sont accablants, tant pour les autorités marocaines et espagnoles que pour l’Union européenne qui les soutient politiquement et financièrement. Les autorités des deux côtés de la frontière doivent faire toute la lumière sur ce massacre, et enfin répondre aux demandes de vérité et de justice des victimes et de leurs familles.
Introduction
Le 24 juin 2022, près de deux-mille personnes migrantes ont tenté de traverser la barrière-frontalière séparant la ville de Nador, au Nord du Maroc, de Melilla, enclave sous contrôle espagnol. La répression violente qui leur a été infligée par les forces de l’ordre marocaines et espagnoles a transformé le poste-frontière de Barrio Chino en piège mortel, et a abouti à un véritable charnier. Les autorités marocaines ont reconnu 23 décès, mais l’Association Marocaine des Droits Humains à Nador a dénombré au moins 27 personnes tuées lors de cette journée, et plus de 70 personnes demeurent disparues jusqu’à aujourd’hui.
Malgré les nombreuses images filmées par différents acteurs et plusieurs rapports publiés par des instances officielles, des associations et des journalistes, de nombreuses zones d’ombre concernant le déroulement des évènements lors de cette journée persistent. En effet les autorités marocaines et espagnoles sont loin d’avoir fait toute la lumière sur les faits, et ont empêché les enquêtes indépendantes d’accéder à de nombreux éléments de preuve essentiels.
Comment ce déchaînement de violence a-t-il été possible ? Par quels actes spécifiques s’est-il matérialisé ? Qui en est responsable ? Comment et par qui le poste frontière de Barrio Chino a-t-il été transformé en piège mortel ?
Près de deux ans après les faits, ces questions n’ont jusqu’alors pas trouvé de réponse, et les demandes de vérité et de justice des survivants du massacre et des familles des morts et des disparus n’ont pas été entendues. Au contraire, au lieu d’utiliser les institutions judiciaires pour déterminer les responsables de ce massacre, le Maroc a utilisé son appareil judiciaire pour continuer la répression des survivants du massacre, dont plusieurs dizaines ont été condamnés à des peines de prisons pour sanctionner des actes de violence et d’autres délits allégués. Le procureur Espagnol n’a quant à lui pas conclu à la présence de preuves de violations, et a fermé son enquête. Par ailleurs, loin d’être démantelée, la barrière-frontalière a été renforcée et, bien que les traversées de la frontière aient diminué depuis le 24 juin 2022, le système de répression raciste à la frontière demeure inchangé.
C’est pour soutenir la demande de vérité et de justice des victimes du 24 juin 2022 et de leurs familles et afin de combattre ce régime d’impunité qui permet à la violence de la frontière d’être perpétuée que Border Forensics, en collaboration avec Irídia, l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) et d’autres acteurs de la société civile des deux côtés de la frontière, a mené une contre-enquête pendant plus d’un an, tout en bénéficiant des conseils complémentaires du Centre Européen pour les Droits Constitutionnels et Humains (ECCHR). Ensemble, nous avons constitué une équipe transdisciplinaire composée de membres d’associations de défense des droits humains, de journalistes, de chercheur·es spécialisé·es dans l’analyse critique des frontières des politiques migratoires et du racisme anti-Noir·es, mais aussi d’experts en reconstruction spatiale et visuelle, de statisticiens, d’architectes, et de réalisateurs de films documentaires.
En articulant notre analyse du massacre à travers différentes échelles spatiales et temporelles, nous avons tenté de comprendre non seulement l’enchainement des évènements et les pratiques des acteurs présents sur place le 24 juin 2022, mais également les conditions structurelles qui ont rendu ce massacre possible. Nous analysons aussi la violence qui a continué après le 24 juin à travers l’absence d’identification des morts et des disparus, l’impunité et l’acharnement judiciaire contre les personnes migrantes elles-mêmes.
Notre analyse démontre que les nombreux morts et disparus lors du massacre du 24 juin 2022 n’ont rien d’accidentel. Au contraire, les personnes migrantes ont été orientées à plusieurs reprises vers le poste-frontière de Barrio Chino, et violemment réprimées par les forces de l’ordre marocaines et espagnoles une fois piégées dans celui-ci. Mais le piège mortel dans lequel les personnes migrantes sont tombées va au-delà de l’architecture du poste-frontière ou de l’enchaînement d’événements survenus le 24 juin. Il a été tissé par des politiques et pratiques opérant dans un espace-temps étendu, incluant les politiques européennes et espagnoles d’externalisation de contrôle des migrations établies depuis plus de deux décennies, la diplomatie migratoire marocaine, l’impunité quant aux violences perpétrées aux cours de nombreuses années, ainsi que la répression raciste quotidienne déployée contre les personnes Noires dans la zone. Ce sont tous ces éléments qui, ensemble, ont formé un piège mortel, que les forces de l’ordre espagnoles et marocaines ont exécuté le 24 juin 2022.
Bien que des zones d’ombre subsistent, les faits que nous avons reconstitués en croisant de nombreux éléments de preuve sont accablants, tant pour les autorités marocaines et espagnoles que pour l’Union européenne qui les soutient politiquement et financièrement. Les autorités des deux côtés de la frontière doivent faire toute la lumière sur ce massacre, et enfin répondre aux demandes de vérité et de justice des victimes et de leurs familles.
Le massacre de Nador-Melilla est, de par le déchainement de violence directe, les actes de racisme et de deshumanisation extrême et le grand nombre de morts et de disparus, l’un des crimes les plus graves perpétrés dans le cadre de la gestion discriminatoire et militarisée des frontières européennes au cours des 30 dernières années. Cependant, au-delà de son caractère exceptionnel ce massacre exemplifie de manière exacerbée une tendance plus large à la brutalisation de la gestion des frontières et la normalisation des violations perpétrées au nom de leur « protection ». Ainsi, en documentant avec précision les évènements du 24 juin 2022 et en analysant les conditions qui les ont rendues possible, ce sont également ces tendances plus larges que nous cherchons à contester.
Plan du rapport
Afin de répondre à notre question principale « Comment et par qui le poste frontière de Barrio Chino a-t-il été transformé en piège mortel ? », nous avons déployé une analyse des politiques et pratiques de violence négrophobe en plusieurs chapitres, dont chacun restitue des temporalités et spatialités distinctes : (1) la longue durée de la colonialité et de la négrophobie à la frontière qui crée les conditions de possibilité du massacre; (2) la conjoncture particulière des rapports diplomatiques changeants entre le Maroc, l’Espagne et l’EU aux cours des mois précédant le 24 juin et les oscillations de la répression qui en ont résulté; (3) la journée du massacre, et (4) la violence dont les victimes du 24 juin continuent de faire l’objet près de deux ans après les faits.
Dans le chapitre 1, qui se fonde principalement sur la recherche doctorale d’Elsa Tyszler, le contexte historique, politique et répressif de la frontière Nador-Melilla est retracé. Replonger dans son histoire longue permet de révéler la dimension raciale et coloniale ancienne de cette frontière. L’analyse de l’évolution des législations, politiques et pratiques permet ensuite de saisir le caractère raciste de la répression anti-migratoire qui se met en place autour les enclaves de Ceuta et Melilla à partir des années 1990, puis à partir des années 2000 côté marocain. Nous montrons qu’au cours de cette période un consensus autour d’une figure Noire du danger migratoire émerge et se consolide de part et d’autre de la frontière maroco-espagnole. La répression spécifique ciblant les personnes dites « Subsahariennes » s’observe tant dans le harcèlement sécuritaire quotidien des personnes Noires dans la zone de Nador, que dans les pics de violence que constituent les massacres enregistrés depuis 2005 autour des barrières-frontalières. Notre analyse géostatistique corrobore l’analyse des personnes migrantes elles-mêmes, de chercheur·es, et d’associations concernant la surexposition des personnes migrantes Noires à la violence. Notre analyse des données collectées par l’OIM depuis 2014 démontre que sur les 892 cas documentés de personnes décédées à la frontière, au moins 406 sont Noires, soit 46%. Ce qui émerge ainsi est un régime de domination raciale instauré de part et d’autre de la frontière contre les personnes Noires, qui, comme nous le discutons au chapitre 3, pourrait être décrit en termes d’apartheid frontalier.
Malgré de nombreuses plaintes déposées par les personnes migrants concernant les violations de leurs droits à la frontière, les droits des personnes migrantes et les normes nationales et internationales qui devraient les protéger sont régulièrement bafoués, et un régime d’impunité a été consolidé, comme le révèle l’analyse par ECCHR de plus de 10 ans de plaintes.
Ensemble, les différentes formes de discrimination et de violence ciblant les personnes migrantes Noires à la frontière et le régime d’impunité qui a été consolidé au tour de ces violences ont rendues une population – les personnes migrantes Noires – massacrable.
Le chapitre 2 montre que si la violence négrophobe est continue à la frontière, son intensité varie nettement en fonction de l’état des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne, ainsi qu’entre le Maroc et l’Union européenne. Les analyses produites par Sani Ladan et Maite Daniela Lo Coco d’Irídia et les membres de l’AMDH-Nador qui fondent ce chapitre permettent de voir que la conjoncture particulière des rapports diplomatiques au cours de la période 2021-2022, oscillant entre tensions, rupture et réconciliation entre Rabat et Madrid, ont eu une influence fondamentale sur le niveau de répression sans précédent observé le 24 juin 2022. En effet, alors que dans un contexte de rupture diplomatique depuis mai 2021, les autorités marocaines laissaient passer plus de personnes migrantes à travers la frontière, après la réconciliation diplomatique entre Rabat et Madrid en avril 2022, les forces de l’ordre marocaines vont à nouveau intensifier leur répression, poussant les migrant·es Noir·es à tenter la traversée.
ar ailleurs, les témoignages que nous avons recueillis ainsi que l’analyse d’images satellitaires révèlent un fort degré de préparation, voire de préméditation, de la part des autorités marocaines. Celles-ci semblent d’une part avoir cherché à influencer les migrants pour qu’ils tentent la traversée de la barrière-frontalière sans l’équipement habituel, les rendant plus vulnérables, et d’autre part avoir renforcé la militarisation de la frontière dans les jours précédant le 24 juin, accroissant ainsi l’écart du rapport de force déjà profondément inégalitaire entre migrants et forces de l’ordre.
Le chapitre 3 qui se fonde sur l’analyse de tous les partenaires de l’enquête retrace précisément l’enchaînement des évènements du 24 juin 2022. En croisant de nombreux éléments de preuves, en particulier les témoignages des survivants recueillis au Maroc et en Espagne, l’analyse de documents officiels, l’analyse de nombreuses images photographiques et vidéographiques prisent par différents acteurs, et en localisant ces sources dans le temps et l’espace, nous produisons une cartographie de chaque étape des évènements, permettant d’analyser les pratiques de violence à l’œuvre.
Notre reconstitution systématique apporte de nouvelles preuves quant aux responsabilités des autorités marocaines et espagnoles, et permet de réfuter leurs versions des faits qui les déchargent de toute responsabilité. Ici également, notre analyse fait émerger une véritable stratégie, dans la mesure où les forces de l’ordre marocaines ont délibérément laissé les personnes migrantes approcher la frontière ce jour et les ont ensuite orientées, par la menace répressive, vers le poste-frontière de Barrio-Chino. Canalisées à l’intérieur du poste depuis lequel elles essayaient de passer la frontière pour entrer à Melilla, les personnes migrantes ont d’abord été ciblées par l’utilisation de matériel anti-émeute déployé de toute part par les forces marocaines et espagnoles. Le gazage intense dans un espace confiné, et la panique lors de la tentative de passage, ont certainement produit les premières morts de cette tuerie. Ce sont ensuite les passages à tabacs, principalement perpétrées par les forces marocaines, des personnes restées à l’intérieur du poste et de celles violements refoulées conjointement par les forces espagnoles et marocaines, qui ont constitué le moment principal, long de plusieurs heures, de violence mortifère. Aucune image de cette phase des évènements n’a été rendue publique jusqu’à présent. Ainsi, si ce déchainement de violence ne peut être rendu visible, nous le rendons audible à travers les témoignages des survivants. Nous révélons par ailleurs que les forces de l’ordre espagnoles ont elles-mêmes perpétrés de nombreux actes de violence et des violations, notamment en infligeant un traitement inhumain et dégradant aux personnes migrantes interceptées. En renvoyant les personnes migrantes vers le Maroc malgré la connaissance qu’ils avaient de la violence extrême à laquelle celles-ci seraient soumises, les agents Espagnols ont contribué à cette violence. Finalement, nous démontrons que si la majorité des morts ont eu lieu alors que les migrants étaient sous le contrôle des agents marocains, tous étaient sur le territoire espagnol. Bien que des zones d’ombre subsistent, les faits que nous avons reconstitués sont accablants, tant pour les autorités marocaines qu’espagnoles, ainsi que pour l’Union européenne qui les soutient.
Le chapitre 4 analyse la violence qui a continué d’affecter les rescapé·e·s après le massacre du 24 juin. En particulier, sur la base du travail de terrain de l’AMDH-Nador et d’autres acteurs de la société civile, il revient sur les déplacements forcés qui ont été organisés par les autorités marocaines juste après la tuerie et l’entrave à l’accès aux hôpitaux et services de santé pour certains des survivants blessés. Il aborde la question de la gestion opaque des cadavres issus du massacre et l’obstruction des possibilités d’identification et de recherche des morts et disparus par les familles des victimes, rendant impossible le deuil pour celles-ci. Il met en lumière également l’acharnement judiciaire vécus par des dizaines de survivants qui se trouvent aujourd’hui dans des geôles marocaines. A travers ces différentes pratiques, la violence du 24 juin continue d’engendrer de la souffrance pour les victimes et leurs familles.
(fig ? sat ? liste AMDH)
La conclusion lie entre eux ces chapitres et leurs différentes spatialités et temporalités. Nos recherches démontrent que la situation coloniale de cette frontière, les politiques européennes et espagnoles d’externalisation du contrôle des migrations, la diplomatie migratoire marocaine, l’impunité quant aux violences perpétrées, la répression raciste quotidienne déployée contre les personnes Noires dans la zone frontière et l’architecture frontalière, ont, ensemble, formé un piège mortel, que les forces de l’ordre espagnoles et marocaines ont exécuté le 24 juin 2022. Notre reconstitution des faits corrobore de manière terrifiante l’analyse des études Noires selon laquelle « la mort Noire n’est pas un évènement, mais un continuum ». Le massacre du 24 juin a commencé bien avant ce jour fatidique, et continue jusqu’à aujourd’hui.
Tout au long de notre contre-enquête, nous laissons une place majeure à la parole, aux expériences, aux analyses, et aux revendications des survivants du massacre. Cette contre-enquête est dédiée à toutes ces personnes, en lutte contre le racisme, pour leur dignité, et la reconnaissance de leur humanité et de leurs droits.
Méthodologie d’enquête
Si nous décrivons les méthodes spécifiques que nous avons utilisées dans chaque chapitre, ici nous présentons plus largement les problématiques méthodologiques que nous avons rencontrée, et les orientations méthodologiques que nous avons adoptée en conséquence. Notre enquête a dû répondre à un défi méthodologique et politique fondamental : alors que malgré la diffusion internationale des images documentant les évènements ce massacre est demeuré impuni, y-a-t-il une manière de documenter et d’analyser les évènements qui pourrait contribuer de manière efficace à contester la violence raciste dont témoignent les évènements du 24 juin 2022 ? Ce défi, peut être déployé en plusieurs questions clés qui ont influencées l’orientation de notre recherche. Notre réponse peut se résumer dans la combinaison des méthodes d’enquête et de reconstruction forensique des violences et violations aux frontières avec l’analyse critique du colonialisme et du racisme anti-Noir·es.
Face à la profusion d’images du 24 juin, que reste-t-il à révéler ?
De par les enquêtes sur les évènements du 24 juin publiées avant la nôtre, et en particulier les images vidéo produites par plusieurs acteurs et filmant depuis différents points de vue, une première question s’est imposée à nous : qu’y a-t-il de plus que notre enquête pourrait encore révéler alors que la violence semble avoir été documentée de manière quasi-totale ? Notre enquête peut-elle encore contribuer à la quête de vérité et de justice ? Nous pouvons répondre aujourd’hui par l’affirmative. D’une part, notre méthode d’analyse spatiale et visuelle systématique que nous avons déployée pour croiser tous les éléments de preuve accessible offre la reconstitution des évènements dans l’espace et le temps la plus complète à l’heure actuelle. Notre reconstitution éclaire d’une nouvelle lumière la responsabilité des états. D’autre part, la systématicité de notre approche a fait émerger des images qui ont été rendue inaccessibles concernant les moments de plus forte intensité dans le déchainement de la violence contre les personnes migrantes. Nous soulignons ces dissimulations qui étaient rendu plus difficilement perceptibles par la profusion d’image et l’impression de documentation totalisante des faits qui en résultait.
Pourquoi continuer à révéler la violence et les violations face à un régime d’impunité ?
La diffusion des images documentant la violence et la déshumanisation extrême des personnes migrantes lors des évènements du 24 juin, et l’absence de justice et d’interruption de la violence à la frontière malgré celle-ci, soulève un autre problème. Une documentation plus fine des évènements telle que nous avons tenté de la produire pourra-t-elle enrayer le régime d’impunité pour les morts et les violations à cette frontière ? Pourra-t-elle contribuer à y mettre un terme ? Nous publions cette enquête avec pessimisme quant aux futures réponses étatiques, du moins dans l’immédiat. Comme nous le montrons plus loin, le régime d’impunité au niveau national et européen pour les violations à cette frontière est établi de longue date. Le racisme anti-Noire qui fonde la violence à la frontière de Nador/Melilla est également présent dans les institutions du droit. La violence des frontières est par ailleurs structurelle et largement acceptée tant par les citoyen·nes et que les États Européens comme un mal nécessaire pour « protéger » l’Europe face à la « menace » que l’arrivée de personnes migrantes du Sud global est censée constituer. Si la possibilité d’un changement profond mettant fin à la violence à la frontière nous semble ainsi éloignée, nous considérons néanmoins les institutions politiques et légales au niveau national et européen comme des terrains de lutte important, et sommes déterminés à utiliser les différents outils du contentieux juridique et du plaidoyer pour défendre les droits des personnes migrantes. Par ailleurs, malgré ces limites, nous pensons que notre travail de contre-enquête est essentiel pour répondre à la demande de vérité et de reconnaissance exprimée par les survivants du massacre ainsi que les familles des morts et des disparus, et soutenir leur quête de justice face au crime qui a été commis.
Quelles peuvent être les ambivalences liées à la révélation de la violence ?
L’analyse critique formulée par les études Noires (Black Studies), dont cette enquête s’inspire, pose encore un autre défi : est-il possible que la documentation et la diffusion de représentation de la violence négrophobe puisse non seulement être impuissante pour y mettre un terme, mais l’aggraver ? Aux Etats-Unis, les études Noires ont montré que les effets espérés et supposés de la diffusion d’images de violence – qu’elle mènerait à une condamnation au moins publique, si ce n’est légale, et à terme à l’interruption de la violence – ne se réalise pas lorsque les cibles de la violence sont des personnes Noires. Au contraire, il est possible que la diffusion de ces images de violence contre les personnes Noires contribue à sa banalisation et ainsi à sa perpétuation.
Cette critique nous semble fondamentale, et comme nous le discuterons plus loin, nous a mené à développer des stratégies de mobilisation alternatives des images du 24 juin. En effet, nous les avons analysées notamment en dialogue avec les survivants du massacre, comme des éléments de preuve essentiels à la compréhension des faits. Cependant, notre analyse tente également de les mettre à distance afin d’interroger leur production et diffusion comme participant à la violence qu’elles documentent. Refusant de reproduire un regard de surveillance, de sensationnalisme ou de voyeurisme, et exerçant le « regard désobéissant » que Border Forensics a développé au cours de ses enquêtes, nous tentons de rendre visible la violence et la responsabilité des États, tout en protégeant l’identité des personnes et en respectant leur dignité en cachant certaines portions des images.
Au-delà de l’évènement du massacre, quelles sont ses conditions de possibilités ?
Finalement, l’approche critique développée par les études Noires pose encore un autre défi à notre analyse et reconstitution des faits du 24 juin ainsi qu’à notre objectif d’analyser la violence et la responsabilité des États. En effet, celles-ci soulignent que « la mort Noire n’est pas un évènement, mais un continuum qui informe de manière intime l’existence Noire ». Ainsi, bien que des cas de violence ciblant les personnes Noires puissent être révélés de manière spectaculaire lors d’évènements particuliers – comme lors du massacre du 24 juin 2022, mais également lors des nombreux cas de violences policières racistes – la violence qui s’immisce dans le quotidien des personnes Noires est le plus souvent bien moins spectaculaire et documentée. Or, cette violence quotidienne – souvent invisible et non-reconnue – est essentielle à prendre en compte. Si, comme le note le philosophe Norman Ajari, “la façon dont un Noir meurt dans un monde raciste est en continuité avec la manière dont il est tenu d’y vivre », nous devons étendre notre analyse au-delà de l’espace-temps du massacre du 24 juin 2022. Notre contre-enquête vise ainsi également à reconstituer à travers différentes temporalités et spatialités les conditions de possibilité du massacre, ou ce que nous pouvons appeler la massacrabilité des personnes Noires à la frontière. En particulier nous analysons le racisme et la déshumanisation quotidienne des personnes Noires à la frontière de Nador-Melilla, ainsi que le régime d’impunité entourant les violences et violations dont elles sont l’objet. Pour cela, nous combinons à travers cette contre-enquête des méthodes de recherche qualitative telles que la conduite d’entretiens, essentiels pour restituer l’expérience vécue ainsi que les analyses des personnes Noires, avec les outils de reconstitution visuelle, spatiale et d’analyse géostatistique des évènements développés par Border Forensics, permettant de rendre compte de l’évolution de pratiques structurelles et de la surexposition des personnes Noires à différentes formes de violence à la frontière sur le temps long. Dans ce sens, notre approche tente d’articuler l’analyse d’une part de la « causalité minimale » des coups infligés par les forces de l’ordre aux personnes migrantes lors de l’évènement du massacre et, d’autre part, de la « causalité maximale » de la violence structurelle qui opère dans un espace-temps étendu. Ce dernier inclut également la phase post-massacre, dans la mesure ou l’absence de vérité, de reconnaissance et de justice à la suite du massacre, l’absence d’identification des morts et des disparus, et l’acharnement judiciaire que subissent les victimes perpétuent la violence sous d’autres formes.
Que pourrait-être une enquête forensique critique, anti-raciste et décoloniale ?
Si les études critiques du racisme et les approches décoloniales ont influencé la définition même de l’objet de notre contre-enquête ainsi que nos méthodologies, nous avons également tenté de laisser ces perspectives influencer la constitution de notre équipe et notre processus de recherche. D’une part, dans les limites de conditions légales, sociales et fondamentalement matérielles différentes nous avons cherché à collaborer les plus étroitement possibles avec les survivants, et à restituer leurs expériences, analyses et résistances. Par
ailleurs, nous avons cherché à assembler une équipe de recherche au-delà des frontières de citoyenneté, de race et de classe, tout en reconnaissant et en tentant de minimiser les inégalités émanant de nos positions sociales différentes et asymétriques.
Pendant plus d’un an, Border Forensics a enquêté avec Irídia, l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) et d’autres acteurs de la société civile des deux côtés de la frontière, et bénéficié de l’analyse juridique du Centre Européen pour les Droits Constitutionnels et Humains (ECCHR). Ensemble nous avons constitué une vaste équipe composée d’associations de défense des droits humains, de journalistes, de chercheur·es spécialisé·es dans l’analyse critique des frontières, des politiques migratoires et du racisme, d’experts en reconstruction spatiale et visuelles, de statisticiens, des architectes, de réalisateurs de films documentaires. Notre travail s’est étendu sur plusieurs phases : collecte de données, notamment sur le terrain (février – juin 2023) ; analyse des données (septembre – décembre 2023) ; écriture et production des reconstructions visuelles et spatiales (janvier – avril 2024).
Notre processus de recherche à travers cette grande et diverse équipe a été long, difficile, et parfois marqué par des tensions. Mais il a constitué une étape dans l’expérimentation d’’une enquête forensique voulant tendre vers une approche critique, anti-raciste et décoloniale.
Notre approche trouve également son expression dans le style d’écriture adopté à travers ce rapport. Un ton neutre et descriptif prévaut le plus souvent dans des rapports concernant les violations des droits humains, tendant à effacer la position sociale des auteurs et autrices ainsi que leurs orientations politiques. Nous affirmons au contraire notre position, notre engagement, et notre perception non seulement des violations du droit mais de l’injustice qui a été commises, et adoptons une posture réflexive quant aux ambivalences que notre processus de recherche fait émerger. La reconnaissance de notre position fait partie de notre rigueur méthodologique et rend compte de manière transparente de notre perspective sur les faits.
CHAPITRE 1. CONTEXTE : UNE FRONTIÈRE RACIALE ET COLONIALE
La dimension raciale de la répression à la frontière, dramatiquement révélée le 24 juin 2022, est profondément influencée par l’histoire coloniale des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Notre analyse commence donc par s’ancrer dans ce contexte colonial et son évolution sur la longue durée.
La matrice coloniale de la frontière
La présence espagnole sur cette côte de l’Afrique du Nord commence dès la fin du Moyen- âge. À cette époque, les monarchies portugaise et espagnole tentent d’achever leur grand mouvement de reconquête – la Reconquista – de la péninsule ibérique, conquise par les Musulmans à partir du VIIIe siècle. Après la prise de Grenade en 1492 – mettant fin au dernier royaume musulman d’Al Andalus – les rois catholiques prolongent leur avancée sur la côte nord de l’Afrique. Il s’agit d’installer des postes militaires destinés à protéger les côtes andalouses des pirates menaçant les routes commerciales (et notamment les galions espagnols chargés de l’or des « Indes », soit des Amériques), mais aussi de contrer l’influence croissante des Ottomans cherchant à s’assurer le contrôle du commerce dans cette zone de la Méditerranée. C’est ainsi que Melilla est conquise en 1497 et devient la première frontera espagnole, s’inscrivant dans une politique globale d’expansion et d’affrontement de l’Islam. À cette époque, le terme de frontera désigne une place militaire avancée en territoire ennemi. À partir de l’enclave de Melilla, les souverains espagnols tentent de s’établir sur tout le long de la côte méditerranéenne vers la Tunisie. Conquise en 1415 par les Portugais, Ceuta passe aux mains des Espagnols en 1668.
Rapidement, l’aspect offensif des fronteras se transforme en situation défensive car les Espagnols et les Portugais ne parviennent pas à occuper l’arrière-pays et sont confrontés aux résistances des populations autochtones : les Rifains. La dénomination suivante presidios, pour les deux enclaves, désigne une prison car très tôt les deux fonctions sont réunies dans les deux enclaves. En 1889, Ceuta devient officiellement une prison coloniale où sont emprisonnés les dissidents espagnols de l’ordre colonial, mais aussi des territoires américains, comme les bannis de Cuba, et notamment les esclaves noirs libérés.
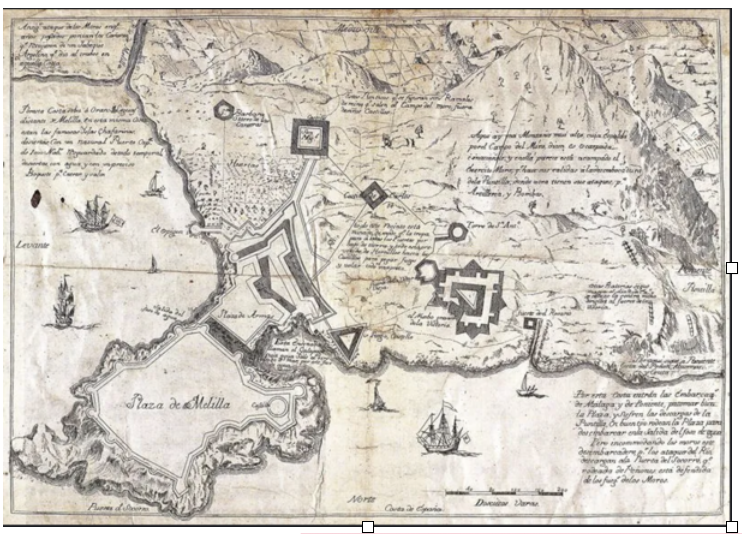
Au cours des siècles d’occupation espagnole, la place des militaires est importante à Ceuta et Melilla. Avec l’apparition des officiers africanistas, dont le plus célèbre est Francisco Franco – le futur dictateur –, une nouvelle génération de soldats trouve dans l’action coloniale sa raison d’être, et fait pression sur le pouvoir politique pour poursuivre la pénétration militaire du Maroc à partir du milieu du XIXe. Ceuta et Melilla deviennent les véritables têtes de ponts de la pénétration coloniale espagnole qui débute par une guerre meurtrière contre la résistance d’Abdelkrim El Khattabi, connu comme la figure de proue du mouvement rifain. En 1921 se solde une défaite espagnole à Annoual (près de Melilla), appelée « désastre d’Annoual » qui aurait fait entre 9000 et 13 000 morts dans les rangs espagnols – les chiffres restant méconnus côté rifain. Le « désastre d’Annoual » suscite au sein de l’armée espagnole d’Afrique une « syndrome de la vengeance compulsive », qui se traduit par son obsession pour le castigo (punition) du moro rebelde (maure rebelle) qui participe de la massive contre-offensive espagnole dans le Rif. Après plusieurs guerres sanglantes et une alliance franco-espagnole contre la résistance rifaine – notamment dans la guerre du Rif (entre 1921 et 1927), au cours de laquelle des armes chimiques sont utilisées –, un double protectorat espagnol et français est établi au Maroc.
La racialisation de l’Ennemi musulman est historiquement inscrite dans le projet colonial espagnol au Maroc. Dans le cas des enclaves, si les modalités de domination des populations conquises ont été diverses et hétérogènes – à la fois en fonction des sous-groupes ciblés et des transformations des enjeux et des intérêts sur la durée – ces processus sont marqués par la violence militaire et par la répression y compris dans le sang, appliquées à un groupe constitué comme Ennemi musulman, puis, plus spécifiquement Rifain.

Hormis quelques exceptions de catégories d’indigènes utiles à l’armée ou au commerce espagnol, la population musulmane est bannie des enclaves jusqu’à la fin du XIXe siècle.
Après l’indépendance marocaine, ségrégation raciale à Ceuta et Melilla
Malgré l’indépendance du Maroc en 1956, les deux villes sont restées sous contrôle espagnol. Au cours du XXe siècle, Ceuta et Melilla sont progressivement peuplées de civils originaires de la péninsule espagnole et du Maroc. La population dite musulmane s’accroît rapidement pour répondre aux besoins en main-d’œuvre liés à l’expansion capitaliste des deux villes. Mais les populations musulmanes vont vivre une ségrégation raciale continue dans les enclaves, traçant une continuité avec leur histoire coloniale. La violence ciblant les populations d’origine marocaine n’est cependant plus tant physique que symbolique, logée dans leur non-inclusion dans la communauté des citoyen·nes des enclaves et de l’Espagne.
En 1958 par exemple, les autorités espagnoles instaurent à Melilla une « carte de statistique » – en fait une simple carte de recensement – pour les Musulman·es qui ne leur accorde aucun droit : pas de résidence légale, pas d’accès à la propriété et ni à la circulation vers la Péninsule. Il s’agit de contrôler une partie de la démographie, celle de la population d’origine marocaine.
En 1986, la première étude statistique de la population musulmane à Ceuta et Melilla souligne que plus de 75% de la population musulmane des deux villes y est née. En revanche, le pourcentage de personnes possédant la nationalité espagnole parmi elle est très faible : moins de 16% à Ceuta, 34% à Melilla. Ce décalage illustre les réticences de l’administration de l’époque à accorder la nationalité espagnole, une volonté d’éviter l‘entrée de Musulman·es dans les institutions municipales et les réactions du secteur españolista de l’opinion publique craignant une “invasion silencieuse”. Ces agissements des gouvernements de Ceuta et Melilla ont pour conséquence de produire de nombreuses personnes apatrides parmi la population musulmane, alors qu’elle vit et est souvent née sur ces territoires réclamés espagnols. Spatialement, cette population est également localisée dans les marges, géographiques, économiques et politiques des deux villes. À partir de 1985, un mouvement social va se forger pour la reconnaissance des droits juridiques, politiques et sociaux des résident·es musulman·es des enclaves. Mais il rencontrera de grandes hostilités d’une partie de la population et des groupes politiques de droite et d’extrême droites des deux villes. Ce n’est qu’à partir des années 1990 que plusieurs milliers de naturalisations sont concédées, mais cela ne résout nullement l’injustice sociale et politique vécue par les populations musulmanes de Ceuta et Melilla.
En constante augmentation, la population d’origine marocaine suscite encore aujourd’hui les craintes de certains autour de la perte d’ « espagnolité » des enclaves. Une ségrégation sociale et spatiale et des discriminations à tous les niveaux perdurent et sont régulièrement dénoncées par les résident·es musulman·es.
Si de nos jours quelques personnes musulmanes sont devenues représentantes politiques et ont obtenu des sièges à l’Assemblée ou dans les Administrations des enclaves, la condition globale des résident·es musulman·es démontre la colonialité vivace du pouvoir régissant encore Ceuta et Melilla, qui en outre organise un contrôle accru des circulations à ses frontières, y compris pour les Rifain·es des régions voisin·es.
Pendant près de 40 ans, le statut quo étant respecté entre le Maroc et l’Espagne, et le statut des deux villes restant inchangé, une certaine « coexistence » semble s’être établie entre les deux pays autour des enclaves. En 1991, les deux royaumes signent un traité d’amitié, de
bon voisinage et de coopération. Mais en 1995, dans le cadre de l’achèvement de l’organisation administrative et politique de l’État espagnol, un statut d’autonomie est accordé à Ceuta et Melilla qui deviennent alors des « communes autonomes » (Comunidades Autónomas). Avec ce nouveau statut, l’Espagne cherche, selon l’opinion marocaine, à les intégrer pleinement à son territoire national pour empêcher toute revendication du Maroc. Encore aujourd’hui, côté marocain, Ceuta et Melilla restent officiellement considérées comme des ”présides occupés”.
Du côté des enclaves, si la menace “musulmane” ou “marocaine” continue d’être brandie par certains groupes politiques, de façon concomitante, une nouvelle figure d’ « envahisseur » commence à être érigée à partir du milieu des années 1990 : celle du migrant en provenance de l’Afrique dite « subsaharienne » tentant de traverser les frontières de Ceuta et Melilla pour se rendre en Europe.
Évolutions politiques, externalisation du contrôle européen et répression à la frontière depuis 1990
A la fin des années 1980, la consolidation d’un espace de libre circulation pour les citoyen·nes européen·nes se solde par le durcissement des conditions d’entrée sur l’ensemble du territoire européen pour les populations du Sud global et notamment celles des ex-colonies. En réponse aux difficultés croissantes que ces populations rencontrent pour se rendre légalement en Europe, de nouvelles stratégies et géographies de migrations émergent. Différentes zones terrestres et maritimes séparant l’Europe du Sud global deviennent des espaces de tentatives de franchissement des frontières pour les migrant.e.s illégalisé.e.s. C’est le cas des enclaves Espagnoles de Ceuta et de Melilla qui matérialisent les seules frontières terrestres entre l’Europe et l’Afrique. Après l’adoption de la loi sur les étrangers en 1985 et son adhésion en 1991 au Traité de Schengen, l’Espagne commence à appliquer une politique de fermeture croissante de ses frontières.
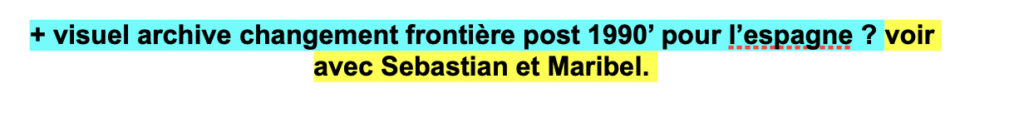
Les trajectoires migratoires de différentes populations du Sud global dont la mobilité est illégalisée convergent ainsi vers les zones frontalières de de Ceuta et de Melilla, auxquelles
elles tentent d’accéder pour ensuite gagner la péninsule Espagnole. D’abord utilisée par les ressortissant·es du Maroc, cette frontière est ensuite devenue zone de passage pour d’autres personnes provenant du reste du Maghreb (principalement d’Algérie), d’Asie (notamment d’Inde et du Bangladesh) et du Moyen-Orient (de Syrie, de Palestine et du Yémen, entre autres). Relativement peu remarquées côté marocain du fait de leurs ressemblances phénotypiques avec les Marocain·nes, les personnes d’Algérie et du Moyen-Orient illégalisées par les politiques migratoires européennes tentent le plus souvent le passage de la frontière à pied. Elles se fondent dans la foule traversant les postes-frontières de Ceuta et Melilla – comptant sur le caractère aléatoire des contrôles, se munissent de faux documents leur permettant d’entrer, ou encore versent des pots de vin à des policiers pour qu’ils laissent passer. D’autres se cachent plutôt dans des véhicules ou tentent parfois la voie maritime de passage. Malgré les possibilités de passer pour ces catégories de migrants, de nombreux cas de difficultés, voire de violence ou de morts ont été recensés, en particulier de mineurs marocains tentant d’entrer à Ceuta et Melilla pour se hisser sur les ferries partant vers la péninsule espagnole. Les risques d‘exposition à la violence et à la mort s‘agissant des personnes migrants Noires sont cependant bien plus important.
Les premiers ressortissants d’Afrique centrale et de l’Ouest arrivent à Ceuta et Melilla au milieu des années 1990. Ces derniers sont traités différemment des autres migrants en ce qu’ils sont immédiatement la cible de la violence d’État.
En octobre 1995, à Ceuta, alors que des hommes migrants protestent contre les conditions inhumaines de détention après leur entrée dans l’enclave dans l’enceinte d’un bâtiment colonial en ruines, ils sont brutalement réprimés, non seulement par les forces de l’ordre espagnoles mais aussi une partie de la population civile de Ceuta.
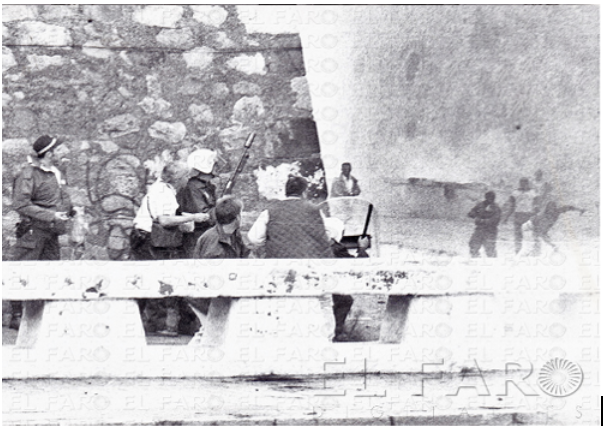
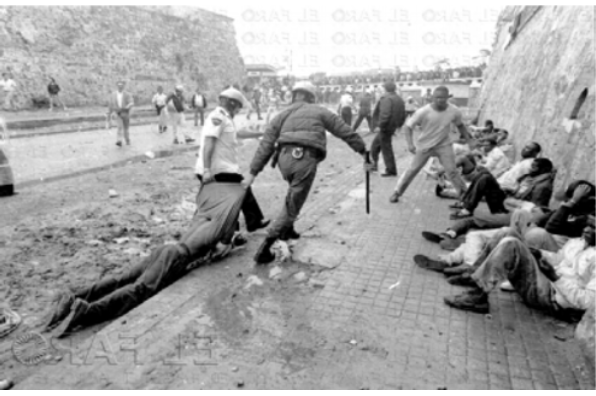
La répression des migrants Noirs à Ceuta lors de ces évènements, exceptionnelle à l’époque, deviendrait une pratique courante et normalisée avec la mise en place des expulsions violentes autour des barrières-frontalières de Ceuta et Melilla au cours des années à venir.
La répression espagnole depuis les enclaves et la construction des barrières
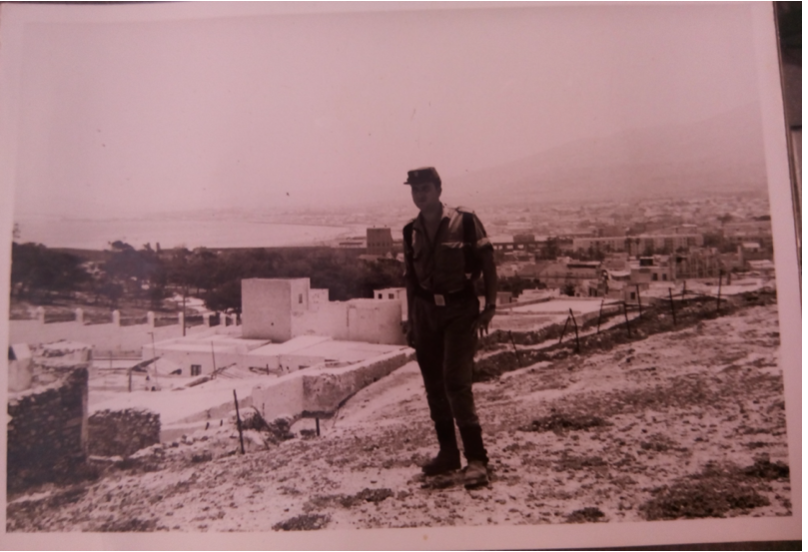
Alors qu’après l’indépendance marocaine en 1956, la frontière de Melilla n’était matérialisée que par des bornes posées au sol et une petite clôture informelle, les arrivées de migrants dits « subsahariens », qui sont jugées préoccupantes par l’Espagne ainsi que ses homologues européens, vont changer la donne. Les autorités espagnoles – quelle que soit la couleur du parti politique au pouvoir – vont chercher à améliorer l’imperméabilité des espaces frontaliers, avec le soutien politique et financier de l’Union européenne, en multipliant les dispositifs matériels et humains de contrôle et de surveillance. A partir de 1996, les autorités espagnoles érigent une barrière frontalière, dont la hauteur et la complexité ne cessera d’augmenter au cours des années suivantes.

En 2020, la barrière frontalière atteint 10 mètres, devenant le mur de séparation frontalière le plus haut du monde. Par ailleurs, l’équipement du haut de la barrière du dispositif de “peignes inversés”, qui a été étendu progressivement tout autour de la frontière depuis l’été 2020, a rendu les passages presque impossibles.
VISUALISATION 2 : vidéo évolution barrière (on doit bien voir les “peignes inversés”)
Malgré une pluralité de personnes migrantes présentes à cette frontière, les ressortissants d’Afrique centrale et de l’Ouest sont sur-visibilisés. C’est tout une rhétorique et une imagerie racistes autour des « assauts » de « subsahariens » aux barrières, et des politiques spécifiques visant les empêcher qui sont déployée, produisant au fil des années la catégorie de « migrants subsahariens » associée à une menace de premier ordre.
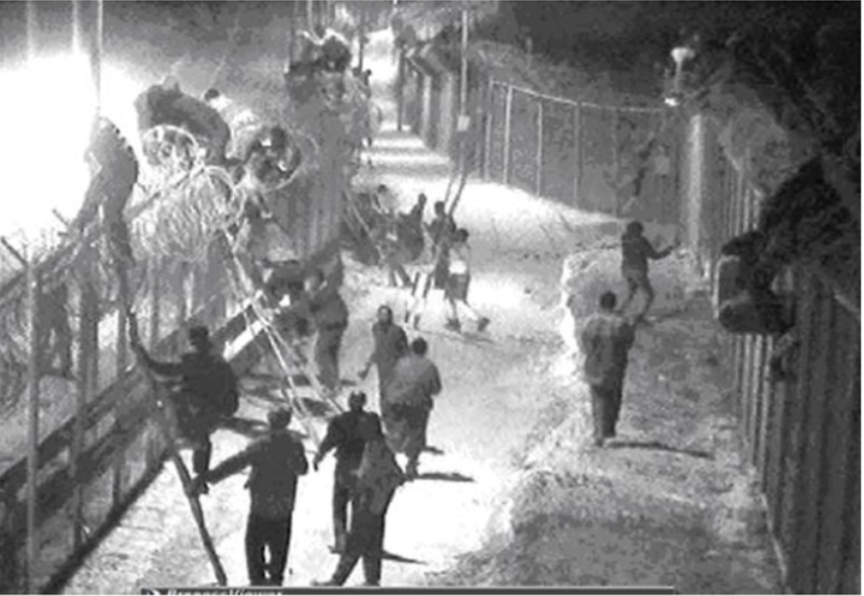
Source : https://blogs.elpais.com/fondo-de-armario/2014/03/la-valla.html
À partir des années 2000, mise en œuvre des politiques d’externalisation au Maroc
Dès la fin des années 1990, en plus de la répression mise en place par les autorités espagnoles, le Maroc est appelé par l’Union européenne à contribuer à la « lutte contre l’immigration clandestine ».
C’est par le biais d’une série d’accords et de financements, que le Maroc est incité par les États membres de l’UE et plus particulièrement l’Espagne à coopérer sur la “gestion des migrations”. Depuis les années 1990, cette coopération prend notamment la forme d’une participation au système de surveillance maritime SIVE. Le Maroc a ainsi été l’un des premiers pays africains à être la cible des politiques d’externalisation de l’Union européenne à travers lesquelles l’UE cherche à déléguer le contrôle de ses frontières à des acteurs non-Européens.
Cette politique a permis de renforcer la collaboration avec les autorités espagnoles à la frontière dans la lutte contre la migration dite “clandestine” vers l’Europe, mais aussi à atténuer les revendications du Maroc sur « Sebta » et « Mliliya », qu’il considère comme des territoires occupés.
En 2003, la loi n°02-03 est promulguée au Maroc et est identifiée comme une concession aux demandes européennes d’une loi plus sévère sur les questions migratoires. Dès lors, et malgré une nouvelle politique migratoire marocaine initiée en 2013, une répression accrue aux frontières ciblant les personnes Noires est observée. Des pratiques de ”refoulements à chaud” aux barrières, menées de concert avec les forces de l’ordre espagnoles et que nous détaillons plus loin dans ce chapitre, sont récurrentes .
De par sa coopération avec l’Espagne et l’UE, le Maroc est souvent qualifié de « gendarme de l’Europe » ; une vision réductrice et eurocentrée dans laquelle l’UE impose de manière unilatérale ses politiques au Maroc. Il convient de nuancer cette caractérisation en reconnaissant la capacité d’acteur du Maroc dans cette relation asymétrique. Comme nous le verrons pour l’année 2022, l’implication marocaine dans la répression aux frontières de Ceuta et Melilla se déploie avec des oscillations fortes, en fonction de l’état des relations diplomatiques maroco-espagnoles et maroco-européennes, et des avantages négociés. En effet, un équilibre précaire et changeant entre « pression migratoire » et répression à la frontière est nécessaire pour que les États marocain et espagnol puissent négocier et peser dans les rapports diplomatiques bilatéraux avec l’UE et ses États membres.
L’étude sur le temps long des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne ainsi qu’entre le Maroc et l’Union européenne, fait émerger les vies des personnes migrantes à la frontière, et notamment les personnes Noires Africaines, comme des « pions » sur un échiquier politique, comme l’analysent souvent les premier·es concerné·es.
Consensus autour d’une figure Noire du danger migratoire
Ainsi, depuis les années 1990, les logiques racistes et répressives espagnoles et marocaines convergent vers la répression des migrant·es Noir·es aux frontières de Ceuta et Melilla. Cette convergence, qui s’établit malgré des conflits anciens et présents entre le Maroc et l’Espagne concernant le statut des enclaves sous contrôle espagnol, est rendue possible par le fait que les personnes Noires constituent une figure consensuelle de leurs logiques racistes respectives.
L’ordre raciste marocain a des racines précoloniales – liées à plusieurs siècles de traites de personnes Noires dans l’espace arabo-musulman. L’ordre raciste espagnol quant a lui a une généalogie pré-coloniale et coloniale – celle que nous avons évoquée ci-dessus pour les enclaves de Ceuta et Melilla, mais qui s’étend aussi à travers son vaste empire . À la frontière, ces deux ordres racistes s’imbriquent et font convergence autour de la figure des migrant·es Noir·es.
Cette convergence permet la prise pour cible des migrant·es Noir·es de part et d’autre de la frontière, puisque ni le Maroc ni l’Espagne ne se reprochent de violenter des « clandestins subsahariens ». En réprimant les migrant·es Noir·es, l’Espagne et le Maroc peuvent performer leurs souverainetés respectives et leur participation dans la lutte contre l’immigration dite clandestine, tout en maintenant leurs intérêts communs à la frontière.
Visible de par la racialisation dont ils et elles font l’objet et traqué par les forces de l’ordre, les migrant·es Noir·es sont traité de manière différente par rapport aux autres migrants à la frontière, et surexposé à la violence. Contrairement aux autres populations – notamment marocaines, algériennes, syriennes qui parviennent avec plus ou moins de difficultés à tenter le passage au niveau des postes-frontières -, l’accès aux portes d’entrée normales » des enclaves de Ceuta et Melilla est en pratique rendue impossible pour les personnes Noires. Plus ces dernières s’approchent des frontières, plus elles rencontrent des formes de répression et de contrainte les ciblant spécifiquement. Il en résulte que les personnes Noires ont beaucoup plus d’occasions d’être soumises à la violence et de mourir que les autres personnes en exil qui tentent de passer ces frontières. Face à la répression qui les cibles, les migrant·es Noir·es s’organise à la frontière mais aussi au dela, notamment en formant des organisations dirigées par des migrant·es.
Négrophobie à la frontière, du harcèlement quotidien aux massacres. Le cas de la zone Nador-Melilla.
Si le contrôle migratoire peut s’exercer sur les personnes Noires sur une vaste partie du territoire marocain, il s’intensifie en fonction de leur proximité physique des frontières de Ceuta et Melilla.
La violence ciblant spécifiquement les personnes Noires est particulièrement observable dans la région de la ville marocaine de Nador, proche de Melilla. Ici, la lutte contre l’immigration dite clandestine est qualifiée de « chasse à l’homme Noir » par des personnes migrantes qui la subissent et pour qui la frontière constitue « un système raciste ». En effet, comme l’a dénoncé sur les réseaux sociaux l’AMDH-Nador en 2017 : « Régularisés ou non, étudiants ou non, titulaires d’un visa touristique, les arrestations, même à l’intérieur des maisons, se font sur un seul critère : la couleur noire de la peau ».
La répression étatique et raciste opère à chaque étape de la trajectoire des personnes Noires dans cette zone frontière, de leur arrivée dans la région jusqu’à leur tentative de passage. Nous analysons chacune de ces étapes l’une après l’autre.
Arriver à Nador, être traqué
Arrivant dans la région le plus souvent par bus, les migrants descendent généralement avant Nador, du fait du risque élevé de se faire contrôler ou arrêter à peine le pied posé dans la ville. Les forces auxiliaires marocaines, forces militaires d’appui habituellement chargées du maintien de l’ordre dans le Royaume, ont une mission spécifique dans les zones frontalières. À Nador, le travail de ces militaires est principalement orienté vers le contrôle migratoire. Depuis 2015, des unités spéciales se dédient à la traque des « Subsahariens », comme le rapportent les personnes migrantes et les membres de l’AMDH observant la situation sur place. L’arrestation au faciès peut ainsi avoir lieu à tout moment. C’est pourquoi les personnes se dirigent immédiatement vers des campements de migrants éloignés des centres urbains et situés en forêt.
Se cacher, survivre et s’organiser dans les campements en forêt
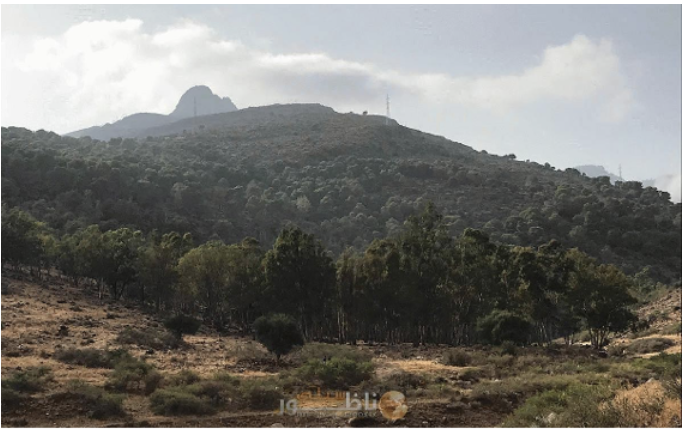

Pour essayer d’échapper à la traque les ciblant et tenter le passage de la frontière, les personnes d’Afrique centrale et de l’Ouest ont construit des campements dans les forêts proches de la frontière. Longtemps, le campement de Gourougou – situé sur le mont du même nom et proche des barrières de Melilla – a concentré la majorité des ressortissant·es d’Afrique centrale et de l’Ouest présent·es à Nador. Mais au fil des années et de la répression, les campements se sont dispersés et éloignés de la frontière, rendant les conditions de survie et d’organisation toujours plus dures. Deux types de campements peuvent être distingués dans les forêts frontalières : ceux où les personnes envisagent une traversée par la mer ou par voiture, avec une population mixte en termes de genre, et ceux à partir desquels (presque exclusivement) des hommes tentent de franchir les barrières par voie terrestre. L’ organisation sociale de ces différents types de campements est similaire, avec des chefs de campements et des relations de pouvoir et de solidarité entre eux et le reste des personnes souhaitant traverser la frontière. Dans et à travers ces divers campements, qui sont plus ou moins éphémères, les personnes Noires contestent, négocient l’espace et l’occupent là où aucune spatialité légitime n’est prévue pour elles.
Le harcèlement militaire et les rafles en forêt

Cependant les personnes migrantes ne sont pas en sécurité dans les campements où elles se cachent et d’où elles organisent leur passage. Les interventions répétées et inopinées des forces auxiliaires en forêt, notamment au petit matin, sont un des leviers d’une politique qui rend le quotidien invivable et épuise psychologiquement et physiquement les personnes visées. Dans les campements en forêt, il n’y a pas d’accès à l’eau potable, à des commodités d’hygiène, ni de point de ravitaillement. La « forêt c’est pour les animaux, pas pour les humains » déplorent depuis des années les personnes encampées côté marocain. Le harcèlement sécuritaire effectué particulièrement par les forces auxiliaires marocaines se matérialise aussi par la destruction régulière des campements par des incendies volontaires.

Les vols des biens des migrant·es, notamment les téléphones et l’argent, la destruction des documents d’identité, de séjour ou de papiers liés à une demande d’asile, sont des pratiques fréquentes des forces auxiliaires. Des agressions sexuelles commises par des militaires sur des femmes dans les campements sont aussi régulièrement dénoncées.
La répression des tentatives de passage aux barrières de Melilla

L’espace-temps de la répression la plus intense auquel sont exposées les personnes Noires est celui du passage de la frontière, lorsqu’elles tentent d’exercer une liberté de mouvement qu’on leur nie.
Si les autres populations, non-Noires, parviennent à accéder aux portes d’entrée « normales » des enclaves de Ceuta et Melilla, de par la répression qui les cible il est impossible en pratique pour les personnes Noires d’y accéder et par là-même de déposer une demande d’asile au bureau dédié – qui se trouve au niveau du poste-frontière de Beni-Ansar depuis 2015.
Les autorités espagnoles savent parfaitement que les personnes Noires ne peuvent arriver aux postes-frontières étant donné la traque négrophobe organisée par les autorités marocaines dans le cadre de sa collaboration à la lutte contre l’immigration vers l’Espagne/l’Europe. Cette ségrégation des modalités de traversée de la frontière est reconnue et décrite par des agents des forces de l’ordre. En 2015, le colonel de la Guardia civil de Melilla expliquait à une délégation associative :
« Il y a des voies d’entrée utilisées par les Subsahariens : le saut de la barrière, les embarcations en mer, se cacher dans des véhicules. À la différence des Syriens qui passent par le poste de contrôle à la frontière, en général avec des passeports falsifiés ou usurpés. Ici, oui, il y a des Blancs et des Noirs, les Subsahariens ne peuvent pas venir en marchant »
Des membres de l’association des gardes civils (AUGC) travaillant aux barrières de Melilla confirmaient ce constat :
« Il y a vraiment une question de Blancs et de Noirs. Ça c’est de la politique, priorité à certaines personnes et pas à d’autres. Pourquoi est-ce que la problématique focalise sur certaines personnes de couleur et pas sur les autres ? En fait aucune personne Noire ne va demander l’asile car on ne va pas la laisser s’approcher pour le simple fait qu’elle est Noire, alors que si elle est syrienne… Le bureau d’asile à la frontière : c’est juste pour faire taire les gens. Pourquoi ouvrir un bureau asile à la frontière si les gens ne peuvent pas s’en approcher ? Revenez dans quatre ans pour demander si un Noir a pu demander l’asile. Tout ça c’est un gros mensonge (…). »
Cette discrimination a également été reconnue par plusieurs institutions au niveau nationale et européen: en 2015 l’Espagne est dénoncée devant les Nations Unies pour violation du droit à la non- discrimination. La plainte du Comité René Cassin, ONG de juristes indépendants, oppose alors l’accueil pertinent des demandeurs d’asile syriens à l’impossibilité d’accès aux bureaux d’asile de Ceuta et Melilla pour les « Africains subsahariens », soulignant la discrimination raciale contre ces derniers. En 2016, la Défenseure du peuple en Espagne déclare que « les Subsahariens » n’ont pas accès aux postes-frontières des deux enclaves et par conséquent n’ont pas accès aux procédures d’asile.. Le représentant du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pour les migrations et les réfugiés parvient à la même conclusion, après sa visite à Melilla en septembre 2018. C’est aussi ce que dira la Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe en 2022 après sa visite en Espagne : “Dans la pratique, il semble qu’il n’y ait pas d’autre moyen d’entrer à Melilla et de demander une protection aux autorités compétentes qu’en nageant ou en sautant la clôture, au péril de sa vie”.
L’impossibilité à laquelle sont confrontées les personnes migrantes Noires de traverser par le poste-frontière formellement établi à cet effet est utilisé par les autorités pour criminaliser leurs mobilité et délégitimer leurs demandes d’asile.
Face à la répression, trois tactiques principales ont ainsi été développées par les ressortissant·es d’Afrique centrale et de l’Ouest pour tenter, malgré tout, le passage de la frontière. Les plus fortuné·es tentent l’entrée – moins risquée pour leur vie – par un poste-frontière, caché·es dans le double fond d’un véhicule. Autrement, elles doivent tenter une traversée par la mer, payante – souvent en zodiac – soit vers une des enclaves, soit directement vers la péninsule espagnole. Le franchissement de la barrière est le moyen d’entrée utilisé par les moins doté·e·s économiquement puisqu’il est « gratuit ». La tentative de franchissement des barrières-frontalières de Melilla constitue l’une des tactiques principales utilisées par les hommes Noirs – les femmes, considérées comme moins aptes physiquement, sont plutôt assignées à la voie maritime de passage.
Lors des tentatives de passage des barrières, devenues de plus en plus périlleuses à mesure que l’architecture de la frontière a été renforcée, les hommes ne sont pas censés montrer de signes d’agressivité envers les militaires qui les violentent. De nombreux exemples passés montrent que ceux qui ont osé se défendre, en utilisant des pierres ou d’autres objets, ont immédiatement été mis en prison pour « organisation criminelle ». Face à eux, les forces de l’ordre portent et utilisent des armes, et parfois même tuent les migrants pour assurer la défense de la frontière. Les récits des hommes ayant tenté de passer les barrières de Melilla convergent tous vers une même analyse de la violence déployée contre eux : celle-ci est souvent décrite comme intentionnellement excessive – qu’elle provienne des forces marocaines ou espagnoles – et les blessé·es et les décès en sont fréquemment la conséquence.
Les refoulements à chaud après avoir traversé les barrières-frontalières
Même les personnes qui parviennent à passer la barrière frontalière entourant l’enclave de Melilla ne sont pas à l’abri d’une expulsion sommaire et immédiate vers le Maroc, et ce malgré les normes établies par le droit international et de l’Union Européenne.
Selon ces normes, une fois que les personnes migrantes ont traversé la frontière espagnole, les agents espagnols doivent faciliter l’enregistrement de toute demande d’asile potentielle, alors qu’il leur est interdit de transférer les migrants aux forces de l’ordre marocaine en vue du principe de non-refoulement et de la prohibition de la torture.
Cependant, à Ceuta et Melilla, la Guardia civil a de longue date pour fonction officielle d’empêcher les entrées coute que coute. A cette fin et pour se soustraire à leurs obligations légales, les autorités espagnoles ont développé le concept de “frontière opérationnelle” ou “frontera chicle” (frontière en chewing-gum) qui, comme l’affirme Ayten Gündoğdu, constitue “une fiction juridique qui transforme la frontière d’une ligne fixe en une ligne qui fluctue continuellement”.
Ainsi, la frontière est définie au cas par cas et de manière ad hoc, en fonction de la situation à laquelle la Guardia Civil est confrontée au niveau de la barrière frontalière. Des documents internes de la Guardia Civil obtenus dans le cadre de procédures pénales relatives à la mort de migrants ont révélé que la “frontière opérationnelle” était définie par la clôture la plus intérieure de la barrière frontalière pour les entrées terrestres, et par la première ligne de défense des officiers présents pour les entrées maritimes. Toutefois, dans la pratique, seules les personnes qui parviennent à atteindre le Centre de séjour temporaire pour immigrants (CETI) sont à l’abri d’expulsions immédiates et sommaires.
En vertu de ce concept de contrôle des frontières, qui rompt “le lien étroit entre le territoire et la juridiction qui est au cœur des conceptions modernes du droit et de la politique” pour saper le “droit d’avoir des droits ” des personnes migrantes, la Guardia Civil est en mesure d’intercepter les migrants et de les expulser systématiquement et immédiatement vers le Maroc en les remettant aux autorités marocaines à travers la structure de la barrière frontalière. Cette pratique est dénoncée depuis des années par des organisations de la société civile et des juristes pour son illégalité et la violence utilisée par les forces qui la mettent en œuvre.
Le 1er avril 2015, le gouvernement espagnol a inscrit cette pratique informelle, connue sous le nom de devoluciones en caliente (retours à chaud), dans la législation espagnole, en la rebaptisant rechazos en frontera (“retours à la frontière”), une stratégie conçue pour donner une légitimité juridique à des pratiques illégales. Bien que la loi stipule clairement que
ces “retours” doivent être conformes au droit international, elle ne prévoit aucune garantie à cet égard, ce qui conduit à une situation absurde dans laquelle des dispositions légales réaffirment théoriquement des droits fondamentaux, mais sont pratiquement là pour les contourner.
Cette pratique a également été consolidée par la position de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire ND et NT c. Espagne (que nous examinons plus loin dans ce chapitre), dans laquelle la Cour a refusé d’appliquer les garanties de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que les migrants étaient “coupables” d’avoir franchi la frontière de manière irrégulière.
Ainsi, la pratique des « refoulement à chaud » demeure inchangée et se poursuit régulièrement aux frontières des deux enclaves, tant sur terre qu’en mer. Le principe de non-refoulement (établi par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés) et l’interdiction de la torture, tels qu’ils sont inscrits dans la législation espagnole, ne sont pas respectés, puisque les réfugiés n’ont pas la possibilité de demander protection. Cette pratique est également contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.
En plus d’être contraires au droit international, ces “retours à la frontière” sont également effectués de la manière la moins digne qui soit, dans l’insouciance totale de la sécurité de ces retours, avec l’utilisation dangereuse et non homologuée de matériel anti-émeute tel que du gaz poivré directement dans le visage de personnes à peine stables sur des clôtures de 6 mètres de haut, ou en transportant des personnes hors d’Espagne dans des positions extrêmement dangereuses et douloureuses, même lorsqu’elles sont inconscientes ou, pire encore, en traînant leur visage sur le trottoir comme du bétail. En fait, la comparaison du traitement déshumanisant des personnes Noires à la frontière entre l’Espagne et le Maroc a été faite par l’un des juges de la Cour européenne des droits de l’homme dans une opinion concordante : “Permettre que des personnes soient rejetées aux frontières terrestres et renvoyées sans que leurs demandes individuelles soient évaluées revient à les traiter comme des animaux. Les migrants ne sont pas du bétail que l’on peut chasser de la sorte “.


Retours vers le Maroc : arrestations, enfermement et déplacements forcés loin de la frontière
Ceux qui sont interceptés ou expulsés à la frontière sont enfermés dans la région de Nador avant d’être déplacés de force en bus vers différentes régions du Maroc, loin de la frontière. La durée de privation de liberté dans les locaux de police et de gendarmerie ou encore dans des lieux non officiels – tel le centre d’estivage d’Arekmane – peut atteindre une semaine. Sans contrôle judiciaire ni procédure légale, les personnes arrêtées sont photographiées et leurs empreintes sont relevées avant que les autorités procèdent à leur éloignement par bus vers le sud du Maroc.
Cartographier le continuum de la violence anti-Noire
La documentation et l’analyse établie de longue date par les acteurs de la société civile et des chercheur·es fait ainsi émerger un continuum de violence qui cible les personnes Noires, avant, à travers et après la frontière de Nador/Melilla.
Nous avons collecté, analysé spatialement et visualisé plusieurs sources de données qui permettent de rendre compte, à travers des méthodes d’analyse géostatistique, de la quotidienneté et de la diffusion spatiale des différentes formes que prend la répression à la frontière, ainsi que du caractère raciste de celle-ci.
Depuis 2014, l’AMDH-Nador est l’organisation de défense des droits humains qui documente et analyse de manière la plus régulière et fine la répression des migrant·es Noir·es à cette frontière. En plus de ses rapports annuels, l’AMDH-Nador est très présente sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Nous avons répertorié toutes les publications Facebook de l’association se référant aux différentes formes de répression à la frontière, puis, après les avoir catégorisées, quantifiées et géolocalisées, nous les avons cartographiées. Bien que les données de l’AMDH-Nador ne soient pas exhaustives, elles démontrent l’omniprésence de la répression dans cette zone frontière, ainsi que sa diffusion dans l’espace, donnant ainsi une forme visuelle et analytique à la réalité vécue et décrite par les personnes migrantes Noires depuis de nombreuses années.

Par ailleurs, il nous a été possible de démontrer statistiquement les trajectoires différentielles des personnes migrantes à la frontière en fonction de leur origine décrite ci-dessus, et en particulier de démontrer statistiquement l’exclusion systématique des personnes Noires des espaces sures de migrations via le poste frontière de Beni-Ensar, ou il devrait être possible de déposer une demande d’asile. Entre 2015 et 2018, seules 35 personnes Noires parmi les plus de 524 demandeurs d’asile (7%) ont pu déposer une demande d’asile au poste frontière de Beni-Ensar, alors que plus de 75% des personnes issues d’Asie du Sud-Ouest on put faire leur demande d’asile à ce poste, sans se voir imposer des trajectoires migratoires mortelles.
La surexposition des personnes migrantes Noires à la violence et à la mort lors de leurs trajectoires rendues dangereuses par cette exclusion, est également révélée par notre analyse statistique. En effet l’analyse des données concernant les arrivées à Melilla (Ministère de l’intérieur Espagnol, APDHA, CEAR) et les morts à la frontière (IOM) révèle clairement la sur-représentation des personnes Noires parmi les morts à la frontière. Bien que ces données ne soient pas exhaustives, depuis 2014, l’OIM a compté 892 personnes décédées à la frontière, dont au moins 406 sont Noires, représentant 46% des morts documentés, alors que cette population représente moins de 20% des arrivées documentées par l’Espagne. Le taux de mortalité parmi les personnes tentant de traverser la frontière apparait comme inégalement réparti entre les migrants de différentes nationalités: ce taux est proche de 0 pour les personnes issues d’Asie du sud-ouest, et il est 4 fois supérieur pour les personnes Noires que pour les personnes originaire du Maghreb. Il est à noter que ces estimations sont conservatrices : le nombre des personnes décédées est un minimum observé. La catégories ‘’Inconnu’’ dans les données des morts recouvre certainement d’autres personnes Noires. Aussi, les arrivées documentées par l’Espagne peuvent être surestimées : une personne refoulée peut être comptabilisé plusieurs fois dans les arrivées. Ces trois éléments indiquent que les statistiques produites sont sous-estimées : il est probable que cette sur-représentativité des personnes Noires mortes à la frontière soit encore plus importante dans la réalité. Ces disparités dans les effectifs des morts selon l’origine des personnes ne sont pas le fruit du hasard : elles sont l’expression de la racialisation de la frontière.
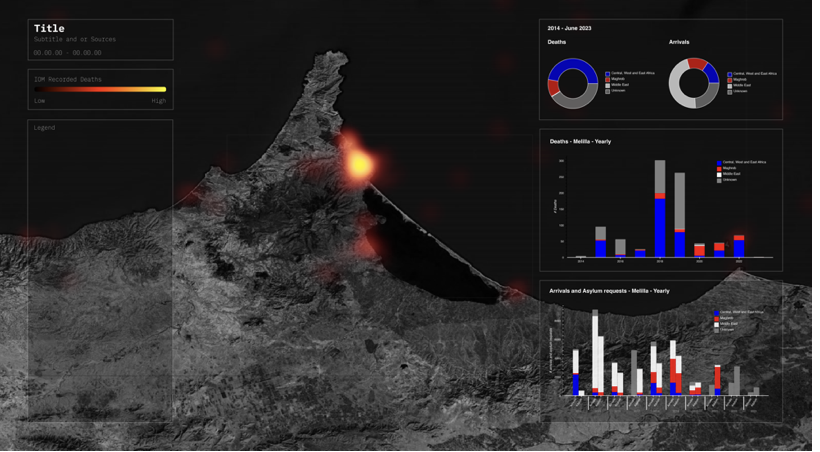
Elsa Tyszler conclu sur la base de son analyse qualitative que “la surexposition des personnes Noires à la violence et à la mort démontre à quel point la négrophobie structure les politiques et pratiques de contrôle et de répression maroco-espagnoles”. Notre analyse géostatistique corrobore les résultats des analyses qualitatives menée jusqu’ici et permet de souligner l’articulation de différentes formes de répression et de violence ciblant les personnes Noires spécifiquement.
L’analyse de la violence quotidienne déployée aux frontières de Ceuta et Melilla est particulièrement importante, car elle reçoit bien moins d’attention que les cas de pics d’intensité de violence qui ont ponctué les 20 dernières années. Parmi les cas les plus médiatisés, notons les massacres de 2005 qui ont fait au moins onze morts et des centaines de blessé·es aux frontières de Ceuta et Melilla. Un autre cas médiatisé est celui de février 2014, à la plage-frontière de Tarajal (Ceuta) où au moins 14 personnes ont perdu la vie et des dizaines ont été blessées quand la Guardia Civil a attaqué un groupe de migrants qui luttait déjà pour rester à flot en tirant plus de 100 balles en caoutchouc et plusieurs bombes de gaz en l’espace de 21 minutes, créant ainsi des conditions mortelles pour eux.Le massacre du 24 juin 2022 à la frontière Nador-Melilla qui a vu un déchaînement de violence spectaculaire s’inscrit dans la continuité de cette liste macabre. Cependant, la violence raciste quotidienne qui normalise la négrophobie et crée les conditions structurelles rendant ces massacres possibles est, elle, le plus souvent occultée. Notre analyse tente d’analyser à la fois le massacre du 24 juin et la production de la massacrabilité des personnes Noires à la frontière, dont la violence raciste quotidienne est un élément essentiel.
Malgré les demandes de justice, une impunité qui perdure et se renforce
Malgré des cas répétés et documentés de violence mortifère et de violation des droits commis tant par les forces de l’ordre marocaines qu’espagnoles, et en dépit de plusieurs plaintes déposées par les victimes et leurs familles avec le soutien d’associations de la société civile, ces pratiques n’ont pas été sanctionnées par la loi et continuent d’être perpétrées en toute impunité. Ceci constitue un autre facteur essentiel à la perpétuation et la normalisation de la violence contre les migrant·es Noir·es, qui rend les massacres qui ponctuent l’histoire de la frontière de Nador/Melilla.
La lutte pour la justice aux frontières de Ceuta et Melilla a été marquée par les efforts inlassables de la société civile pour obtenir justice devant les tribunaux nationaux et les instances internationales. Nous avons recueilli les informations disponibles sur les procédures en justice pour les violations des droits humains aux frontières de Ceuta et Melilla et les avons analysées avec notre partenaire ECCHR, en reconstituant les principales étapes et les résultats de chaque affaire. Bien que nous analysions plusieurs cas, notre liste de cas n’est pas exhaustive en raison des difficultés d’accès à l’information concernant les procédures pénales. En ce qui concerne les procédures pénales nationales, les informations ne sont pas publiques et ne sont accessibles que si elles sont mises à disposition par des acteurs de la société civile ou si les détails de ces procédures sont publiés dans les jugements d’instances internationales, telles que les comités des Nations unies ou la Cour européenne des droits de l’homme.
La première plainte que nous avons identifiée est l’affaire Sonko c. Espagne, concernant la noyade d’un Sénégalais lors d’une opération de contrôle à la frontière par la Guardia Civil en 2007. Bien qu’elle soit antérieure à la période 2014-2022 sur laquelle se focalise notre étude, il est important de mentionner cette plainte car elle illustre un schéma qui se répétera à maintes reprises lors d’autres plaintes. Si une enquête a dû être ouverte puisque l’incident impliquait la mort d’une personne, elle aurait été rapidement clôturée par le juge judiciaire sans l’intervention de la famille du défunt par l’intermédiaire du médiateur espagnol et du procureur général espagnol. Malgré la réouverture d’une procédure nationale, l’enquête s’est caractérisée par un blocage, un déni de compétence et un refus d’inclure les survivants et la famille du défunt, qui ont donc porté l’affaire devant le Comité des Nations unies contre la torture (CAT) avec l’aide de la société civile en octobre 2008. Bien que les procédures nationales aient été archivées, l’affaire a conduit à la condamnation de l’Espagne par le CAT de l’ONU en novembre 2011. Malgré cette victoire, les recommandations sur la réouverture de l’enquête et le paiement de dommages à la famille du défunt seront ignorées par l’Espagne. Les étapes et les résultats de cette affaire révèlent de manière frappante l’absence de recours juridique au niveau espagnol, mais aussi le manque d’application des jugements par les autorités espagnoles, même lorsque la responsabilité est établie à un niveau plus élevé.
Les enquêtes nationales ultérieures suivront le même schéma que l’affaire Sonko c. Espagne. Ainsi, le cas emblématique de la Playa del Tarajal présente la procédure la plus longue en matière de violence et de décès à la frontière de Ceuta et Melilla, de 2014 à 2022. L’enquête est également caractérisée par le déni de compétence initial, suivi par l’exclusion des familles des personnes décédées et des survivants, et par le refus d’enquêter et de clarifier les faits les plus élémentaires. Après une série de clôtures dramatiques – y compris juste après l’inculpation des officiers et la décision d’ouvrir la phase du procès – l’affaire sera définitivement archivée en mai 2022. Au cours de ce processus, grâce à l’infatigable société civile, certaines informations seront obtenues et deux survivants sur trois seront entendus comme témoins, bien que leurs témoignages soient rejetés comme étant sans valeur sur la base de stéréotypes anti-Noirs classiques, tels que la “présentation d’une attitude”. L’archivage de l’affaire a été contesté à la fois au niveau national devant la Cour constitutionnelle et au niveau international devant le Comité contre la torture des Nations unies. Les deux procédures sont en cours.
2014 a également été l’année qui a vu une série d’expulsions donnant lieu à plusieurs affaires connexes, se déroulant en parallèle devant les juridictions pénales nationales et la Cour européenne des droits de l’homme, dont l’affaire déterminante ND et NT c. Espagne, qui consacrera l’impunité espagnole au plus haut niveau européen (voir ci-dessous). Ainsi, suite à trois événements d’expulsion en juin, août et octobre 2014, des ONG ont déposé des plaintes pénales devant le pouvoir judiciaire à Melilla, conduisant à l’ouverture d’enquêtes contre des officiers réguliers et le chef de la Guardia Civil de Melilla. Ici aussi, suivant l’ancrage de la pratique des retours à chaud dans le droit national par une réforme législative en avril 2015, les deux d’affaires seront archivées après avoir obtenu que des charges soient retenues contre le chef de la Guardia Civil à Melilla. Entre-temps, trois des personnes expulsées lors des incidents susmentionnés ont porté plainte contre l’Espagne devant la Cour européenne des droits de l’homme, ce qui a donné lieu aux affaires ND et NT c. Espagne et Doumbe Nnabuchi (Danny) c. Espagne. Les affaires ND et NT aboutiront d’abord à une condamnation unanime de l’Espagne en 2017 par la cour, puis à un revirement spectaculaire et à une légitimation unanime de la politique par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme en 2020. Un an plus tard, trois juges décident que Doumbe Nnabuchi – ainsi qu’une troisième affaire concernant des retours à chaud à Melilla, en Malaisie et en République tchèque – sont tout simplement irrecevables et ne seront pas examinés plus avant par la Cour européenne des droits de l’homme, sur la base de l’arrêt ND et NT de 2020. Les tentatives ultérieures de responsabilisation devant la Cour européenne des droits de l’homme seront rejetées encore plus rapidement (cas d’Abdou). Au niveau national, l’arrêt de la Grande Chambre dans les affaires ND et NT a également conduit la Cour constitutionnelle espagnole à refuser de juger inconstitutionnelle la réforme législative inscrivant cette pratique dans le droit national.
Malgré ces revers, la condamnation de l’Espagne dans l’affaire Sonko c. Espagne par le Comité des Nations unies contre la torture (CAT) reste valable, tout comme celle du Comité des Nations unies pour les droits de l’enfant dans l’affaire DD c. Espagne pour le refoulement à chaud d’un mineur non accompagné. Dans cette affaire, l’Espagne a explicitement refusé de se conformer aux recommandations du comité des Nations unies visant à indemniser l’enfant pour les traitements illégaux qu’il a subis et à prendre des mesures pour garantir l’identification et la protection des mineurs non accompagnés à la frontière de Ceuta et Melilla, en se référant aux arrêts ND et NT de la Cour européenne des droits de l’homme, qui consacrent la légalité de ces pratiques dans le cadre du droit international relatif aux droits de l’homme. Cette conclusion est erronée et les condamnations de l’Espagne confirment que ces pratiques sont en violation des obligations de l’Espagne en vertu du droit international des droits de l’homme.
Globalement, notre analyse des demandes de la vérité et de la justice par les victimes de violences aux frontières révèle qu’au lieu de freiner ces pratiques, l’impunité pour les violations a permis de consolider et d’institutionnaliser des pratiques contraires aux normes régissant les droits des personnes migrantes. En particulier, les retours à chaud effectués aux barrières frontalières, sans aucune considération pour les demandes de protection des migrants, ont été progressivement formalisés dans les politiques et les lois espagnoles, et en partie légitimés par la jurisprudence européenne. Le soutien de la Cour européenne des droits de l’homme à ces pratiques a encore aggravé la situation et contribué aux conditions qui ont conduit au massacre du 24 juin à Melilla. Ce régime d’impunité fondé sur la négation du “droit d’avoir des droits” des personnes migrantes joue un rôle central dans la consolidation des conditions de possibilité de la violence à la frontière, y compris dans sa forme la plus extrême, comme en témoigne le massacre du 24 juin 2022.
Affaire ND et NT contre Espagne
Un revers majeur pour la protection des réfugiés : La Cour européenne des droits de l’homme rejette une plainte contre l’Espagne
ND et NT ont franchi la clôture frontalière de Melilla et sont entrés en Espagne le 13 août 2014. La Guardia Civil espagnole les a appréhendés, ainsi qu’environ 70 autres personnes originaires d’Afrique « subsaharienne » qui ont également escaladé les clôtures. Ils ont été immédiatement « repoussés » vers le Maroc – sans avoir accès à aucune procédure légale ou protection.
Les agents de la Guardia Civil qui se tiennent au pied de cette clôture leur lancent des bouteilles d’eau. Ceux qui, épuisés, descendent par l’échelle fournie par la Guardia Civil sont immédiatement appréhendés, menottés et escortés à travers la structure de la clôture frontalière pour être remis aux autorités marocaines du côté marocain de la frontière. Tel a été le sort des deux requérants dans cette affaire.
Les deux requérants étaient représentés par Carsten Gericke (Hambourg) et Gonzalo Boye (Madrid), avocats partenaires de l’ECCHR .
L’affaire a été introduite en février 2015, dans le délai de six mois à compter de l’expulsion, qui a eu lieu en août 2014. En juillet 2015, la Cour a informé les requérants que leur demande concernant les risques qu’ils encouraient lors de leur expulsion en raison de la violence raciale au Maroc, et en particulier autour de la frontière de Melilla, ne serait pas examinée et qu’elle était rejetée prima facie comme étant “manifestement infondée”, et ce malgré les nombreuses preuves fournies
Ainsi la plainte concernant la violation du principe de non-refoulement n’a pas été considérée, et seule l’allégation des requérants en vertu de l’interdiction de l’expulsion collective (article 4 du protocole 4) a été admise pour examen par les juges .
En octobre 2017, une chambre de sept juges de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé unanimement que les “refoulements” de l’Espagne étaient illégaux. Mais en février 2020, ce jugement a été unanimement rejeté par la Grande Chambre de la CEDH.
Bien que la Grande Chambre ait clairement rejeté la revendication de l’Espagne d’une frontière ad hoc et d’une zone frontalière de non-droit dans laquelle l’applicabilité des lois pouvait être suspendue, elle a en fait refusé d’appliquer l’interdiction de l’expulsion collective à la frontière terrestre hispano-marocaine.
L’arrêt lui-même reprenait bon nombre des clichés racistes qui caractérisent le traitement des Noirs, et en particulier des jeunes hommes Noirs, par les forces de l’ordre dans le monde entier et à cette frontière en particulier. Ainsi, bien que les preuves de violence à l’encontre des hommes Noirs au cours de cette journée fassent partie des preuves soumises, et bien qu’il ait été expressément souligné qu’il n’y avait absolument aucune preuve de violence de la part de ces hommes Noirs ce jour-là à l’encontre de qui que ce soit (et l’arrêt ne peut pas faire référence à un seul élément de preuve dans ce sens), l’arrêt les a tout de même qualifiés de violents, un mot utilisé à maintes reprises dans l’arrêt.
Sur le plan politique, l’arrêt a renforcé la légitimité du déni de droit et de l’impunité aux frontières espagnoles et européennes, ainsi que l’idée que les migrants sont des êtres sans droits, qui doivent être punis pour avoir franchi les frontières de manière irrégulière.
Ce chapitre a démontré la dimension coloniale de cette frontière sur la longue durée. Replonger dans l’histoire longue de l’occupation de Melilla nous a permis de révéler la dimension raciale et coloniale ancienne de cette frontière. L’analyse de l’évolution des législations, politiques et pratiques nous a permis de saisir le caractère raciste de la répression anti-migratoire qui se met en place autour les enclaves de Ceuta et Melilla à partir des années 1990, puis à partir des années 2000 côté marocain. Si le personnes migrantes Noires ne sont pas les seules à subir cette répression, elles en sont les cibles les plus visibles et sont exposée à des formes de violence exacerbées.
Les processus de racialisation perpétuelle se faisant, depuis plusieurs décennies, à travers les chasses à l’homme ciblant spécifiquement les personnes Noires dans la région de Nador, les traitements inhumains et dégradants dans les campements en forêt, la violence des forces de l’ordre poussée à son paroxysme au niveau des barrières, la persistance des retours à chaud permise par les outils du droit espagnol et européen, et le maintien de l’impunité autour des personnes violentées et tuées dans toutes ces entreprises de répression, démontrent la colonialité de la condition des personnes migrantes Noires qui est entretenue à la frontière. Comme nous le discuterons dans le chapitre 3, le régime de domination raciale instauré de part et d’autre de la frontière contre les personnes Noires pourrait être décrit en termes d’apartheid frontalier.
Les différentes formes de discrimination et de violence ciblant les personnes migrantes Noires à la frontière et le régime d’impunité qui a été consolidé au tour de ces violences et violations ont rendu une population – les personnes migrantes Noires – massacrable. La massacrabilité des personnes Noires à la frontière a créé les conditions de possibilité de plusieurs massacre qui ont marqué l’histoire de la frontière, culminant dans le massacre du 24 juin 2022. Si ce massacre a été rendu possible par une condition structurelle construite sur la longue durée, il s’est matérialisé dans une conjoncture spécifique dans les rapports diplomatiques entre le Maroc, l’Espagne et l’Union européenne. Comme nous le montrons dans le chapitre suivant, ces rapports diplomatiques changeants jouent un rôle essentiel dans la modulation de l’intensité dans la violence anti-Noire à la frontière.
CHAPITRE 2 : 2021-2022, FLUX ET REFLUX DE LA COLLABORATION MAROC-ESPAGNE AUX FRONTIÈRES
La répression ciblant les personnes migrantes Noires des deux côtés de la frontière est une donnée constante depuis plusieurs décennies. Son intensité varie cependant dans le temps en fonction de l’état des rapports diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne ainsi qu’entre le Maroc et l’UE. Pour comprendre la violence sans précédent dont les personnes migrantes Noires ont été la cible le 24 juin, nous devons analyser les évolutions des rapports diplomatiques et des pratiques de répression à travers le temps, et en particuliers au cours des mois qui ont précédées le massacre.
Depuis les années 2000, deux scénarii se distinguent aux frontières de Ceuta et Melilla. Le premier est celui de bonnes relations diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne, ainsi qu’avec l’UE. Le Maroc met alors en scène son effort de collaboration, qui se matérialise en une répression accrue des migrants à la frontière. C’est ce qu’il se passe à l’automne 2005, lorsque des pics de répression mortelle ont lieu juste avant la tenue d’un conseil des premiers ministres espagnol et marocain à Séville. En 2018 également, dans la période de l’obtention du Maroc de la signature de l’accord de pêche avec l’UE, c’est un nombre record d’arrestations et d’opérations sécuritaires qui est enregistré dans les zones-frontières. Cependant, pour que le Maroc puisse manifester sa volonté de collaborer par la répression, il faut qu’il y ait un degré suffisant de « pression » migratoire aux frontières, quitte à encourager des tentatives de passage aux barrières de Ceuta et Melilla.
Le second scénario est celui des moments de crises diplomatiques. Le « robinet » – comme le fait de faciliter ou d’empêcher les traversées des migrants est appelé métaphoriquement – aux portes de Ceuta et Melilla est une stratégie régulièrement utilisée par le Maroc lorsqu’il y a des différends avec l’Espagne. Le Maroc réagit avec vigueur chaque fois que le gouvernement ou la couronne espagnole tente de banaliser sa présence à Ceuta et Melilla, qui demeure pour le Maroc des enclaves coloniales. En raison du conflit au tour du Sahara Occidental, la réaction est tout aussi vive à l’annonce d’un geste, d’un contact, entre l’Espagne et le Front Polisario ou avec un représentant sahraoui. Le Maroc laisse alors passer les personnes migrantes plus facilement, comme l’illustrent les exemples d’entrées qualifiées de « massives » à Ceuta ou Melilla en 2014, 2018 ou à nouveau en 2021.
Dans ces rapports diplomatiques changeants, et les équilibres variables entre incitation et répression qui en découlent, les personnes migrantes, Noires en particulier, sont instrumentalisées. Malgré cela, les personnes migrantes maintiennent leur capacité d’action et opèrent leurs propres stratégies de passage, qui est irréductible aux calculs politiques de part et d’autre de la frontière.

Nous avons analysé l’évolution des rapports diplomatiques entre le Maroc, l’Espagne, et l’UE, ainsi que différents indicateurs concernant les dynamiques migratoires et la répression à la frontière, afin de mieux comprendre les interactions en jeux. Nous avons récolté les données concernant les arrivées (Ministerio del Interior) à Melilla et des mort·e·s (IOM) dans la zone frontière de Melilla entre 2014 et 2022, et les avons désagrégées par localisation afin de distinguer les arrivées et morts ayant eu lieu sur terre ou en mer. Ceci permet d’entrevoir plus précisément l’évolution de la spatialité des dynamiques migratoires et des typologies de repressions. A noter que de 2014 à fin 2016, seul une valeur moyenne mensuelle des arrivées a pu être consulté. Par ailleurs la base de données des mort.e.s nous donne à voir un minimum observé dans cette zone : des nombreuses personnes décédées n’ont pas laissé de traces.
Nous avons également procédé à un recensement exhaustif et systématique d’une variété d’évènements en lien avec le contexte migratoire, regroupés selon une typologie spécifique : les conflits et évènements politico-diplomatiques ainsi que les accords économico-politiques entre l’UE et le Maroc, ou l’Espagne et le Maroc ; les financements inter-gouvernementaux et les évolutions législatives ; les évènement juridiques en lien avec les plaintes déposées par les victimes de violences aux frontière. De ce recensement, nous avons constitué une base de donnée et attribué un score qualitatif exprimant la (distance-)proximité diplomatique qu’engendre les évènements.
L’ensemble de ces données ont ensuite été représentées graphiquement, permettant d’explorer la relation entre les rapports diplomatiques entre les différents états et les données des morts et des arrivées à Melilla. En mettant en relation ces différentes information avons pu identifier plusieurs phases clefs de changements dans les rapports diplomatique entre le Maroc, l’Espagne, et l’UE qui ont eu une influence importante sur les dynamiques migratoires et la répression à la frontière. Ces phases distinctes peuvent être résumée à grand traits.
Entre 2014 et fin 2015, les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Union européenne se voient renforcées, notamment autour de la délivrance des visas Schengen et des accords de libre-échange. L’amélioration de ces relations coïncide avec une augmentation de la violence envers les personnes migrantes Noires, avec des naufrages et des raids dans les forêts de Nador alors qu’un grand nombre d’arrivées est enregistré en Espagne, majoritairement de Syriens en besoin de protection internationale.
En février 2016, une suspension des relations entre le Maroc et l’UE – à la suite d’une remise en cause l’accord agricole Maroc-UE et de la souveraineté nationale du Maroc sur les provinces du Sud – amorce une période de tensions diplomatiques et conduit à une utilisation par le Maroc des enjeux migratoires comme stratégie de pression pour influencer l’UE et l’Espagne dans les négociations sur l’accord de pêche et sur la question de la souveraineté. Sur le plan migratoire, cette période est marquée par une augmentation des arrivées de migrants et des demandes d’asile. Les morts de migrants restent rares en comparaison aux autres périodes, survenant principalement en mer.
En 2018, des négociations reprennent et aboutissent à la signature de nouveaux accords, reflétant un passage de la tension à la collaboration. Alors que l’Espagne est devenue la première porte d’entrée des personnes migrantes sur le territoire européen, le Maroc se positionne en partenaire incontournable de l’UE concernant les migrations. Lors du Conseil européen du 28 juin 2018, l’UE affirme qu’elle soutiendra en particulier le Maroc, pour prévenir la « migration illégale ». Durant cette période, un nombre croissant de décès de migrants est observé, tant en mer que sur terre, reflétant l’intensification de la répression terrestre.
De juin 2019 à mars 2020, dans un contexte de relations apaisées entre le Maroc et l’Union européenne à la suite de la signature de l’accord de pêche de 2018, les tendances migratoires ont connu des changements significatifs. Les bonnes relations permettent au Maroc de mettre en place une répression importante à la frontière terrestre documentée par l’AMDH. Au cours de cette période les traversées vers les îles Canaries s’intensifient à nouveau et on observe également une augmentation des arrivées par la mer à Melilla, mais également de mort durant ces tentatives.
Début 2020, si toutes les actions du gouvernement ont été suspendues pour se concentrer sur la lutte contre le coronavirus, le contrôle des migrations et des frontières n’a connu aucune pause pendant cette période. Le contrôle très fort opéré dans le Nord du Maroc pousse les personnes souhaitant rejoindre l’Europe à emprunter la route des Canaries. Si les tensions diplomatiques ne sont pas explicites, le durcissement des contrôles à la frontière mène à de nombreux morts de migrants à la fin 2020.
En mai 2021, l’hospitalisation en Espagne de Brahim Ghali, responsable militaire sahraoui, est vécue comme une agression par le Maroc. Cette période de tensions grandissantes est marquée par une augmentation des arrivées à Melilla mais un nombre de morts moins important alors que le Maroc adopte une attitude de laisser passer.
En avril 2022, la reconnaissance par l’Espagne du plan marocain d’autonomie du Sahara met fin à la crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne. Dans ce contexte de concession espagnole, la coopération autour des migrations est rétablie entre le Maroc et l’Espagne. En découle une période avec des arrivées sporadiques, et des morts en grand nombre due à une répression d’une violence inégalée à la frontière de Melilla – dont le cas emblématique est le massacre du 24 juin 2022.
L’analyse de la période 2014-2022 montre ainsi que si les dynamiques migratoires et la répression à la frontière de Nador/Melilla sont influencées par des facteurs multiples et des interactions complexes, les rapports diplomatiques changeants entre le Maroc, l’Espagne et l’EU jouent un rôle essentiel dans les fluctuations de l’intensité de la violence à la frontière. Il nous faut maintenant analyser de manière plus détaillée la conjoncture politique changeante au cours de la phase 2021-2022, et la manière dont celle-ci s’est traduite à la frontière en une oscillation rapide entre laisser-faire (mai 2021-mars 2022) et intensification de la répression (avril 2022), culminant dans le massacre du 24 juin 2022.
Mai 2021 – mars 2022 : rupture diplomatique et passages facilités de la frontière
En mai 2021, Brahim Ghali, responsable militaire sahraoui, est admis dans un hôpital espagnol. L’argument « humanitaire » alors mis en avant par Madrid est jugé irrecevable à Rabat, qui promet que cette décision aura des « conséquences ». C’est ainsi que sont levés les contrôles frontaliers à Ceuta les 18 et 19 mai 2021, permettant l’entrée de plus de 8000 personnes, majoritairement de jeunes Marocains.

Pour répondre à ces arrivées importantes, par voie de terrestre et de maritime, le gouvernement espagnol déploie son armée et le Maroc est accusé par les autorités espagnoles d’avoir relâché son contrôle de la frontière. Mais pour les autorités marocaines, cette crise relève d’abord de la responsabilité espagnole, illustrant le bras de fer diplomatique entamé par les deux voisins. C’est un moment de rupture diplomatique entre le Maroc et l’Espagne, comme l’illustre le départ de l’ambassadrice marocaine de Madrid.
Cette rupture diplomatique va aussi influer sur le degré de répression auquel sont soumis les personnes migrantes Noires. Les années 2020-2021, marquées par la pandémie de Covid-19, ont vu une chute drastique des tentatives de passage par les frontières de Ceuta et Melilla. Malgré tout, des personnes migrantes Noires continuaient de vivre dans les campements dans la zone frontalière, comme en témoigne la tragédie d’une femme nigériane du nom de Happiness et de ses trois enfants retrouvés morts calcinés dans leur abri en janvier 2022 à Nador. À partir du mois de mars 2022, des personnes migrantes Africaines, tentent à nouveau de passer par les barrières-frontalières de Melilla.
Au mois de mars 2022, quatre tentatives de passage des barrières frontalière de Nadorr/Melilla ont lieu en une semaine : les 2, 3, 4 et 8 mars. Lorsqu’elles se produisent, les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne sont encore brouillées. L’AMDH Nador observe sur place que l’installation des migrants Noirs dans les forêts de Gourougou a pu se faire aisément en amont de ces tentatives. Voici quelques détails – basés sur les informations fournies par les autorités espagnoles – concernant ces quatre jours :
- Le 2 mars, environ 2500 personnes tentent de passer par la barrière – selon les informations de la délégation du gouvernement à Melilla. Il s’agit alors, d’après les autorités espagnoles, de la plus grande tentative jamais enregistrée. 491 personnes parviennent à entrer côté espagnol ce jour-là.

- Le lendemain, le 3 mars, une nouvelle tentative est réalisée par environ 1200 personnes, 380 d’entre elles parviennent à passer.

- Le 4 mars, environ 1000 personnes tentent encore le passage, mais cette fois aucune ne parvient à entrer.
- Le 8 mars, à nouveau environ 1000 personnes tentent le passage, 400 parviennent à entrer à Melilla.
Au total, plus de 1240 personnes parviennent à entrer à Melilla à la suite de ces quatre tentatives et la répression violente opérée par la Guardia civil est dénoncée côté espagnol. Si 31 personnes blessées sont reçues aux urgences de l’hôpital de Nador, aucun mort ou disparition n’est alors enregistrée.
Plusieurs éléments attirent l’attention quant aux circonstances de ces tentatives de passage. Comme le note l’AMDH-Nador ainsi que différents médias espagnols, les quatre tentatives se produisent en plein jour – fait rare puisqu’habituellement elles se font la nuit ou au petit matin. Ensuite, elles se produisent à chaque fois sur la même partie de la barrière-frontalière située entre les postes-frontières de Barrio Chino et Beni Ansar, qui est à ce moment-là la seule partie de la barrière-frontalière qui n’est pas encore équipée du dispositif des « peignes inversés » qui rendent le passage presque impossible.

Carte réalisée par EuropaPress indiquant où les tentatives de passage se sont produites Source : https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-1200-migrantes-participan-segundo-dia-salto-valla-melilla-consiguen-entrar-350-20220303092651.html
Par ailleurs, le nombre de personnes effectuant les tentatives est très grand. Enfin, face aux migrants, le dispositif militaire marocain déployé autour de ces tentatives de mars 2022 est peu important en comparaison avec d’autres tentatives, notamment celle du 24 juin 2022. L’ensemble de ces éléments permet de penser que le contrôle côté marocain est alors relativement permissif. En fait, Ibrahim*, un ressortissant tchadien que nous avons rencontré et qui a tenté le passage à cette époque explique : « En cas de relations tendues entre le Maroc et l’Espagne, ce sont les officiers qui nous proposent de traverser. »

Du côté espagnol, le dispositif déployé pendant ces 4 tentatives du mois de mars est au contraire très important. Les pouvoirs publics espagnols s’alarment de ces tentatives d’entrées irrégulières par les barrières qui sont les plus grandes jamais enregistrées à Melilla. La Guardia civil elle-même interpelle le Ministre de l’Intérieur pour un renforcement de leurs effectifs et de leur matériel, ainsi que pour une militarisation accrue de la frontière.
Si les autorités espagnoles sont en état d’alerte, l’AMDH-Nador note que même après les quatre tentatives de passage la situation demeure plutôt calme côté marocain de la frontière. Ceci permet l’installation de centaines de migrants dans les deux principaux campements situés en forêt dans les jours et semaines qui suivent. Mais la situation va brusquement changer à partir de la mi-avril, après le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne.
À partir d’avril 2022, réconciliation maroco-espagnole et reprise d’une répression féroce à la frontière.

Visuel pour “Madrid vient de revoir sa position de « neutralité » historique sur l’ex-colonie espagnole du Sahara Occidental, pour s’aligner sur la position marocaine.”
En avril 2022, après plus de dix mois de crise diplomatique, le Maroc et l’Espagne mettent en scène leur réconciliation et déclarent conjointement le début d’une « nouvelle étape » des relations entre les deux pays. Madrid vient de revoir sa position de « neutralité » historique sur l’ex-colonie espagnole du Sahara Occidental pour s’aligner sur la position marocaine. Pour l’Espagne, le rétablissement des relations avec le Maroc a, parmi ses buts principaux, celui de s’assurer de sa « coopération » dans le contrôle de ”l’immigration illégale”, notamment autour de Ceuta et Melilla. C’est certainement à la démonstration de cette « coopération » que vont s’enquérir les autorités marocaines : à partir d’avril 2022, la répression redevient brutale dans la région de Nador.
Alors que la répression s’intensifie à nouveau, la composition en termes de nationalité des personnes migrantes présentent dans les forêts de la région de Nador a évolué, avec une présence plus importante de personnes originaires du Soudan et du Sud Soudan. Cette plus forte prévalence est attestée par les données du UNHCR concernant les demandes d’asiles à Melilla. Alors que les personnes originaires du Soudan et du Sud Soudan ne représentaient que 0,49% des demandes en 2020, cette proportion a augmenté à 7% en 2021, et 13% en 2022, avec 411 demandes déposées.
Parmi survivants du massacre que nous avons rencontrés dans le cadre de notre enquête, nombreux sont d’origine de différentes régions du Soudan et du Sud Soudan. Si certains ont quitté le Soudan lors de différentes phases des conflits qui ont affecté le pays depuis plus de 20 ans, d’autres ont quitté le pays à la suite de la répression de la révolution de 2018, car ils étaient menacés par le régime en raison de leur engagement politique notamment au sein du mouvement estudiantin. Tous ont transité à travers la Libye, où ils ont vécu des formes de violences racistes extrêmes en détention et des tentatives de traversée de la Méditerranée avortées. Plusieurs nous ont expliqué s’être orientés vers le Maroc dans le but de demander l’asile ou de traverser vers l’Europe. Cependant, au Maroc, les Soudanais acquièrent rapidement la réputation d’un groupe plus contestataire que les autres nationaux, et donc plus difficile à contrôler, ce qui leur sera reproché pour justifier la répression dont ils ont fait l’objet (voir encadré). Un des survivants que nous avons rencontré décrits l’arrivée de Soudanais dans la région de Nador au cours du printemps 2022 comme suit :
« Récemment, de nombreux Soudanais sont venus s’installer dans différentes villes marocaines telles que Rabat, Casa etc. Au lieu de rester sans travail ici au Maroc, nous avons décidé de nous rassembler tous pour traverser les frontières. »
Mokhtada
Comme le note l’AMDH-Nador, dès la mi-avril 2022, soit dans la foulée de la réconciliation entre le Maroc et l’Espagne, les forces de l’ordre sont fortement mobilisées dans la région de Nador. « Pendant 18 jours, les attaques étaient presque quotidiennes pour essayer de déloger les migrants qui ne comprenaient pas ce revirement brusque dans le comportement des autorités marocaines, qui veulent maintenant les chasser des campements. » L’association précise qu’à la différence des périodes précédentes où seules les forces auxiliaires étaient mobilisées pour ce type d’opération, cette fois tous les corps des forces de l’ordre sont sur le terrain, sous la supervision et avec la participation personnelle du Gouverneur de Nador et des commandants de la gendarmerie et des forces auxiliaires.
D’après l’AMDH Nador, à partir du 23 mai, la répression augmente dans les forêts et des confrontations violentes entre forces de l’ordre et migrants ont lieu au niveau des campements. Les forces marocaines utilisent des gaz lacrymogènes, tandis que les migrants tentent de se défendre en lançant des pierres. De la fin mai à la mi-juin, les migrants Noirs sont traqués et arrêtés partout dans la zone. L’usage de drone est observé par les personnes réprimées. Des campements sont détruits, les biens et la nourriture sont confisqués ou brûlés par les forces de l’ordre. Au fil des jours, environ 1500 personnes migrantes se regroupent sur les hauteurs des campements de Lakhmis Akdim et Bekoya.
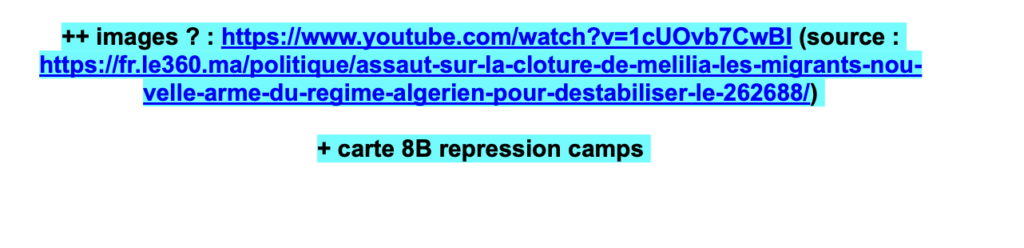

Alors que les campements de Lakhmis Akdim et Bekoya se situent à presque 20 kilomètres de la barrière de Melilla, la répression s’intensifie encore. Les autorités intiment en effet aux commerçants proches des campements de ne rien vendre aux personnes migrantes Noires – notamment de la nourriture – et organisent la coupure d’eau de la fontaine située à Bekoya où s’approvisionnait une grande partie des migrants. On voit par-là la stratégie des autorités marocaines, déjà utilisée par le passé dans des phases de répression, consistant à affamer et assoiffer les migrants pour qu’ils quittent les campements.
Le 18 juin, une nouvelle opération particulièrement virulente des forces de l’ordre a lieu. Les migrants se défendent, blessant des membres des forces de l’ordre marocaine. D’après les autorités marocaines, plusieurs membres des forces auxiliaires auraient été séquestrées, puis libérées le même jour après négociations avec les migrants.
Autodéfense des migrant·es face à une guerre menée contre eux
Des articles publiés dans les médias marocains, relayant le discours des autorités, relatent certains moments des affrontements qui ont eu lieu dans les forêts de Nador au cours des semaines/jours précédant le 24 juin 2022. Les propos tenus dans ces articles dénoncent particulièrement l’agressivité des migrants contre les forces de l’ordre, comme ce sera le cas après le massacre du 24 juin. Cependant, l’inégalité des moyens utilisés lors des affrontements ainsi que les témoignages que nous avons recueillis indiquent que les personnes migrantes se défendaient face au déploiement excessif, injustifié, et potentiellement mortel de la violence par les forces de l’ordre.
« Le matin du 23 juin, ils [les forces Morocaines] nous ont encerclés, ils étaient au sommet de la montagne, ils nous ont attaqué, on s’est défendus mais ils étaient plus nombreux que nous. » Ali Ibrahim*
« Les forces de l’ordre voulaient monter jusqu’à nous, mais de notre côté, nous avions préparé des pierres. Notre but était de nous protéger, et non d’attaquer. Je suis un homme de parole, je sais ce que je dis. Le but était de nous sauver, de faire un mouvement pour leur faire peur afin qu’ils se retirent. Nous n’avions aucune intention d’hostilité envers ces autorités. L’important pour nous était qu’ils ne nous atteignent pas. » Abderrazik*
« Les autorités étaient équipées, elles nous frappaient avec des bombes lacrymogènes. Elles ont contrôlé quasiment tout le campement. La seule chose qui nous a sauvé, c’est qu’elles se sont retrouvées à court de bombes lacrymogènes. Il y a aussi le courage des frères, qui les ont confrontés pour qu’ils cessent de nous battre et nous pourchasser. Mais les autorités ont quand même réussi à détruire l’endroit où l’on stockait la nourriture. Certains frères ont réussi à neutraliser plusieurs agents, mais nous, nous les avons ensuite remis aux autorités. C’était pacifique. » Fathi Adel*
Le fait que ces migrants, principalement soudanais, se défendent face à la répression qui les accable, amène les autorités marocaines à les appréhender non plus comme de simples migrants mais comme des soldats. Ce cadrage discursif permettra de légitimer la répression mortelle du 24 juin.
Ces affrontements violents poussent les migrants à partir de ces campements. La nuit du 18 au 19 juin, des centaines de migrants se déplacent vers la partie sud du Mont Gourougou – proche du douar d’Izenouden, à environ 6km de la barrière de Melilla. À leur arrivée dans cette zone, ils sont à nouveau attaqués par les forces de l’ordre. Amar*, un ressortissant soudanais que nous avons rencontré raconte :
« Le 18 juin, on nous a attaqué le matin dans la forêt. Il y avait 15 ou 16 véhicules de la police. Ils nous lançaient des pierres et des bâtons. Nous avons donc quitté cet endroit pour aller à la montagne de Gourougou. Nous avons marché 24 heures à pied jusqu’à ce que nos jambes aient gonflé de la marche. Nous étions très fatigués. Mais là encore, à Gourougou, beaucoup de policiers marocains sont venus. Ils étaient très nombreux, et il y avait aussi des avions en haut. Ils nous ont lancés du gaz lacrymogène, des bombes à son, des balles en caoutchouc et des pierres. Des journalistes tournaient des vidéos ou prenaient des photos. Il y a eu de nombreux blessés parmi nous. »
Les opérations de répression des forces de l’ordre vont se répéter cinq jours durant à Gourougou, jusqu’au 23 juin où la violence atteint un point culminant.
23 juin 2022, point culminant de la répression et ultimatum
Le 23 juin, les personnes réunies à Gourougou se réveillent entourées de militaires.
“Il y avait tellement de voitures de police, un nombre fou. »
Yasser*
Nous avons aperçu les voitures de police du haut de la montagne. Notre chef a demandé à un groupe de faire barrage aux soldats marocains au pied de la montagne pour les empêcher de monter jusqu’à nous. Nous étions au sommet et la mission était de descendre et d’affronter les policiers avec des pierres pour les empêcher de remonter jusqu’au reste du groupe. (…) Malgré ça, ils n’ont pas pu stopper les soldats qui avaient des boucliers. Ils avançaient et nous reculions jusqu’à ce que nous atteignions le sommet de la montagne. À leur tour, ils atteignirent la cuisine du camp et détruisirent la nourriture… Ils ont tout détruit.
Zyriab*
Il y avait des voitures militaires partout. Les militaires avaient des bâtons et des boucliers. Les chefs nous ont dit de ne pas bouger, de ne pas essayer de courir, sinon ils nous poursuivraient. La police a commencé à nous attaquer et à nous jeter des pierres – ils ont détruit tout notre stock d’eau et de nourriture – ils ont fait cela pour que nous partions”.
Amar*
Certaines personnes ont couru vers d’autres montagnes pour se sauver. C’était de la persécution. Par exemple, dix policiers poursuivaient un homme.
Abdenasser*
Le déploiement impressionnant des forces de l’ordre est confirmé par l’analyse d’images satellitaires, prises entre 10h40 et 11H05 (UTC) ce jour-là, soit 11h40-12h05 heure locale.


Lorsque les forces de l’ordre se rapprochent, des jets de pierres sont échangés entre les personnes migrantes et les forces de l’ordre, et celles-ci tirent des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Plusieurs personnes disent aussi avoir vu un avion qui pulvérisait du gaz. D’après des témoignages que nous avons collectés, de nombreuses personnes sont gravement blessées. Un groupe dans les montagnes créé son propre lieu de soins pour les blessés. Pendant ce temps, un incendie commence à se propager, ce qui est confirmé par plusieurs sources, dont les images satellitaires que nous avons analysées.


Les survivants du massacre que nous avons rencontrés estiment que l’incendie qui se produit à cet endroit de la forêt a soit été allumé directement par les autorités ou a été déclenché par les tirs de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Les herbes sèches dans ces forêts ont pu faciliter l’allumage et/ou la propagation du feu. Les migrants ont essayé d’arrêter le feu, mais ils n’y sont pas parvenus, comme nous l’explique Zyriab* :
« Les arbres étaient en feu. Ce sont sûrement les bombes lacrymogènes qui ont produit cela. Nous nous sommes ensuite réunis et avons convenu d’éteindre le feu afin qu’ils n’accusent pas les Africains et les Soudanais de mettre le feu dans la forêt. Nous avons utilisé de la terre et des branches d’arbres pour éteindre le feu, mais ça n’a pas été suffisant. »
“La police a mis le feu pour nous pousser vers la frontière”
estime Alfadil*
Les affrontements autour du campement de Gourougou durent plusieurs heures, du matin jusqu’à la fin d’après-midi, d’après les témoignages. Pendant ces opérations, six personnes sont arrêtées par les autorités marocaines, tandis qu’un groupe de migrants décide d’attraper 3 membres des forces de l’ordre, dont une femme qui est rapidement relâchée. Les migrants gardent avec eux les deux autres officiers, dans le but d’imposer des négociations pour l’arrêt de la répression par les forces de l’ordre. Zyriab*, témoin de ces évènements, raconte :
« Il y avait un vieux qui était avec nous. Il était téméraire. Quand tout le monde a reculé et a commencé à crier, lui est resté là. Il a couru vers les soldats et s’est appuyé sur une pierre et il s’est jeté sur les soldats. Tout le monde a reculé sauf lui. Quand les jeunes ont vu ce spectacle, ils ont commencé à s’encourager mutuellement. Ils ont décidé de retourner vers les soldats et les ont confrontés. Ils disaient : “Ne sommes-nous pas des hommes comme lui ?” Ils sont donc revenus pour la confrontation. Certains des soldats étaient tombés après que cette personne leur ait sauté dessus. Ils ont commencé à échanger des coups avec les soldats, jusqu’à ce qu’une grande partie d’entre eux se retire. Certains des soldats sont restés sur la montagne. Les gars ont enlevé leurs boucliers et leurs bâtons. Après une personne leur a dit : “Considérez-les comme des otages de guerre et ne le tabassez pas”. Après l’affrontement, les gaz lacrymogènes, l’avion qui filmait et le retrait des soldats, nous avons vu arriver plusieurs ambulances en bas de la montagne. Puis un des officiers s’est avancé et nous a dit qu’il voulait nous parler. Il avait un haut-parleur je crois. »
Des négociations sont ensuite faites oralement. D’après les récits de migrants présents à ce moment-là, le porte-parole marocain émet une série de conditions, à savoir que les migrants doivent leur remettre les officiers blessés ainsi que le matériel des forces marocaines qui a été saisi. Ensuite ils devront quitter les montagnes, sinon les autorités reviendront s’occuper d’eux avec des balles réelles cette fois. C’est un ultimatum qui est lancé par le porte-parole des forces de l’ordre, comme le racontent les personnes rencontrées : “Vous avez 24 heures pour partir ou nous commencerons à utiliser de vraies balles”.
L’échange des personnes « prises en otage » des deux côtés est organisé entre les autorités marocaines et le groupe de migrants dans la forêt de Gourougou. Le groupe de migrants rend également le matériel qui avait été saisi et les forces de l’ordre marocaines se retirent. Des témoins racontent la suite :
« Les autorités nous ont dit : vous avez 24 heures pour quitter les lieux. Au-delà de 24 heures, le traitement sera différent ». En même temps, il n’y avait plus de nourriture. La faim et la menace. Nous nous sommes tous retrouvés au même endroit, sur la montagne. J’ai senti qu’il y avait de la peur. La menace des autorités d’ouvrir le feu y a contribué. Sans nourriture, sans eau, il n’y avait plus de raison de rester. La nuit, il fallait marcher du coucher de soleil jusqu’au petit matin pour arriver à la frontière. »
Fathi Adel*
En fin de journée, la décision est prise parmi les migrants de partir, de changer de montagne et de se rendre sur la montagne la plus proche de la barrière. C’est ainsi après avoir vécu des semaines de persécution dans les forêts frontalières, le manque de nourriture et d’eau, l’épuisement et la peur, que plus de 2000 personnes vont se diriger vers la frontière de Melilla dans la nuit du 23 au 24 juin 2022. Cependant, plusieurs témoignages convergent dans la description d’informateurs parmi eux et du rôle clé qu’ils ont joué dans le choix du lieu et de la stratégie de passage de la frontière, qui rendront les personnes migrantes particulièrement vulnérables.
Dans les campements, des personnes enrôlées comme informatrices pour les autorités marocaines
L’enrôlement de personnes migrantes par les autorités marocaines pour informer de l’organisation interne des tentatives de passage des barrières de Melilla (et de Ceuta) est un sujet ancien. Des travaux de recherche et journalistiques ont déjà pointé cette stratégie des autorités marocaines, mais aussi espagnoles. Pendant notre enquête, plusieurs des survivants rencontrés évoquent la présence de « taupes », d’informateurs, qui étaient parmi eux dans les campements. Celles-ci auraient été enrôlés préalablement par les autorités marocaines, pour que l’organisation interne des migrants, notamment soudanais, soit divulguée. Selon les témoignages recueillis, ils ont également contribué à façonner les modalités d’organisation de la tentative de passage du 24 juin, ainsi que la répression par les forces marocaines.
Vous comprenez le mot Gawad? Quelqu’un était un mouchard… Apparemment un parmi nous balançait tout aux autorités, j’ignore sa nationalité, je ne sais pas s’il était Soudanais ou Tchadien, il savait tous nos secrets et il nous dénonçait. Il nous donnait de fausses instructions, car il nous a dit d’aller à la frontière sans l’équipement nécessaire dont nous aurons besoin aux grillages. Nous nous sommes donc retrouvés les mains vides, sans crochet, devant les grillages. Il recevait des ordres des autorités et nous les transmettait comme s’il était un allié. Je le sais car après l’attaque, j’ai vu un officier demander à ce Gawad d’identifier les organisateurs de l’attaque. Le Gawad s’est donc levé pour les désigner.
Mokhtada*
Nous nous méfions également des organisateurs et du fait que certains d’entre eux avaient reçu de l’argent des soldats. Ils ont insisté pour que nous allions à la frontière le lendemain, et après cela, nous ne les avons plus revus. Personnellement, je ne les ai pas vus à la barrière. Je ne sais pas où ils ont disparu. Lors de la tentative de traversée, nous avons trouvé certains des organisateurs en train de parler au téléphone avec les soldats. Ils étaient deux.
Abdenasser*
A la fin du massacre on ne pouvait pas lever la tête, sinon les soldats te tabassaient. Mais j’ai entendu un soldat dire à l’un d’entre nous qui lui n’était pas allongé : Pourquoi ne nous as-tu pas appelés ? Le Soudanais a répondu : je vous ai envoyé les photos sur WhatsApp. C’était un délateur parmi nous.
Zyriab*
En plus des témoignages concordants concernant une pratique documentée dans le passé, un autre élément qui semble corroborer les allégations d’informateurs enrôlés, est le haut degré de connaissance de l’organisation interne des « Soudanais » que démontrent les autorités marocaines dans leur réponse à des questions de rapporteurs des Nations Unies au sujet des évènements du 24 juin 2022.
En somme, les potentielles « taupes » auraient, selon les différents récits que nous avons collectés, incité l’ensemble des migrants à aller vers la barrière sans crochets ce jour, et de tenter le passage à travers un poste-frontière, alors que toutes les tentatives précédentes avaient été réalisées avec ces outils qui permettent d’escalader plus facilement les barrières-frontalières. Le 24 juin 2022, les personnes n’ont effectivement pas utilisé ces outils.
Nous nous sommes retrouvés sans crochets, nous avons donc dû aller à la guérite [poste-frontière]. Si nous avions des crochets, nous n’aurions pas eu besoin d’aller jusqu’à la guérite. Nous n’avons pas eu d’autre choix que d’essayer d’entrer par la porte. A la guérite, ils étaient très nombreux et ils nous attendaient, lorsque nous avons voulu passer par le portail ils nous ont encerclés et ils nous ont battus. L’idée de traverser par la guérite ne nous avait pas traversé l’esprit avant. Nous avions l’habitude de traverser les grillages, mais cette fois-ci nous avions changé le plan, soi-disant que la sécurité était renforcée autour des grillages, or c’était à la guérite que la sécurité était renforcée. C’est le Gawad qui nous a influencé, nous sommes tous venus avec des crochets. Je fais partie des anciens immigrés au Maroc, et ce sont les anciens qui commandent et qui décident de l’heure de l’attaque, des personnes qui s’occuperont de la surveillance, etc. Cet informateur était aussi un ancien. Il nous a donc proposé d’aller vers la porte, il nous a convaincus qu’ainsi tous les Soudanais traverseront.
Mokhtada*
Ainsi, de par l’influence de “mouchards”, le 24 juin les migrants se dirigent vers la barrière-frontalière sans l’équipement normalement utilisé pour la traverser, les rendant ainsi plus vulnérables. Face à eux, ils trouveront au contraire un dispositif militaire marocain renforcé le long de la frontière.
Une militarisation de la frontière renforcée avant le massacre
Si la répression exercée par les forces de l’ordre marocaines contre les campements des migrants s’est intensifiée depuis fin avril, culminant dans l’attaque contre le campement de Gourougou, notre analyse révèle également le renforcement significatif du dispositif militaire marocain le long de la frontière. En effet l’analyse d’images satellitaires des jours précédents le 24 juin révèle en plusieurs zone de la frontière une augmentation des effectifs, ainsi que la construction d’une tranchée supplémentaire.





La tranchée supplémentaire visible sur les images satellitaires est localisée dans la seule zone restante du périmètre de la barrière-frontalière autour de Melilla qui, en juin 2022, n’était pas encore équipée de “peignes inversés” et qui était ainsi une potentielle zone de passage pour les migrants. Comme nous le verrons, c’est précisément dans cette zone localisée à proximité du poste-frontière de Barrio Chino que les forces de l’ordre espagnoles seront initialement déployées le matin du 24 juin 2022.

Ce renforcement militaire que nous révélons est significatif à plusieurs égards. D’une part, il démontre que, face à des personnes migrantes ne disposant que de peu de moyens et fragilisée par des semaines de harcèlement, se dressait à la veille du 24 juin un dispositif militaire renforcé, et des forces de l’ordre qui, de par le rétablissement des rapports diplomatiques et les pressions sur le Maroc, opérait une phase de répression intense des migrants à la frontière. D’autre part, le renforcement du dispositif militaire à la veille de la tentative de traversée du 24 juin conforte l’hypothèse, formulée par plusieurs des migrants que nous avons rencontrés, de la dimension anticipée et préparée de la répression mise en œuvre côté marocain lors du massacre du 24 juin 2022. En effet, à la veille du 24 juin, le piège de Barrio Chino était tendu. L’ultimatum signifié aux migrants à Gourougou les a incités et forcés à s’y jeter.
CHAPITRE 3 : LE MASSACRE DU 24 JUIN 2022
Le 24 juin 2022, vers 4h du matin, 2000 personnes migrantes principalement de nationalité soudanaise mais aussi tchadienne, érythréenne ou encore du Cameroun et de la Guinée, quittent épuisées, affamées et assoiffées leur dernier point de campement dans les hauteurs du Mont Gourougou, et se dirigent vers la frontière cernant l’enclave sous contrôle Espagnol de Melilla. La violence qui leur est infligée par les forces de l’ordre marocaines et espagnoles ce jour-là aboutit à un véritable charnier. Les autorités marocaines ont reconnu 23 décès, mais l’Association Marocaine des Droits Humains à Nador a dénombré au moins 27 personnes tuées lors de cette journée, et plus de 70 personnes demeurent disparues jusqu’à aujourd’hui.
Malgré les nombreuses images filmées par différents acteurs et plusieurs rapports publiés par des instances officielles, des associations et des journalistes, de nombreuses questions sur le déroulement des évènements demeurent ouvertes. Elles peuvent se résumer en une seule : Comment et par qui le poste frontière de Barrio Chino a-t-il été transformé en piège mortel ? Répondre à cette question est essentiel car la demande de vérité et de justice des victimes n’a pas été entendue jusqu’aujourd’hui.
Notre analyse des évènements du 24 juin 2022 est synthétisée dans une reconstitution cartographique et vidéographique, qui croise tous les éléments de preuve auxquels nous avons pu accéder ou générer dans le cadre de notre enquête, et les inscrit dans l’espace et le temps, afin d’offrir la compréhension la plus détaillée possible de l’enchaînement des évènements, acteurs et pratiques ayant mené à la mort et la disparition de nombreuses personnes.
Visuel : Embed vidéo ici aussi ?
Notre analyse démontre que ces nombreux morts et disparus n’ont rien d’accidentel. Au contraire, les personnes migrantes ont été orientées à plusieurs reprises vers le poste-frontière de Barrio Chino, et violemment réprimées par les forces de l’ordre marocaines et espagnoles une fois piégées dans celui-ci. Nous présentons dans ce chapitre nos sources et méthodologies, ainsi que nos conclusions principales concernant le déroulement de évènements du 24 juin et les possibles violations perpétrées par les forces de l’ordre marocaines et espagnoles. Nous commençons par discuter les sources officielles concernant les évènements. Celles-ci contiennent des éléments factuels importants pour l’analyse des évènements, mais font également émerger un récit concernant la nature des évènements et les responsabilités impliquées que notre reconstitution des faits contredit fondamentalement.
Récits officiels espagnols et marocains : la dénégation d’un massacre, la criminalisation des survivants
Au lendemain du massacre, les autorités marocaines et espagnoles ont immédiatement nié leurs responsabilités et ce jusqu’à aujourd’hui. Elles ont d’abord justifié la répression au nom du maintien de l’ordre et en réponse aux ”actes de violence” des personnes migrantes, associées à des « mafias ».
Lors d’une interview, Khalid Zerouali, Wali Directeur de la Migration et de la Surveillance des Frontières au Ministère de l’Intérieur marocain déclare :
Nos services de l’ordre ont agi selon la doctrine qui est une doctrine de maintien de l’ordre. Les gens qui étaient devant eux, c’était des gens aguerris avec une formation militaire. Avec des gens qui ont fait de la guerre, des gens qui ont évolué, qui ont participé dans des zones de tension. Et donc c’est des gens qui n’étaient pas des migrants, je dirais, comme ceux qu’on a d’habitude.1test
En septembre 2022, le ministre de l’Intérieur espagnol Fernando Grande-Marlaska insiste lui aussi, devant le Congrès espagnol, sur la violence exercée par les migrants pour franchir la frontière et justifie la réponse des forces de l’ordre espagnoles et marocaines. Pour lui, « il n’y a pas eu de massacre » :
En ce qui concerne les événements qui se sont déroulés à Nador, il est clair qu’il s’agit d’un épisode de tentative violente d’entrée irrégulière, qui, comme toute violence, est évidemment injustifiable. Mais nous sommes aussi un pays démocratique qui ne peut en aucun cas accepter que sa frontière, qui est en même temps la frontière de l’Union européenne, et surtout les fonctionnaires qui la gardent et la protègent, soient attaqués de manière violente et intolérable. Lorsque cela se produit, la réponse de l’État est ferme, sereine et aussi nécessairement proportionnée. Les responsables sont identifiés, les personnes vulnérables sont protégées et l’exercice des droits et libertés de chacun est garanti
Si depuis Madrid, l’effort marocain de contrôle de la frontière de ce jour a été salué, le président de Melilla lui a dénoncé dès le lendemain le caractère “barbare” et “disproportionné” de la répression opérée par les forces marocaines.
A la suite de ces premières déclarations, différentes institutions marocaines et espagnoles ont produit des rapports concernant les évènements. Côté marocain, seul le Conseil national des droits humains (CNDH) a mené une “mission d’information”, qui a donné lieu à des conclusions préliminaires données oralement en juillet 2022, vivement critiquées par une partie de la société civile (organisations de défense des droits humains et journalistes) car ne pointant aucune responsabilité de l’État marocain.
Ce n’est qu’au mois de septembre 2023, dans un courrier de réponse à des questions soulevées par plusieurs rapporteur·es des Nations Unies sur les évènements du 24 juin 2022, que le Maroc a résumé à l’écrit, son récit des faits.
Dans leur courrier (AL MAR 2/2022), les rapporteur·es des Nations Unies font part de leur inquiétude face aux “allégations d’usage excessif et létal de la force à l’encontre de migrants d’ascendance africaine, notamment des réfugiés et des requérants d’asile, à Melilla, qui a provoqué la mort d’au moins 27 migrants et blessé des dizaines d’autres alors qu’ils traversaient la frontière entre le Maroc et l’Espagne”. Elles mentionnent également “les rapports faisant état de l’enterrement collectif des personnes tuées lors de ces incidents, ce qui risque de causer un préjudice irréversible aux victimes et à leurs familles” et rappellent que “cet incident s’inscrirait dans le cadre de cas déjà signalés de recours excessif à la force à l’encontre de migrants à la frontière hispano-marocaine, qui seraient fondés sur la discrimination raciale et entraîneraient souvent des violations du droit à la vie et du principe non dérogeable de non-refoulement”, mentionnant un précédent courrier (MAR 3/2021) adressé au Maroc.
Dans la réponse des autorités marocaines, envoyée deux mois plus tard, les onze questions soulevées par les rapporteur·es des Nations Unies sont succinctement abordées, en 10 pages, et s’appuient sur les résultats de la mission d’information menée par le Conseil national des droits de l’homme, réfutant toutes les accusations avancées, se défendant de toute violation et de tout crime quant aux évènements du 24 juin 2022.
Côté espagnol, c’est un rapport signé par le procureur général qui a été publié le 23 décembre 2022. Ce rapport est bien plus détaillé que ceux produits par les différentes instances marocaines, et contient de nombreux éléments de preuve importants ainsi que des descriptions précises de l’enchainement des évènements dans l’espace et le temps. Il a ainsi constitué une base importante pour notre contre-enquête, et nous nous y référons fréquemment dans notre reconstitution. Cependant, il contient également de nombreuses omissions, ne donne aucun tort à l’État espagnol et clôt l’enquête « faute de preuve d’un crime ».
Tant les déclarations officielles que les différents rapports produits par les autorités marocaines et espagnoles convergent en quatre arguments principaux, sur la base desquels la répression de la tentative de passage des migrants est justifiée, et la cause des morts attribuées de manière à se défausser de toute responsabilité.
Premièrement, la légitimité des agissements des forces de l’ordre, et en particulier la répression, est justifiée au nom du maintien de l’ordre et en réponse aux actes de violence des personnes migrantes.
Dans leur courrier officiel de réponse aux rapporteur·es des Nations Unies, les autorités marocaines décrivent d’emblée un “assaut” au “caractère éminemment offensif perpétré le 24 juin 2022” par :
“près de 2000 migrants, composés majoritairement de ressortissants soudanais, ayant fait montre d’une violence démesurée à l’encontre des forces de l’ordre, en utilisant des crochets métalliques, des armes blanches, des pierres et des gourdins durant leur tentative d’infiltration par la force vers le point de passage de Barrio Chino (…)” (p.3).
Face à ces migrants qualifiés d’“agressifs, violents et défiant les forces de l’ordre”, les autorités affirment que “les forces de l’ordre ont agi dans le respect absolu du principe de la nécessité et de la proportionnalité dans l’usage de la force.” (p.4)
De même, d’après le rapport du procureur général de l’Etat espagnol :
(…) les enregistrements obtenus montrent que, abstraction faite des actions des agents qui ont jeté des pierres sur les migrants à un moment précis (…), les membres de l’opération ont à tout moment maintenu un comportement proportionné à la gravité des événements qui se déroulaient, à savoir une attaque massive d’une frontière espagnole par un groupe de 700 à 800 personnes, incontrôlé, agressif et armé d’éléments de force. L’ampleur des événements justifiait amplement l’action de la police (…) Ils ont donc utilisé les moyens nécessaires et le minimum de force nécessaire pour réduire le groupe d’étrangers qui tentaient violemment d’entrer illégalement sur le territoire national.
Rapport du procureur Général de l’État Espagnol, Procédure d’Enquête n°1/2022, Madrid, 22 décembre 2022, p.29-30
Deuxièmement, les autorités marocaines et espagnoles ont attribué les décès des migrants au mouvement de foule lors de leur tentative de passage, évoquant « une avalanche » humaine et des « bousculades » mortelles.
“Il en est résulté une avalanche de centaines de personnes tentant de franchir les portes et un nombre indéterminé de migrants ont été piétinés par d’autres qui ont réussi à passer, sautant par-dessus les corps entassés devant les portes”.
Rapport du procureur Général de l’État Espagnol, Procédure d’Enquête n°1/2022, Madrid, 22 décembre 2022, p. 13
“Les décès enregistrés ont été causés par asphyxie mécanique par suffocation provoquée par la bousculade et l’agglutination du nombre important de victimes dans un espace hermétiquement clos, avec mouvement de foule en panique”.
Mission Permanente du Royaume du Maroc à Genève, “Réponse des autorités marocaines à la communication conjointe AL MAR 2/2022”, Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme, Genève, 2022, p.5
Il convient de noter ici que le terme d’ “avalanche”, utilisé par les autorités espagnoles, est à la fois déshumanisant pour les migrants et dédouanant pour les autorités. En effet, l’utilisation de ce terme qui décrit habituellement un phénomène naturel non-humains pour décrire les mouvements des personnes migrantes contribue à leur déshumanisation. Ce langage conduit également à une naturalisation de la mort des migrant·es, comme s’il s’agissait d’un phénomène aussi inéluctable que la pluie, dans lequel les politiques et les pratiques des États ne jouent aucun rôle.
Troisièmement, selon les autorités espagnoles, les forces de l’ordre espagnoles n’avait pas conscience du danger auquel étaient exposés les migrants.
Le rapport du procureur indique que les autorités espagnoles ne pouvaient pas avoir connaissance de la violence qui se déroulait côté marocain, notamment de par l’obstruction de la vision causée par l’architecture frontalière.
Depuis les différentes positions décrites ci-dessus occupées par ce groupe d’agents, il n’y avait aucune possibilité de voir ce qui se passait à l’intérieur du point de passage frontalier, en raison de l’éloignement et de l’existence d’obstacles architecturaux.”
Procureur Général de l’Etat Espagnol, Procédure d’Enquête n°1/2022, Madrid, 22 décembre 2022, p. 15
…) ils n’ont pas vu et n’ont pas pu voir l’existence de blessés et/ou de morts.
Procureur Général de l’Etat Espagnol, Procédure d’Enquête n°1/2022, Madrid, 22 décembre 2022, p. 28
Quatrièmement, les morts sont exclusivement survenues sur le territoire marocain.
Cet argument a été formulé et réitéré à plusieurs reprises par le Ministre de l’Intérieur espagnol Grande-Marlaska :
Je répète que les forces de sécurité de l’État ont agi en toute légalité, proportionnalité et nécessité, et qu’il n’y a pas eu de morts sur le territoire espagnol.
Propos du ministre de l’Intérieur espagnol Grande-Marlaska devant le Congrès, le 30 novembre 2022
Sous une forme moins explicitement territoriale, cet argument est également présent dans le rapport du procureur, qui souligne que les morts étaient sous “responsabilité” marocaines, et que les autorités espagnoles ne disposent d’aucune information de première main concernant ceux-ci :
“les seules données officielles disponibles sur les décès survenus le jour des faits et leurs causes sont celles fournies par les autorités marocaines dans le rapport précité. Ce sont les autorités marocaines qui ont eu connaissance des faits et qui disposent de toutes les preuves (corps des personnes décédées, témoins, migrants blessés, etc.), et ce sont les fonctionnaires marocains qui ont été responsables de la prise en charge et du transfert de tous les migrants, blessés et personnes décédées qui se trouvaient dans la zone.”
Rapport du procureur Général de l’État Espagnol, Procédure d’Enquête n°1/2022, Madrid, 22 décembre 2022, p. 3
Si notre enquête se réfère à aux sources officielles concernant les évènements du 24 juin 2022, en particulier le rapport du procureur espagnol qui, malgré ses manquements, est le plus précis et détaillé, nous confrontons les interprétations et allégations formulée par les autorités marocaines et espagnoles à de nombreux autres éléments de preuve. Notre reconstitution systématique des faits nous mène à réfuter chacune de ces interprétations et allégations soulignées ci-dessus. En effet nous démontrons que :
- Les forces de l’ordre espagnoles et marocaines ont réprimés de manière brutale les personnes migrantes, et cette répression n’était en aucun cas proportionnelle au danger qu’ont pu représenter les personnes migrantes en se défendant avec des bâtons ou des pierres.
- Si le mouvement des personnes migrantes à travers lequel certains ont été écrasé a bien été une des causes des décès, la cause principale des nombreux morts et disparus a été la répression par les forces de l’ordre marocaines et espagnoles.
- Les forces de l’ordre espagnoles ont bien vu le danger imminent dans lequel se trouvaient les personnes coincées dans le poste-frontière et ont été témoin de la violence brutale à laquelle elles ont été soumises ensuite par les forces marocaines.
- Bien que la majorité des morts ait bien eu lieu dans la cour sous contrôle opérationnel marocain, celle-ci est entièrement localisée sur le territoire espagnol.
Sources et méthodes de reconstitution des évènements
Pour reconstituer aussi précisément que possible le déroulement des événements du 24 juin 2022 et analyser les responsabilités impliquées, nous mobilisons tous les éléments de preuves existants, ainsi que de nouveaux éléments auxquels nous avons eu accès ou que nous avons fait émerger dans le cadre de notre enquête, dont des images satellitaires et les témoignages de plus de 30 survivants interviewés et d’autres acteurs clés. Notre approche consiste à croiser l’ensemble de ces éléments, et à inscrire les faits qu’ils font émerger aussi précisément que possible dans l’espace – via une carte de la frontière – et le temps – via une chronologie précise de la journée du 24 juin. Nous présentons ici nos sources principales, ainsi que les méthodes que nous avons utilisée pour les analyser.
Recueillir les témoignages des survivants du massacre
Lors d’enquêtes de terrain menées en 2023 des deux côtés de la frontière, nous avons collecté plus de trente témoignages de personnes survivantes du massacre du 24 juin 2022, majoritairement auprès de personnes restées au Maroc, ainsi qu’auprès de personnes ayant atteint la péninsule espagnole ou d’autres pays européens. Les entretiens au Maroc ont dû être menés avec des précautions extrêmes par l’équipe marocaine de par la très grande vulnérabilité des survivants demeurant au Maroc. Lors de ces entretiens, nous avons privilégié l’enregistrement audio, ou l’interview filmée de dos, afin de garantir l’anonymat des survivants. Dans la restitution de ces témoignages anonymes dans notre enquête, nous avons abrévié les noms et prénoms des survivants.


Nos entretiens ont suivi un questionnaire commun pour l’ensemble de nos enquêteurs et enquêtrices. Nous avons également présenté aux personnes que nous interviewions des cartes et images de la frontière, pour les aider dans le processus difficile de remémoration et de description du déroulement des faits dans l’espace et le temps.
Les récits et analyses des survivants du massacre sont une source primordiale dans la compréhension des évènements du 24 juin 2022, notamment s’agissant des moments faits occultés par diverses stratégies de dissimulation de l’information mises en place par les autorités marocaines et espagnoles. Nos entretiens ne se sont cependant pas uniquement focalisés sur leurs descriptions des faits, mais également sur leurs analyses et leurs revendications.
L’ensemble de ces entretiens, la plupart menés en arabe, a été transcrit et traduit, et les types d’évènements décrits systématiquement codés pour favoriser leur analyse. Lighthouse Reports a également généreusement partagé les transcriptions des entretiens réalisés dans le cadre de leur enquête, et nous nous référons également à eux comme une source secondaire.
Entretiens avec d’autres acteurs autour de la frontière
Nos équipes ont également mené sur le terrain des entretiens complémentaires avec d’autres acteurs clés impliqué·es à la frontière. Ceux-ci ont visé à mieux comprendre le contexte de la frontière, les pratiques des différents acteurs, et leurs éventuelles implications dans les évènements du 24 juin 2022.
Côté espagnol, ont été interviewé·es à Melilla ou ailleurs sur le territoire espagnol :
- Des agents de la Guardia civil de l’unité fixe de Melilla
- La direction de la Croix-Rouge de Melilla
- Plusieurs membres du personnel de l’hôpital de Melilla
- Un ex-travailleur de la Délégation du gouvernement espagnol à Melilla
- Des membres d’associations basées à Melilla
- Un·e avocat·e travaillant au Centre de séjour temporaire des immigrés (CETI) de Melilla
- Deux journalistes basés à Melilla ou présents le 24 juin 2022 sur place
- Des résident·es du quartier de Barrio Chino
- Le Défenseur des droits espagnol
- Un membre de l’Association Unifiée de la Guardia civil (AUGC)
- Un membre du siège national de l’Association Pro-Guardia civil (APROGC)
- L’ambassadrice du Soudan en Espagne
Notre équipe d’enquête côté espagnol s’est vue opposer des refus ou des non-réponses aux demandes d’entretien suivantes :
- Délégation du gouvernement à Melilla (sans réponse)
- Centre de séjour temporaire pour immigrants (CETI) de Melilla (refus)
- Procureur général (refus)
- Commandement de la Guardia civil à Melilla (refus, réorientation de la demande au Ministère)
- Centre d’Opération Complexe de la Guardia civil à Melilla (refus, réorientation de la demande au Ministère)
- Ministère de l’Intérieur (sans réponse)
- Secrétaire d’État et de sécurité (sans réponse)
L’équipe marocaine a mené des entretiens avec d’autres acteurs du secteur public ou associatif, souvent très craintifs vis à vis des autorités marocaines. Malgré ces conditions difficiles, ont pu être interviewé·es :
- Des membres desfamilles de morts ou disparu·es le 24 juin 2022
- Des ONGs travaillant auprès des migrants dans les régions de Nador, Berkane et Oujda
- Des membres du personnel hospitalier de Nador, Berkane et Oujda
- Des journalistes spécialistes des questions migratoires au Maroc
- Des avocats ayant été impliqués dans les procès intentés contre des survivants du 24 juin 2022
Analyse d’images vidéographiques et photographiques
Un grand nombre d’images vidéographiques et photographiques ont été produites par différents acteurs, chacun avec des intentions différentes : Contrôler les migrants pour les forces de l’ordre ; documenter les violations pour les militants des droits humains ; couvrir un évènement pour les journalistes ; ou encore humilier les personnes migrantes pour certains passants ou membres des forces de l’ordre.
Ces images ont été principalement réunies par la plateforme de journalisme Lighthouse Reports, qui a partagé cette archive avec notre enquête. Nous avons également accédé à de nouvelles images, notamment de journalistes espagnols, qui constituent des documents importants à
Images produites par des acteurs étatiques espagnols
Le procureur espagnol indique dans son rapport que les autorités espagnoles ont filmé l’ensemble des évènements de ce jour, et mentionne en particulier plus de 4h15 de tournage par un hélicoptère et un drone. Or nous n’avons eu accès qu’à deux séquences de 10 minutes au total. Par ailleurs, d’autres images produites par trois caméras de surveillance du dispositif frontalier espagnol filmant de manière continue, mais seul quelques secondes de ces images ont été rendues publiques.

Selon le rapport du procureur, la caméra de l’hélicoptère filme de 7h37 à 10h15. Les segments vidéo disponibles couvrent uniquement la période de 8h33.56 à 8.42.53. Les images auxquelles nous avons eu accès ne contiennent pas de métadonnées, mais indiquent à l’écran des coordonnées géographiques et temporelles précises.

Le drone des autorités espagnoles, filme de 8h07 à 9h35. Nous n’avons pu accéder qu’à un clip de 1 minute, sans métadonnée. Mais, en le comparant a une autre image fixe de cette source prise à 09h01 et reproduite dans le rapport du procureur, nous pouvons pu conclure que le clip en notre possession a été filmé vers 9h.


Finalement le procureur indique que 3 caméras de surveillance fixes – COC-C36 A-75, COC-C39 A-75, et COC C29 – filmaient 24h/24. Néanmoins, nous n’avons pu accéder qu’à quelques secondes de ces images, sans métadonnées.
Images produites par des acteurs étatiques marocains
Nous disposons par ailleurs d’images qui, en toute probabilité, ont été filmées par les forces de l’ordre marocaines. Celles-ci ont été diffusées de manière anonyme par des médias proche du pouvoir dans les jours suivants le 24 juin, puis publiées par des médias en ligne.
Cette évaluation de la source des images se fonde sur l’analyse de plusieurs journalistes et chercheurs marocains travaillant sur les migrations et leur contrôle depuis de nombreuses années. La pratique de diffusion anonyme d’images filmées les forces de l’ordre a été observée par le passé. Par ailleurs, les acteurs parmi les forces de l’ordre filmant les évènements sont visibles dans des images filmées depuis le coté sous contrôle espagnol de la frontière.




Ces images, assemblées dans un montage de 3.24 minutes, sans métadonnées, documentent de manière fragmentaire plusieurs étapes des évènements – de la descente des migrants de la montagne jusqu’à leur tentative de passage de la frontière. Cependant, ce montage ne contient aucune image du déchainement de coups qui leur ont été assenés. Elles tendent au contraire à souligner la violence alléguée des migrants, notamment en montrant longuement les bâtons qui leur ont servi de moyens de défense.

Images filmées par des journalistes espagnols
Les sources non-étatiques d’images que nous avons analysées et utilisées pour notre reconstitution des faits sont nombreuses. Parmi les sources essentielles figurent les images filmées par deux journalistes espagnols, Javier Angosto et Javier Bernardo. Ces journalistes, présents à Melilla ce jour-là, ont tous deux documenté dans plusieurs séquences vidéo comprenant des métadonnées et filmées depuis le côté espagnol de la frontière, les coups qui ont été assenés aux migrants par les agents espagnols et marocains. Ces images documentent également la manière dont ceux-ci ont collaboré avec les forces de l’ordre marocaines pour mettre en place le refoulement de toutes les personnes interceptées.

Images filmées par une journaliste marocaine
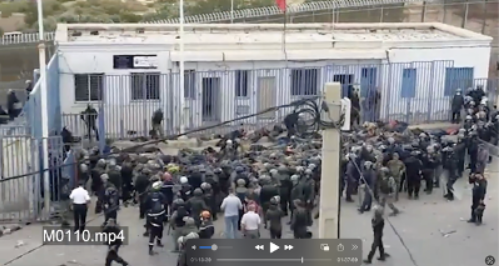
Des journalistes marocains étaient également sur place, dont une journaliste qui, en début d‘après-midi du 24 juin, a filmé et diffusées en temps réel sur la page Facebook de ArdBladi Press avec son téléphone portable 28 minutes d’images. Celles-ci montrent le charnier formé dans la cour de Barrio Chino sous contrôle marocain et dans la rue.
Images publiées par les militant·es la section Nador de l’AMDH
Les militant·es des droits humains de la section Nador de l’AMDH ont publié des vidéos documentant les évènements à différents moments pendant la journée. Les images publiée sur les réseaux sociaux ne contiennent pas de métadonnées, celles qui selon notre analyse ont été filmées vers 12h00 (heure espagnole), soit la fin de la phase la plus intense du massacre, documentent le traitement brutal des migrants aux mains des forces de l’ordre marocaines, les nombreux blessés ensanglantés et l’entassement des corps des personnes migrantes, mortes ou vivantes, formant un véritable charnier. Si la diffusion de ces images profondément choquantes a permis d’attirer temporairement l’attention internationale sur ce massacre, nous les utilisons ici avec des caches afin de protéger l’identité et la dignité des victimes.
Images manquantes et violence des images
L’ensemble de l’archive formée par ces différentes images constitue une source de preuves essentielles pour comprendre le déroulement des évènements du 24 juin 2022. Cependant, ces images font émerger des problèmes d’ordre méthodologique mais également éthique et politique.
Au niveau méthodologique, comme nous l’avons indiqué, seules certaines de ces images comportent des métadonnées permettant de les localiser précisément dans le temps. Malgré cette difficulté, comme nous le discuterons plus loin, en procédant par recoupement avec d’autres éléments de preuve ou en analysant spatialement les images, il nous a été possible de les organiser chronologiquement avec divers degrés de précision. Ce processus nous a également permis d’identifier des images manquantes concernant une partie essentielle des évènements. Ceci est en particulier le cas pour les images filmées par les autorités espagnoles, dont seulement 9 minutes ont été accessibles, alors qu’elles affirment avoir filmé l’ensemble des évènements le 24 juin. Ainsi, malgré la profusion d’images produites et diffusées, nous ne disposons d’aucune image documentant le point culminant du massacre, entre 9h44 et environ 12h00. Nous soulignons cette dissimulation – paradoxalement rendue moins aisément perceptible par la profusion d’images et l’impression de documentation totalisante des faits qui en résultait. C’est à travers les témoignages des survivants ainsi que l’analyse spatiale, que nous tentons de rendre compte de la part la plus sombre des évènements qui est demeurée jusqu’alors invisible et inintelligible.
Mais si la dissimulation de la violence limite la recherche de la vérité et la reconnaissance du crime, la diffusion d’images révélant de manière spectaculaire la violence brutale et raciste à la frontière pose également de nombreuses questions éthiques et politiques, que nous avons évoquées dans l’introduction.
Tout d’abord, il est important de noter que la production de ces images n’est pas extérieure de la violence qu’elles documentent. Ceci est particulièrement le cas pour les images produites par les acteurs étatiques. Les personnes migrantes ont été capturées par les images produites par leur drone, hélicoptères et autres moyens de surveillance, et ces images ont servi de moyens opérationnels pour faciliter la capture de leur corps par les forces de l’ordre. Il est ainsi essentiel de problématiser le rôle de la production des images dans la production de la violence lors du massacre du 24 juin.
Nous sommes par ailleurs sensibles au risque que la diffusion d’images documentant la déshumanisation extrême de personnes Noires puisse reproduire et banaliser celle-ci. Entre la diffusion a-critique de ces images et leur dissimulation, il existe cependant un vaste spectre qui a été exploré par différents artistes et théoriciens de l’image. Nous nous en inspirons pour créer une distance critique permettant d’interroger ces images. En adaptant le « regard désobéissant » que Border Forensics a développé au cours de ses enquêtes, nous tentons de rendre visible la violence et la responsabilité des États, tout en protégeant l’identité des personnes et en respectant leur dignité en cachant certaines portions de celles-ci. En cela, nous nous inspirons également des études Noires et des artistes Noirs qui ont mobilisé la pratique de la censure (“redaction”) de manière critique. Si la censure est souvent utilisée par les États dans le but de soustraire des informations à l’examen du public, elle peut également être mobilisée par des acteurs non-étatiques pour protéger le “droit à l’opacité” des sujets subalternes.
Finalement, les images des évènements du 24 juin ont été prises – puis diffusées – sans que les personnes migrantes aient donné leur consentement. Lors de nos entretiens avec elles, nous avons systématiquement évoqué ces images et leur diffusion, pour que ceux-ci puissent reprendre le contrôle de celles-ci et influer les choix concernant leur utilisation. Bien que ces images soient douloureuses pour les survivants, ceux-ci ont de manière unanime souhaité qu’elles soient vues, afin que la violence qu’ils ont subie soit reconnue et leur demande de justice entendue.
Analyse d’une image satellitaire

Nous avons également accédé à une image satellitaire documentant les évènements à la frontière le 24 juin. Prise a 12h17 heure espagnole, soit vers la fin de la phase la plus intense du massacre, elle révèle d’une part l’ampleur du dispositif militaire déployé le 24 juin pour réprimer la tentative de passage des personnes migrantes. Les zones plus sombres du sol de la cour marocaine et de la rue en dehors du poste-frontière révèlent de manière floue la présence des corps entassés, le contour précis de chacune des personnes qui git ici dans une zone d’indistinction entre la vie et la mort étant en dessous du seuil de résolution de cette image.
Analyser le dispositif matériel de la barrière-frontalière et du poste-frontière de Barrio Chino
Le massacre du 24 juin a été perpétré à l’intérieur du poste-frontière de Barrio Chino, mais aussi en partie à travers celui-ci, c’est à dire en le transformant en un piège mortel à travers la combinaison de la répression exercée par les forces de l’ordre d’une part, et de son architecture d’autre part. L’analyse de l’architecture du poste-frontière a donc a été essentielle à notre contre-enquête. Pour cela, nous nous sommes basés sur plusieurs éléments.
Nos enquêteurs et enquêtrices, ainsi que la journaliste Alicia Martínez, basée à Melilla au moment des faits, ont documenté et analysé le dispositif matériel de la barrière-frontalière, ainsi que son évolution dans temps.

Membre de l'équipe espagnole d'enquête à Melilla, mai 2023La recherche menée pour notre enquête par l’architecte Antonio Giraldes Lopez, a par ailleurs révélé la létalité du poste-frontière de Barrio Chino à plusieurs reprises de par le passé.
Par ailleurs, le rapport du procureur espagnol contient un dessin précis du post frontière.
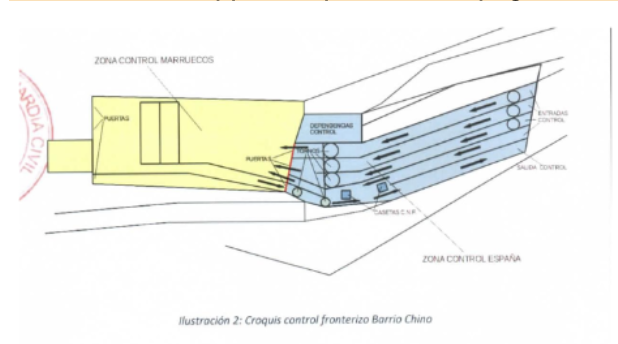
Finalement, Lighthouse Reports a partagé sa modélisation 3D du poste-frontière avec notre enquête. Celle-ci s’est révélée essentiel pour analyser ce que les forces de l’ordre espagnoles ont vu à travers le poste-frontière, et prouver qu’elles ont bien été témoins du massacre perpétré dans la cour sous contrôle opérationnel marocain, contrairement à ce qu’a conclu le rapport du procureur espagnol.
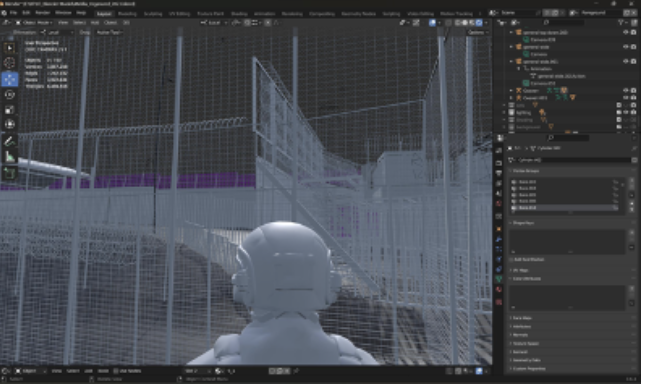
Croiser et spatialiser les données pour reconstituer l’enchaînement des évènements
Rapports officiels et associatifs, témoignages des survivants et entretiens avec d’autres acteurs, images photographiques, vidéographiques et satellitaires, cartographie et modélisation du poste frontière de Barrio Chino ont constitué les éléments de preuve fondamentaux à partir desquels nous avons reconstitué les évènements, auxquels nous avons encore ajouté d’autres sources secondaires tels que des articles de presse.
Si ces éléments constituaient les pièces fragmentaires d’un puzzle, nous avons procédé de manière systématique pour les assembler, et produire ainsi la reconstruction la plus complète et précise possible des évènements. Notre approche dans l’assemblage de ces éléments disparate a été chronologique et spatiale. Nous avons commencé par rassembler tous les éléments offrant des références temporelles et spatiales précises – le rapport du procureur espagnol en particulier, ainsi que les images dont les fichiers contenaient des métadonnées. Ces éléments ont constitué les jalons de l’enchainement des évènements. Sur la base de ces marqueurs temporels et spatiaux, nous avons pu inscrire dans notre chronologie les autres éléments de preuve – les images ne contenant pas de métadonnées, les témoignages des survivants ainsi que les autres éléments.
L’analyse fine des images a été essentielle pour les inscrire dans le temps – par exemple en analysant la projection d’ombre sur le sol selon la méthode développée par Forensic Architecture – mais aussi dans l’espace. Partant des images et de la cartographie de la zone de la frontière, nos architectes ont utilisé différents outils pour inscrire le point de vue des acteurs ayant produit les images dans l’espace, et indiquer les limites du champ de vision des images qu’ils ont produites. En retour, en analysant les éléments révélés par ces images, nous avons pu cartographier la présence des acteurs.
Visualisation notre méthode: recoupement + analyse spatiale et temporelles. (avec des examples de Nico)
En croisant ces sources de données multiples, et à travers le processus systématique de leur inscription dans le temps et l’espace, nous avons reconstruit, aussi précisément que possible, l’enchaînement des évènements ayant abouti au charnier devant le poste-frontière de Barrio Chino et avons pu analyser l’implication des forces de l’ordre tant marocaines qu’espagnoles dans la violence et les violations qui ont été infligées aux personnes migrantes.
Notre approche systématique et les nouveaux éléments apportés par notre contre-enquête permettent d’approfondir nettement la connaissance des circonstances de la production de la violence le 24 juin 2022 et d’affiner la compréhension des responsabilités afférentes aux autorités espagnoles et marocaines.
Ce que révèle notre contre-enquête
Résumé chronologique des évènements du 24 juin 2022
Notre reconstruction vidéographique restitue de manière détaillée l’enchainement des évènements dans le temps et l’espace, que nous pouvons résumer comme suit.
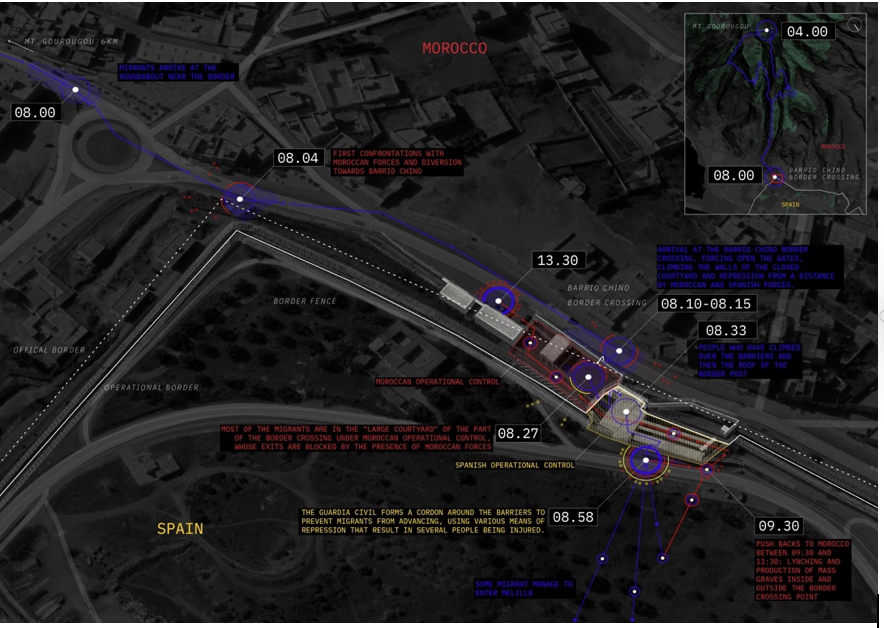
04:00
départ du groupe d’environ 2000 personnes des montagnes de Gourougou, qui pourra marcher 6km jusqu’à la frontière sans être arrêté
Pendant cette journée, selon le rapport du procureur espagnol, sur les près de 2000 personnes qui ont tenté de traverser la barrière-frontalière, seules 134 ont réussi à entrer à Melilla pour demander l’asile. 470 personnes ont été refoulées par les agents espagnols et marocains après avoir traversé la barrière-frontalière. La violence infligée aux personnes migrantes par les forces de l’ordre marocaines et espagnoles a mené à 23 décès reconnus par les autorités marocaines, 27 selon l’AMDH, alors que 70 personnes demeurent disparues jusqu’à aujourd’hui.
Confrontations aux discours officiels, et nouvelles conclusions
Notre analyse contredit fondamentalement la reconstruction des évènements, interprétations et justifications fournies par les autorités espagnoles et marocaines. Alors que les discours officiels espagnols et marocains affirment que ce sont la belligérance des migrants eux-mêmes qui a rendu nécessaire la répression et leur bousculade à l’intérieur du poste-frontière qui auraient causé la mort ce jour, et alors que les autorités espagnoles tentent de se dédouaner de toute responsabilité en arguant de l’invisibilité ce qui se déroulait dans la cour sous contrôle opérationnel marocain et qu’aucun mort ne soit survenue en territoire espagnol, notre contre-enquête réfute chacune de ces allégation. Nous révélons les pratiques ayant mené au massacre et les responsabilités impliquées sous une lumière nouvelle.
La préparation d’un piège
Plusieurs éléments de preuve que nous avons analysés indiquent que le massacre du 24 juin 2022 relève du guet-apens, dans la mesure ou la tentative de passage a été suscitée et la répression planifiée à l’avance côté marocain.
Dans le chapitre précédent, nous avons montré que la présence, dans les campements, de “taupes” collaborant avec les autorités marocaines a influencé les migrants dans leurs modalités de tentative de passage, les rendant plus vulnérables. Face à eux, se dressait au contraire un dispositif militaire renforcé aux cours des jours précédents le 24 juin. Ces deux éléments, ainsi que la répression opérée les jours précédents et l’ultimatum donné le 23 juin par les forces marocaines, indiquent un degré de préparation, voire de préméditation de la répression des migrants avant le 24 juin. Le jour-même, les forces marocaines ont laissé les migrants arrivés jusqu’à la zone-frontière, puis les migrants ont été acculés et orientés vers Barrio Chino. Les survivants eux-mêmes se décrivent leur entrée dans la cour de Barrio Chino sous contrôle opérationnel marocain comme l’arrivée dans un “piège”.
La répression étatique comme facteur principal de mort
Les morts sont dues à trois facteurs directs principaux, comme le résume l’un des survivants : « Il y avait trois grands facteurs de morts : le gaz, la bousculade et les coups. Les coups ont causé plus de dégâts que la bousculade. » La répression brutale, inhumaine et dégradante, et au-delà de toute proportionnalité, opérée par les forces de l’ordre marocaines et espagnoles, a joué un rôle essentiel dans chacune de ces causes directes. Les forces de l’ordre marocaines et espagnoles ont ciblé les migrants de manière indiscriminée avec des pierres, des bombes lacrymogènes, ainsi que des balles en caoutchouc alors qu’ils étaient maintenus dans un espace clos, ce qui est en contradiction flagrante avec les normes internationales régissant l’utilisation de matériel anti-émeute. Cette répression a clairement contribué à la bousculade des migrants à travers la porte donnant sur le côté sous contrôle espagnole du post frontière et contribué aux décès à ce moment des faits. De plus, et bien que de par l’opacité qui entoure la gestion des corps des personnes décédées (que nous discutons dans le prochain chapitre) il ne soit pas possible de comptabiliser et d’attribuer une proportion précise à ces différentes sources de mort, il apparait des témoignages que la majorité de décès sont le produit direct de la répression physique extrême opérée par des membres des forces marocaines qui ont systématiquement battu les migrants restés à l’intérieur du poste-frontière et ceux qui ont été refoulés par les forces espagnoles. Cette phase, la plus intense du massacre, qui a duré près de 3 heures, a été sciemment occultée par les images et les récits officiels, et était jusqu’à aujourd’hui demeuré invisible et inintelligible.
Le racisme moteur de la violence des deux côtés de la frontière
Des enregistrements de propos des forces de l’ordre marocaines révèlent également le racisme et la déshumanisation dont les personnes migrantes ont fait l’objet, ainsi que la volonté délibérée de les faire souffrir voire mourir. Les propos des pilotes de la Guardia civil et des autorités espagnoles face aux images prises par elles-mêmes lors des évènements se déroulant dans le poste-frontière révèle aussi le racisme et la déshumanisation qu’ils opèrent : la violence déployée contre les migrants et le danger qu’ils encourent leur semble banal, et c’est ainsi que sera justifié leur non-intervention pour empêcher la suite du massacre.
La violence de l’inaction, malgré la connaissance du danger
Un facteur indirect crucial dans les causes des morts produites, est la logique de non-intervention des autorités espagnoles face aux risques imminents de mort des personnes migrantes dans les mouvements de foule et sous les coups des forces marocaines. Si les forces espagnoles ont participé à la violence directe en blessant elles aussi des personnes et en les traitant de manière inhumaine et dégradante, elles ont également contribué à la violence des forces marocaines, en refoulant indistinctement les migrants, tous blessés, vers le coté sous contrôle marocain de la frontière, sachant pertinemment quel sort leur serait réservé. Finalement, nous démontrons que les forces de l’ordre ont bien vu à travers la barrière et à travers les images filmées le déchainement de violence dans la cour sous contrôle opérationnel marocain.
Des morts sous double juridiction marocaine et espagnole
Bien que la majorité des morts ait bien eu lieu dans la cour de Barrio Chino sous contrôle opérationnel marocain, nous démontrons que celle-ci est localisée sur le territoire souverain espagnol. Bien que l’Espagne puisse permettre au Maroc de contrôler certaines parties de son territoire, elle ne peut légalement renoncer à ses obligations légales sur ces parties. Par conséquent, l’Espagne a l’obligation de veiller à ce que les normes juridiques soient appliquées et protégées. Dans le même temps, en raison du contrôle opérationnel exercé par le Maroc sur l’espace de la cours de Barrio Chino par le biais de son accord avec l’Espagne et des actes de ses agents, le Maroc a également une juridiction et des obligations juridiques. Ainsi, l’Espagne et le Maroc ont tous deux l’obligation légale de ne pas violer, mais aussi d’empêcher la violation par d’autres acteurs de plusieurs normes légales, et les deux juridictions s’appliquent simultanément.
Violations des droits et des lois
À la suite de précédentes investigations, notre analyse des évènements suggère de nouveaux types de violences et violations de droits et de lois.
Plusieurs organisations telles que l’AMDH-Nador, Amnesty International et IRIDIA, ont, sur la base de leurs enquêtes sur les faits du 24 juin 2022 dressé une liste des potentielles violations de droit et de lois tant aux niveaux nationaux marocain et espagnol, qu’au niveau international. La responsabilité de l’Union européenne a aussi été adressée.
Les organisations susmentionnées ont mis en évidence un certain nombre de violations principales, qui s’appliquent pour la plupart à la fois à l’Espagne et au Maroc. Les faits établis par cette enquête – et les façons spécifiques dont l’enquête remet en question les récits officiels – indiquent prima facie des cas de violation de toutes les obligations suivantes par l’Espagne et le Maroc :
La première série de violations concerne l’usage létal de la force par les forces espagnoles et marocaines, en violation des règles de base sur l’usage de la force par l’Etat – en termes de matériel et de tactique utilisés, la force devant être nécessaire, proportionnée et poursuivre un but légitime afin d’être légale. L’utilisation d’une force illégale indique généralement des violations de l’interdiction de la torture, des traitements inhumains, cruels et dégradants, ainsi que des violations potentielles du droit à la vie.
Le droit à la vie et l’interdiction de la torture, des traitements inhumains, cruels et dégradants impliquent l’obligation de protéger la vie et de prévenir la torture et/ou les mauvais traitements des personnes relevant de la juridiction d’un État, ainsi que de fournir une assistance médicale d’urgence en temps utile.
Une autre série d’obligations est celle d’enquêter sur les situations où il semble y avoir eu des pertes de vies humaines ou des mauvais traitements, ou lorsque des personnes ont disparu. Ces obligations comprennent celle de tenir les victimes et les familles impliquées et informées. L’enquête actuelle vient en réponse et en atténuation des échecs et refus continus de l’Espagne et du Maroc de se conformer à ces obligations d’enquête, et de clarifier les circonstances dans lesquelles tant de personnes sont mortes, ont été blessées, ont disparu et/ou ont été expulsées. Bien que la charge de l’enquête ne doive pas incomber à la société civile (qui dispose de moyens beaucoup plus limités que les États), les résultats de l’enquête actuelle mettent en évidence le manque de volonté de l’État de faire la lumière sur ces événements, compte tenu des moyens beaucoup plus importants et de l’accès aux preuves dont disposeraient les acteurs de l’État.
En ce qui concerne l’Espagne en particulier, l’enquête a révélé d’autres violations du principe de non-refoulement et de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains, cruels et dégradants, qui interdisent à un État d’expulser des personnes lorsque cela les exposerait à un risque d’être tuées ou maltraitées. Une obligation connexe consiste à identifier et à examiner la situation individuelle de chaque personne avant de l’expulser, en vertu de l’interdiction de l’expulsion collective, mais aussi d’obligations supplémentaires, par exemple au titre de la convention relative aux droits de l’enfant.
Cette enquête indique prima facie que tous ces principes fondamentaux des droits humains ont été violés à la fois par l’Espagne et par le Maroc. Toutes ces obligations sont conditionnées par un principe fondateur, à savoir la reconnaissance des personnes en tant que titulaires de droits, en vertu du droit à la personnalité juridique, ce qui est compromis par le régime frontalier en place à Ceuta et Melilla, comme nous l’avons vu au chapitre 1.
Au-delà du droit international des droits de l’homme, le traitement des migrants à Melilla pourrait également être analysé sous l’angle du droit pénal international, qui sanctionne les violations les plus graves commises à l’encontre des civils. En particulier, le rapport a documenté des dégradants et inhumains, qui peuvent constituer des actes de torture, qui sont tous criminalisés par le droit international coutumier et le Statut de Rome. L’Espagne est un État partie au Statut de Rome. Alors que le Maroc n’est pas partie au Statut de Rome, les tribunaux nationaux des États tiers peuvent être compétents pour juger ce crime en vertu de la compétence universelle.
L’interdiction de l’apartheid est particulièrement pertinente, tant dans le cadre de la législation sur les droits de l’homme que dans celui du droit pénal international. Selon la convention sur l’apartheid, il s’agit d’”actes inhumains commis dans le but d’établir et de maintenir la domination d’un groupe racial de personnes sur tout autre groupe racial de personnes et d’opprimer systématiquement ces dernières”. Selon le Statut de Rome, “le crime d’apartheid s’entend d’actes inhumains de caractère analogue à ceux visés au paragraphe 1, commis dans le contexte d’un régime institutionnalisé d’oppression et de domination systématiques d’un groupe racial sur un ou plusieurs autres groupes raciaux, et commis dans l’intention de maintenir ce régime”.
Par le passé, plusieurs commentateurs ont mis en garde contre l’émergence d’un “apartheid mondial”, ciblant les populations migrantes par le biais de politiques migratoires restrictives et discriminatoires et de contrôles aux frontières. Récemment, dans le cadre de son mandat de Rapporteur Spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, Philip Alston a mis en garde contre un scénario d’”apartheid climatique”, dans lequel “les riches paient pour échapper à la surchauffe, à la faim et aux conflits, tandis que le reste du monde est laissé à l’abandon”. Tendayi Achiume, au cours de son mandat de Rapporteur Spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance, a développé une critique des frontières en tant qu’instrument de domination raciale. Cependant, malgré ces analyses importantes, dont nous nous inspirons ici, le cadre de l’apartheid n’a pas été suffisamment analysé « par le bas ». Ce rapport montre que le risque d’apartheid dû à des régimes frontaliers violents n’est pas seulement un risque théorique concernant le débat sur la nature des frontières. L’apartheid est une catégorie juridique spécifique qui peut s’appliquer dans la zone particulière sur laquelle nous nous concentrons dans ce rapport – la zone frontalière de Nador/Melilla, et plus particulièrement le poste frontière de Barrio Chino qui a été transformé en piège mortel le 24 juin 2022.
Dans cette zone frontalière, qui a une définition spatiale identifiable même si elle n’est pas stricte, la violence est utilisée pour maintenir un régime de domination raciale. Comme nous l’avons souligné, les portes d’entrée “normales” de l’enclave de Melilla sont en pratique inaccessibles pour les personnes Noires, un aspect de la violence frontalière qui met en évidence la dimension de la domination raciale constitutive de l’apartheid. Si le passage de la frontière est ici le point focal de la domination raciale, celle-ci se propage en cercles concentriques, à des degrés d’intensité différents, dans la zone entourant la frontière. L’émergence de campements informels dans lesquels résident exclusivement des migrants Noirs, tels que Gourougou, est un autre aspect de la séparation physique qui s’est développée dans ce contexte. Le ciblage spécifique des migrants noirs à la frontière les oblige à tenter de franchir les barrières, où ils risquent de subir des violences brutales et mortelles de la part des forces de l’ordre. Les renvois à chaud qui ciblent les migrants Noirs, effectués avec des équipements anti-émeutes et par l’imposition de la douleur, sont un aspect de la même situation de domination raciale.
Les éléments qui ont rendu possible cette violence frontalière comprennent des aspects de la diplomatie maroco-espagnole ainsi qu’une impunité bien ancrée. En termes d’analyse juridique de l’apartheid, les éléments importants sont à la fois la séparation raciale et l’utilisation continue de pratiques violentes illégales pour la maintenir, telles que les actes de torture et les meurtres. L’espace dans lequel ce régime d’apartheid est maintenu se situe des deux côtés de la frontière entre l’Espagne et le Maroc, où une violence extrême est appliquée à l’égard d’un groupe identifiable – les personnes migrantes Noires dont la mobilité est illégalisée.
Une autre composante essentielle d’un système d’apartheid est l’intention de maintenir la domination raciale. Dans le contexte de la frontière Nador/Melilla, l’intention peut être déduite des pratiques récurrentes de violence à la frontière, consolidées au cours des 30 dernières années, et qui ciblent spécifiquement les migrants Noirs et les expose de manière disproportionnée au risque de mort, comme nous l’avons démontré dans ce rapport. Ces pratiques, exercées par les forces de l’ordre des deux côtés de la frontière, indiquent qu’ils partagent l’aspect mental d’une intention d’imposer une domination sur ce groupe spécifique de migrants. Ceci est particulièrement clair dans les relations diplomatiques qui ont débuté en avril 2022, et leur influence immédiate sur les pratiques de maintien de l’ordre violentes et racistes observés sur le terrain par la suite, qui ont culminé avec le massacre du 24 juin.
En d’autres termes, ce rapport a identifié un espace transfrontalier dans lequel l’apartheid a été imposé, en collaboration entre les forces de l’ordre espagnoles et marocaines.
À cette liste de violations non-exhaustives concernant les faits du 24 juin 2022, doit s’ajouter celles commises après. En effet, loin de s’être arrêtée, la violence contre les personnes migrantes rescapées du massacre a continué, de bien des manières et jusqu’à aujourd’hui. C’est ce que nous documentons dans le dernier chapitre de ce rapport.
CHAPITRE 4 : APRÈS LE 24 JUIN 2022, LA VIOLENCE CONTINUE PAR D’AUTRES MOYENS
La diffusion par l’AMDH-Nador sur les réseaux sociaux d’images montrant un véritable charnier formé à la suite de la répression de la tentative de passage du 24 juin 2024 a engendré de vives réactions dans les jours qui ont suivi. Cependant, comme nous l’avons vu, malgré ces images accablantes les autorités marocaines et espagnoles ont nié toute responsabilité. L’Union Européenne n’a pas non plus mis en cause les agissements des forces de l’ordre, ou sa politique d’externalisation. Au contraire, le 8 juillet 2022, moins de deux semaines après le massacre, la Commission européenne a annoncé un « partenariat rénové » avec le Maroc en matière de migration et de lutte contre les réseaux de trafic de personnes. Le mois suivant, l’Union européenne a communiqué au sujet d’un paquet financier de 500 000 millions d’euros qu’elle verserait au Maroc pour son labeur de contrôle des frontières européennes, augmentant alors de près de 50 % l’aide accordée à Rabat pour lutter contre l’immigration dite irrégulière. Ces annonces interviennent alors que les enquêtes judiciaires quant au massacre du 24 juin n’ont pas encore été menées. Cet accroissement de l’aide de l’UE à la suite du massacre envoie un signal fort et sans ambiguïtés tant aux autorités marocaines qu’espagnoles : aucun coût humain n’est trop élevé lorsqu’il s’agit de contrôler les frontières de l’UE.
Tout comme nous avons montré que la violence spectaculaire du 24 juin s’inscrit dans un continuum de violence subie par les personnes Noires à la frontière depuis plus de 30 ans, le déni de reconnaissance du crime qui a été commis, et le refus de reconnaître ceux responsables, perpétuent après les faits la violence qui a été infligées aux personnes migrantes le 24 juin 2022. Ce dernier chapitre analyse les différentes formes de violence qui ont continué d’affecter les rescapé·es après le massacre du 24 juin. En particulier, il revient sur les déplacements forcés qui ont été organisés par les autorités marocaines juste après la tuerie et l’entrave à l’accès aux hôpitaux et services de santé pour certains des survivants blessés. Il aborde la question de la gestion opaque des cadavres issus du massacre et l’obstruction des possibilités d’identification et de recherche des morts et disparus par les familles des victimes, rendant impossible le deuil pour celles-ci. Il met en lumière également l’acharnement judiciaire vécus par des dizaines de survivants qui se trouvent aujourd’hui dans des geôles marocaines. Dans ce sens, la violence du 24 juin continue d’engendrer de la souffrance pour les victimes et leurs familles.
Dans l’immédiat post-massacre
L’après-midi du 24 juin 2022, une fois l’ensemble des personnes survivantes immobilisées par les forces marocaines devant le poste-frontière de Barrio-Chino, l’organisation des déplacements forcés a commencé. Ce processus a essentiellement été documenté par l’ADMH-Nador et nos entretiens avec des survivants renseignent également la violence tant physique que symbolique qui s’est poursuivie, durant l’embarquement des personnes dans des bus, mais aussi pendant les trajets et à l’arrivée dans différentes villes aux quatre coins du Maroc.
Déplacements forcés par bus, nouvelles violences et mort(s)
Je me souviens d’un soldat quand j’étais allongé sur le sol. Avant qu’ils ne me mettent dans le bus, il est monté sur moi. C’était un gars lourd. Même si j’étais inconscient, j’ai senti ses pas sur moi, je ne pouvais pas bouger. Il a sauté sur mon corps puis est descendu, puis il a craché sur moi. Je ne pouvais pas parler. Comme si ton corps a perdu toutes ses capacités d’agir. Tu comprends ? J’avais des maux partout dans le corps. Les frappes ont beaucoup affecté mon corps. Tu ne pouvais rien faire. Tu ne pouvais que te taire et les laisser faire ce qu’ils voulaient faire. Ils ont commencé à frapper les gens. (…) Si je pouvais marcher j’allais m’enfuir. Deux personnes m’ont tenu par les deux mains pour me mettre dans l’autobus. En passant par la porte, la même personne m’a encore frappé. Il m’a attrapé par les cheveux et frappé par coups de poing. Je te jure. Quand ils m’ont mis dans l’autobus, j’ai ouvert un peu mes yeux après une demi-heure, et j’ai vu des personnes très fatiguées. Je te jure qu’il y avait des personnes qui te frappaient quand tu montes dans l’autobus. Il y avait une personne que ne faisait que frapper les gars sur leur tête. Les gars se souviennent de lui. (…) Ils ont mis beaucoup de personnes dans l’autobus. Il y avait aussi des personnes très blessées, des personnes avec des fractures. Le sang coulait de partout, mais ils ne nous ont pas emmenés à l’hôpital ou quoi que ce soit. Ils nous ont mis dans le bus. Et quand tu montes dans le bus, ils te menottent. Certaines personnes ont failli en mourir. Quand ils vous ligotent et que vous essayez de bouger, le sang dans vos artères s’arrête. Ils nous ont ligoté avec un type de plastique noir robuste, ils serraient très fort. Tout le monde était épuisé et ne pouvait pas s’échapper après ce qui s’est passé, alors on ne comprenait pas pourquoi ils serraient si fort. On leurs a dit : ‘est-ce que vous voulez qu’on meure ?’ Dans notre autobus, il y avait des personnes grièvement blessées. Il y avait une personne qui était blessée à la tête, elle avait du sang partout et allait mourir.
Abderrazik*, 17 ans, Soudanais, demandeur d’asile, rescapé du 24 juin 2022.
Dans le bus nous avions les mains attachées derrière le dos. J’ai toujours les traces sur les bras. C’était tellement serré. Je ne sentais plus mes doigts. Il y en avait dans le bus qui avaient des fractures et ils suppliaient les agents de desserrer. Je voulais couper mes doigts. J’étais persuadé que si ça continuait ainsi, je pouvais mourir.
Fathi Adel*, 18 ans, Soudanais, demandeur d’asile, rescapé du 24 juin 2022
Il y avait des blessés graves, comme l’un de mes amis, originaire du Darfour. Il a perdu un de ses yeux et aussi ses dents le 24 juin. Il y avait aussi d’autres cas de personnes en danger qu’ils ont mis dans les bus avec nous.
Mohamed* 26 ans, Soudanais, demandeur d’asile, rescapé du 24 juin 2022
D’après l’AMDH-Nador, seule ONG présente ce jour-là à Nador, c’est à partir de 16h que plusieurs centaines de personnes, parmi elles de nombreuses blessées, ont été embarquées dans des bus et déplacées de force vers différentes régions du Maroc : comme Beni Mellal, Kelaa Sraghna, Chichaoua, Safi et Khouribga. Ce sont parfois près de 12 heures de route qui ont été effectuées, au cours desquelles de la nourriture n’a pas toujours été distribuée et au bout desquelles les personnes ont été débarquées sans aucune assistance.
Les autorités marocaines ont ensuite réquisitionné des bus stationnés à la gare routière de Nador pour poursuivre les opérations de déplacement, mobilisant 28 bus dont 3 pour des migrants sortis des urgences de Nador. « Les autorités qui étaient sur place, parfois sans avis médical, ont décidé de les sortir de l’hôpital et de les refouler vers la frontière algérienne », explique l’AMDH-Nador. L’association estime qu’au total, ce sont environ 1000 personnes, dont deux femmes, qui ont ainsi été déplacées depuis la frontière.
Pendant ces trajets forcés, au moins une personne a perdu la vie : un jeune soudanais originaire du Darfour nommé Abdenasser Mohamed Ahmed, mort dans la nuit du 24 au 25 juin, qui avait été embarqué grièvement blessé́. Il a été identifié grâce aux témoignages et photographies recueillies par l’AMDH-Nador. Mais d’autres cas de morts sont évoqués par les survivant·es du massacre que nous avons rencontré·es. Des morts seraient survenues dans d’autres bus et à la descente dans différentes villes, parfois plusieurs jours après, s’agissant à chaque fois de personnes ayant succombé aux blessures leurs ayant été infligées le 24 juin à la frontière.
Pendant ces trajets forcés, au moins une personne a perdu la vie : un jeune soudanais originaire du Darfour nommé Abdenasser Mohamed Ahmed, mort dans la nuit du 24 au 25 juin, qui avait été embarqué grièvement blessé́. Il a été identifié grâce aux témoignages et photographies recueillies par l’AMDH-Nador. Mais d’autres cas de morts sont évoqués par les survivant·es du massacre que nous avons rencontré·es. Des morts seraient survenues dans d’autres bus et à la descente dans différentes villes, parfois plusieurs jours après, s’agissant à chaque fois de personnes ayant succombé aux blessures leurs ayant été infligées le 24 juin à la frontière.
Abderrazik*, 17 ans, Soudanais, rescapé du 24 juin 2022.
Ils nous ont transportés dans des bus malgré toutes nos blessures. Ils nous ont transportés sans aucune aide médicale. Il y avait une personne avec nous dans le bus qui saignait beaucoup, trop même, et quand on nous a fait descendre, il est décédé. Certains sont même décédés deux jours après ce jour à Beni Mellal. Dans les hôpitaux, nous n’avons pas reçu les soins nécessaires.
Mokhtada*, 19 ans, Soudanais, demandeur d’asile, rescapé du 24 juin 2022
Le témoignage de Mokhtada indique non seulement la non prise en charge des blessés et des personnes dans des états graves sur place à Nador ou pendant les trajets en bus, mais soulève aussi la question de l’accès aux soins dans les villes d’arrivée, au bout des déplacements forcés.
Sans soins, ni toit, ni droits : les survivants dans les villes marocaines
Quand nous sommes arrivés à Safi, nous avons envoyé les personnes gravement blessées à l’hôpital. A l’hôpital, ils nous ont dit qu’ils ne peuvent pas accepter des personnes dans cet état. Nous leur avons répondu : ‘Mais ces gens sont dans un état grave, alors où allons-nous les emmener ? Voulez-vous qu’on les laisse mourir comme ça sur le bord de la route ?’ Après cela, un médecin s’est présenté et a accepté d’admettre les personnes à l’hôpital pour y être soignées. Je me souviens qu’il y avait trois personnes dans un état très grave.
Abderrazik*, 17 ans, Soudanais, demandeur d’asile rescapé du 24 juin 2022.
L’hôpital était près de la gare routière, et lorsque nous sommes allés les voir pour nous faire soigner, j’ai remarqué qu’ils nous traitaient comme s’ils étaient obligés de le faire. Cela signifie qu’ils n’ont pas effectué leur travail avec sincérité et respect. (…) Le traitement doit être humain, quelle que soit la personne, tabassée, blessée ou malade. L’essentiel est qu’elle a besoin de soins, indépendamment de sa couleur, de sa race, de sa religion ou de son affiliation à un parti particulier, et quelle que soit sa façon de penser. Elle doit être traitée en toute humanité et doit recevoir les soins nécessaires indépendamment de toute autre considération. Pour moi, aucun soin n’a été donné avec efficacité, sincérité ou humanité. Par exemple, si tu es blessé à la main, la plaie doit être nettoyée et stérilisée de la manière appropriée et après on couvre ta main. Dans l’hôpital de Safi, ils ont pansé les plaies sans les nettoyer ni les stériliser ou quoi que ce soit. Et puis ils nous ont demandé de partir… Il n’y avait aucun respect. Beaucoup de gens qui étaient là avec nous à l’hôpital, lorsqu’ils ont remarqué cette manière de traiter les Soudanais, ont préféré mourir plutôt que de recevoir un traitement de cette manière négligente. (…) De nombreux Soudanais ont refusé de se faire soigner. Ils ont même cherché l’église la plus proche à Safi, pensant qu’ils y trouveraient plus d’humanité, mais ils la trouvèrent fermée et restèrent sans soins.
Fathi Adel*, 25 ans, Soudanais, demandeur d’asile, rescapé du 24 juin 2022.
D’après l’AMDH-Nador, dans plusieurs cas, des blessés ont pu être transportés par leurs compatriotes ou à l’aide de citoyen·nes marocain·es vers les hôpitaux de Marrakech, Agadir, Beni Mellal, Safi, Casablanca et Rabat, pour recevoir des soins. De même, nos recherches documentent des cas d’accès aux hôpitaux facilités par des organisations humanitaires, mais également des cas de blessés graves restés sous surveillance policière accrue avant d’être abandonnés comme les autres, sans assistance.
Des blessés graves sous surveillance policière. Les cas de Mursal* et Adam*
Lors de l’enquête menée côté marocain, nous avons rencontré Mursal, Soudanais de 22 ans, demandeur d’asile enregistré auprès du HCR au Maroc et rescapé du 24 juin 2022. Pour comprendre son récit, il a fallu l’aide de son ami Abdenasser lui aussi rescapé du même massacre. Le 24 juin, Sami a reçu des tirs balles en caoutchouc de la part des forces marocaines lorsqu’il tentait d’escalader l’un des mur du de l’enceinte du poste-frontière. Sa mâchoire et ses dents ont été démolies et l’un de ses yeux a été touché. Mursal* a perdu conscience. Lorsqu’il s’est réveillé, il se trouvait dans une sorte de tranchée. Là, il est encore tabassé par un agent des forces marocaines. Il raconte :
Un soldat n’arrêtait pas de me frapper. J’ai entendu quelqu’un me dire : dégage. Je lui ai dit : ‘je ne peux pas sortir parce que je suis blessé’. Un autre soldat est venu et m’a sorti du trou. Il m’a jeté dans la cour et m’a dit : ‘meurs, tu n’aurais jamais dû venir ici’. Un autre militaire m’a donné de l’eau. Puis ils m’ont emmené à l’ambulance et je me suis retrouvé à l’hôpital.
Mursal est emmené à l’hôpital de Nador. Il a ensuite été sorti des urgences de Nador et transféré à l’hôpital d’Oujda, où il est resté trois jours, inconscient. À son réveil, il se rend compte qu’il est ligoté et qu’un homme en uniforme se trouve devant la porte de sa chambre. Il est embarqué dans une voiture des forces de l’ordre puis lâché sans assistance à 1km de la ville de Fès. L’un des agents est sorti de la voiture et s’est excusé indirectement auprès de Mursal,disant qu’ils ne font qu’exécuter des ordres et qu’ils n’ont pas le choix. C’est l’hiver, Mursal est très faible et a été sorti de l’hôpital très peu habillé. L’agent lui conseille d’aller vers la ville pour trouver des gens et des organismes de bienfaisance qui pourraient l’aider. Après quelques jours à Fès, Mursal se rend à Rabat avec l’aide de plusieurs compatriotes. Il est à nouveau amené à l’hôpital car son état est grave. Son œil et sa mâchoire ont dû être opérés comme l’extrait de document ci-dessous en atteste.
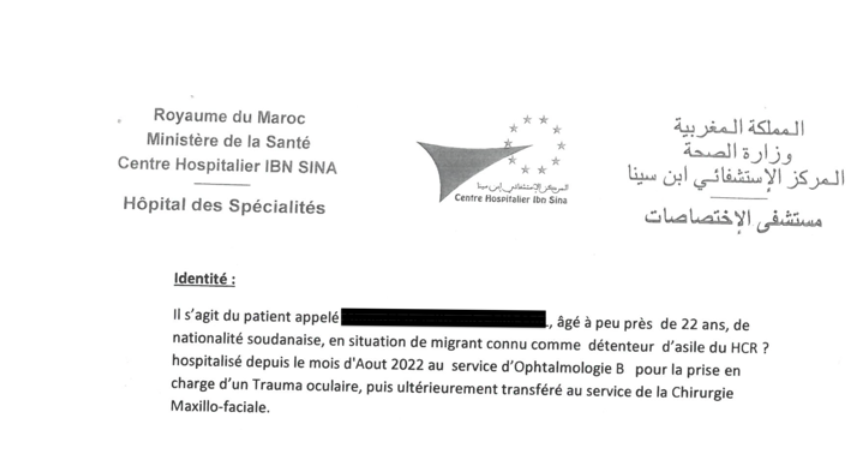
L’histoire de Mursal n’est pas isolée. Un autre survivant du 24 juin que nous avons rencontré, Adam*, Soudanais de 22 ans également, a lui aussi perdu l’un de ses yeux ce jour. Il ne se souvient pas de tous les détails en raison des coups qu’il a reçu au niveau de la tête, mais au moins de ceci :
J’étais au milieu de la foule dans le poste-frontière. Et lorsque la porte s’est ouverte, j’ai essayé d’entrer, mais on était trop serrés. Donc, je suis sorti de la foule. Il y avait beaucoup de caméras et un avion. Un soldat m’a frappé et j’ai saigné. Le premier coup était au dos et lorsque je me suis tourné, il m’a frappé la tête et l’œil.
Après cela, Adam tombe inconscient. Il se réveille dans un hôpital, à Oujda, et se rend compte qu’il a perdu l’un de ses yeux. Il souffre de douleurs intenses à la tête. Comme Mursal, Adam est embarqué dans une voiture par des agents des forces de l’ordre marocaines, et lâché sans assistance près de Fès. On lui dit alors qu’il a de la chance de ne pas être expulsé vers l’Algérie. Adam se rend au Croissant Rouge par ses propres moyens. Il est transféré à l’hôpital de Fès. C’est là que le personnel médical lui indique qu’en plus d’avoir perdu un œil, son front est fracturé. Pendant ses séjours à l’hôpital, Adam est suivi par une militante de l’AMDH qui reste en contact avec lui. Pendant deux mois, le jeune Soudanais n’a quasiment plus de mémoire, il la récupère très lentement par la suite. L’état de santé physique et psychique de Adam reste très dégradé. Il se rappelle du 24 juin 2022 comme d’un jour effrayant où il a vu des personnes être touchées par des bombes et d’autres armes. Quand nous le rencontrons en 2023, il n’a pas communiqué avec sa famille au Soudan par peur d’être jugé négativement, comme indigne, et afin de ne pas leur dire qu’il a perdu son œil et qu’il n’a pas pu atteindre l’Europe.
Comme le montrent les cas d’Adam et Mursal, la violence ne s’est pas arrêtée le 24 juin 2022. Elle continue à travers leurs traumatismes physiques et psychiques et les traitements inhumains que les autorités marocaines leur font subir. Certains, comme Mursal, ont même pensé parfois à se donner la mort. D’autres, ne cessent de penser à leur(s) frère(s) ou ami(s), dont ils ont vu le(s) corp(s) sans vie à la frontière. Comme le jeune Mohamed A., qui a témoigné dans les médias espagnols : “Mon frère est mort en sautant la barrière de Melilla”. Il en est sûr, car il l’a vu de ses propres yeux, quand les gendarmes marocains l’ont emmené sur l’esplanade qui jouxte la clôture où étaient entassés les corps inertes ou en souffrance de ceux qui n’ont pas réussi à entrer à Melilla. “Ils ne m’ont pas laissé approcher. J’ai demandé aux gendarmes s’il vous plaît, c’est mon frère, j‘ai crié, mais ils ne m’ont pas laissé bouger”, a raconté le garçon de 17 ans. Ce récit nous l’avons entendu de la bouche de nombreux autres survivants qui ont perdu un proche ce jour, sans pouvoir savoir ce qui est advenu ensuite de leur corps.
La violence a également continué post-mortem pour les personnes décédées sur place à Barrio Chino. Jusqu’à aujourd’hui, la question des corps des défunts continue d’être particulièrement opaque, constituant une grande source de souffrance pour les proches des morts et disparus.
Gestion opaque des cadavres et barrages à la recherche et à l’identification des morts et disparus
Des tentatives d’enterrement illégal
Deux jours après le massacre, le 26 juin 2024, l’AMDH-Nador lance une alerte sur les réseaux sociaux concernant des tentatives d’enterrement à la hâte en train d’être préparées par les autorités marocaines. L’association publie sur sa page Facebook des photographies montrant une présence inhabituelle d’agents d’autorité autour de tombes fraîchement creusées dans le cimetière de Sidi Salem à Nador, dans le carré réservé aux migrant·es.

Nos recherches et analyses d’images satellitaires confirment les révélations de l’AMDH-Nador sur les tombes creusées deux jours après le massacre, dans le carré dédié aux migrants du cimetière de Nador.
Une image satellitaire prise le 27 juin 2022, comparée avec une autre prise le 23 juin de la même année, prouve que des activités d’excavation ont été menées dans une zone du cimetière de Sidi Salem. Cette zone a pu être clairement identifiée dans une image satellitaire prise le 29 juin, où environ 227 mètres carrés de sols ont été perturbés.

Nous avons ensuite comparé le site identifié à des zones similaires où des tombes individuelles étaient visibles. Ce procédé a permis d’estimer le nombre de tombes qui pourraient être creusées dans la zone où la terre a été perturbée.

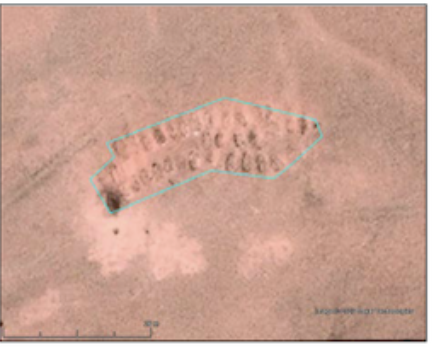
Le sol perturbé dans le cimetière de Sidi Salem (photographie de gauche), a été comparé à un autre site d’enterrement de tombes anonymes dans le même cimetière (photographie de droite) où 33 tombes ont été creusées dans une zone de 420 mètres carrés. Sur cette base comparative, nous pouvons estimer qu’entre 17 et 18 tombes pourraient tenir dans l’espace de 227 mètres carrés.


La localisation exacte du site a été vérifiée en faisant correspondre le paysage vu dans la photographie prise par l’AMDH-Nador des tombes en train d’être creusées publiée le 26 juin 2022. Le site correspond précisément à la zone encerclée sur l’image satellite.
C’est très certainement la publication des photos du cimetière sur les réseaux sociaux et les retombées médiatiques qui s’en sont suivies qui ont enjoint les autorités à cesser ces ouvrages clandestins. Dans les jours suivant, plusieurs journalistes espagnols ont été empêchés d’accéder au cimetière en question. D’après les recherches menées par l’AMDH-Nador, des ordres oraux de préparer 21 tombes auraient été donnés au responsable municipal du cimetière par le Gouverneur et le Pacha de Nador. L’association pointe que c’est pourtant le Procureur général qui constitue la seule administration compétente pour ordonner de tels enterrements. Elle pointe en outre que le parquet n’a été informé des décès et de l’existence de cadavres placés à la morgue de Nador que six jours après les faits, et par ses propres moyens. L’AMDH-Nador dénonce un « accaparement » du dossier du 24 juin 2022 par les services du ministère de l’Intérieur jusqu’à aujourd’hui :
Tous les acteurs administratifs liés à ce massacre (santé, protection civile, Croissant Rouge, responsables de la morgue et du cimetière…) nous ont confirmé́ recevoir des instructions verbales du Gouverneur de Nador de ne rien communiquer sur ce sujet lors de réunions tenues spécialement sur ce sujet. C’est là un exemple de gestion occulte ou du moins non habituelle qui montre que le premier souci des autorités était et demeure un désir de ne jamais établir toutes les vérités sur ce qui s’est passé réellement.
Après les publications de l’AMDH-Nador sur les réseaux sociaux à la fin juin 2022, aucune communication officielle n’a été faite sur le sujet. Dans leur courrier de réponse à la missive onusienne conjointe AL MAR 2/2022, les autorités réfutent l’authenticité des allégations de tentatives d’enterrement de défunts du 24 juin, dénuées selon elles de tout fondement, arguant que les tombes en question auraient été creusées dans le cadre habituel de l’activité quotidienne de ce cimetière.
Une morgue saturée de corps rendue inaccessible aux familles des disparus
Le samedi 25 juin vers 12h05, AMDH Nador a effectué une visite surprise à la morgue de Nador située à l’hôpital Hassani. Les deux portes qui étaient ouvertes pour aérer le milieu où régnait les odeurs de la mort, nous ont permis de constater l’ampleur du drame avec presque 15 cadavres de migrants jetés à terre portant des blessures apparentes à la tête, au visage, à la poitrine et aux pieds gisant dans du sang fraichement coagulé. Les trois paillasses qui ramenaient les cadavres des ambulances étaient encore tapissées de taches de sang des migrants. Il ne s’agit que des cadavres qui étaient jetés à terre dans une scène cruelle et inhumaine qui frappe la dignité humaine, sans parler des cadavres qui étaient peut-être déjà mis à l’intérieur des frigos par les deux agents de la morgue qui étaient en train de ranger les cadavres dans ces frigos. Dès que notre présence a été remarquée les deux portes de la morgue ont été fermées avant de nous demander de quitter les lieux.
Extrait du rapport de l’AMDH-Nador
L’AMDH-Nador est le seul membre de la société civile à avoir pu pénétrer dans la morgue de Nador après le massacre. L’étau de surveillance s’est immédiatement resserré après cette visite. Après quelques tentatives accompagnées par des membres de l’AMDH-Nador, notre équipe de recherche n’a pu y accéder ni parler avec les responsables de cette installation. Plus grave, ce sont aussi les membres de familles de personnes portées disparues après le 24 juin, qui se sont vues refuser l’accès et ainsi leurs possibilités d’identification de leur proche. C’est ce qui est arrivé au frère du disparu Ahmad Babakr Mohammed, venu depuis le Sultanat d’Oman pour tenter de le retrouver.
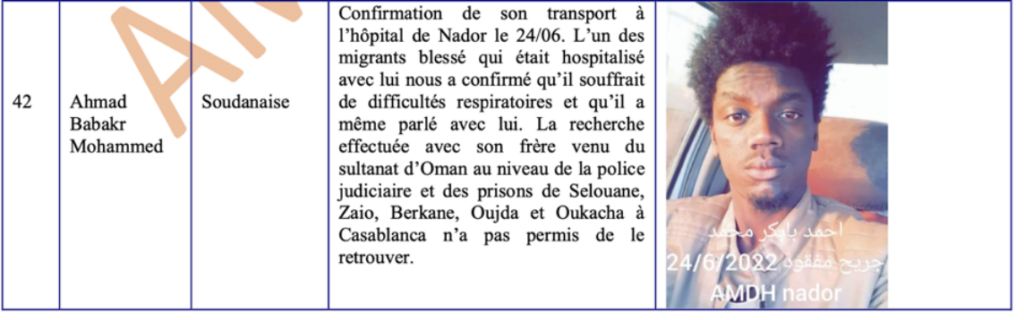
Muhammad, frère du disparu Ahmad Babakr Mohammed, a été accueilli et accompagné tout au long de son séjour par l’AMDH-Nador. L’un de nos enquêteurs a pu le rencontrer également. Muhammad a visité l’ambassade de la République du Soudan à Rabat où des responsables lui ont montré 23 photos des personnes décédées officiellement déclarées par les autorités marocaines. Puisque Muhammad n’a pas trouvé son frère parmi ces photos, il est parti avec le président de l’AMDH-Nador pour se rendre à la cour d’appel de Nador, espérant, cette fois-ci, obtenir les informations souhaitées concernant son frère. Là-bas, il réussit à obtenir une autorisation du procureur général de la cour de voir les cadavres auprès de la police judiciaire à Nador. Mais son rendez-vous à la police judiciaire tourne mal : Muhammad relate que les agents qu’il rencontre refusent d’accéder à sa demande, malgré l’autorisation du procureur. On lui propose uniquement de voir les photographies qu’il a déjà vues. Muhammad souligne le changement brusque de comportement d’un des agents de la police judiciaire, qui se montra alors hostile et menaçant, lorsqu’il souligne son droit à voir les cadavres à la morgue. C’est in fine un refus catégorique qui est opposé à Muhammad. On lui intime de partir.
Après cette entrave illégale à ses démarches d’identification, Muhammad continue sa route pour chercher son frère au niveau de différentes prisons de la région orientale, puis à Rabat et Casablanca, mais en vain. Ahmad Babakr Mohammed reste porté disparu jusqu’à aujourd’hui malgré les efforts de son frère et de l’AMDH-Nador pour le retrouver.
D’autres familles ont été empêchées de la même façon que Muhammad de visiter la morgue au niveau de l’hôpital de Nador pour pouvoir, peut-être, identifier leurs morts.
Malgré les instructions écrites du Procureur général de permettre aux familles de visualiser les cadavres à la morgue, la directrice de l’hôpital Hassani et la police judiciaire de Nador ont refusé d’appliquer ses instructions. Devant ce refus illégal et injustifié, la directrice de l’hôpital nous a déclaré que des instructions directes du Gouverneur de Nador sont derrière cette interdiction.
AMDH-Nador
Selon l’AMDH-Nador, les cadavres des personnes mortes à Barrio Chino le 24 juin 2022 ont été directement transportés du poste-frontière vers la morgue ou bien des urgences de l’hôpital Hassani vers la morgue, sous instructions directes de la police judiciaire dans le premier cas et de la directrice de l’hôpital dans le second, sans inscription aucune de ces morts sur le registre habituel des décès que tient l’administration de l’hôpital.
Près d’un an plus tard, l’opacité autour de la gestion des cadavres du 24 juin 2022 demeure. Fin mai 2023, des membres de l’AMDH-Nador ainsi que l’un de nos enquêteurs se sont rendus à l’hôpital de Nador. Le responsable de la morgue a refusé de communiquer le nombre exact de morts. En revanche, la morgue est alors décrite comme saturée de corps, depuis des mois. Cela indique alors que les corps des défunts du 24 juin 2022 sont encore dans la morgue, mais entassés voire empilés, reproduisant ici encore la violence symbolique du charnier.
Nos recherches menées côté marocain indiquent par ailleurs que des cadavres issus des évènements du 24 juin 2022 auraient été déposés à la morgue d’Oujda, faute de place dans celle de Nador. Cependant, comme au niveau de Nador, notre équipe d’enquête a été empêchée d’accéder à la morgue d’Oujda, et nous ne pouvons ainsi pas confirmer ce déplacement de cadavres.
La rétention d’information et l’entrave volontaire aux processus d’identification opérées par les autorités marocaines et espagnoles continue jusqu’à ce jour d’empêcher l’établissement de l’identité des morts et des disparus, et rend impossible le deuil pour nombre de familles. Par ailleurs, cette opacité qui entoure les morts du 24 juin ne permet pas de connaître de manière certaine le nombre de morts lors du massacre.
Des militant·es qui comptent les morts face à des États qui continuent de les cacher
Combien de personnes sont-elles mortes le 24 juin 2022 à la frontière ? Près de deux ans plus tard, il reste impossible de répondre avec certitude à cette question. Face au silence et à l’opacité des autorités marocaines, l’AMDH-Nador ainsi que Caminando Fronteras mènent, depuis le 24 juin 2022, en lien permanent avec les survivants et les familles des morts et disparus, un travail d’identification. Les données de l’AMDH-Nador, qui évoluent en fonction des informations transmissent par les survivants et les familles, restent ainsi les plus fiables quant aux nombres de morts et disparus.
Le soir du 24 juin 2022, l’AMDH Nador annonçait, sur la base de sources hospitalières, que 27 dépouilles de migrants avaient été ramenées à la morgue de l’hôpital Hassani, contredisant ainsi la version des autorités marocaines. Les autorités marocaines parlèrent elles de cinq morts, puis 18, avant de se rétracter et de fixer le nombre officiel de décès à 23.
C’est sur la base de son propre travail d’investigation mené depuis le 24 juin 2022, que l’organisation a pu récolter de nombreux témoignages et photographies auprès des survivants d’une part et des familles de disparus d’autre part. C’est ainsi que l’AMDH-Nador a pu commencer à établir des listes de morts et disparus, qu’elle tente constamment de mettre à jour. Nous reproduisons ici la dernière liste actualisée des morts.
Au 10 avril 2023, l’AMDH-Nador a fourni cette liste de personnes décédées le 24 juin 2022 :
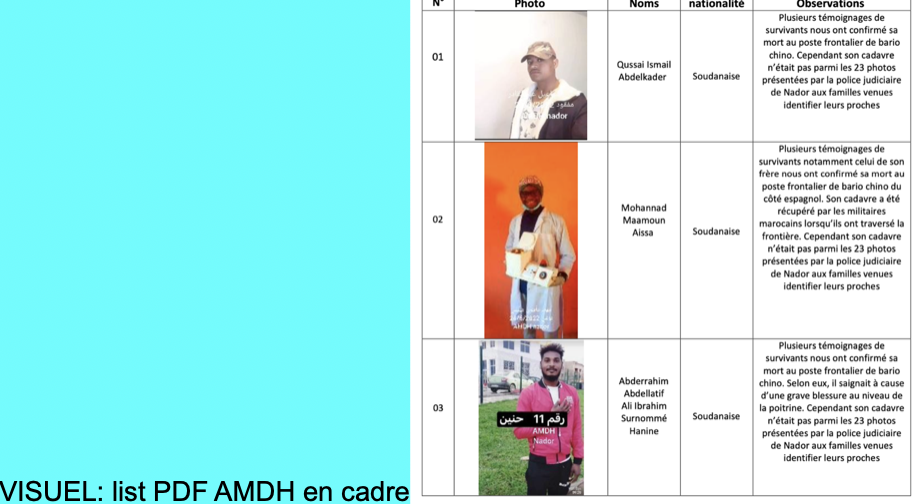
L’association révèle également des irrégularités quant aux moments de visualisation des photographies des cadavres par les familles au siège de la police judiciaire : 25 photos sont montrées à certaines familles contre seulement 23 pour les autres. En outre l’association souligne que sur la totalité des photographies données à voir par la police judiciaire, ne figurent pas celles de 4 personnes identifiées comme mortes soit dans les vidéos publiées par l’AMDH Nador soit par les témoignages de rescapés du massacre eux-mêmes, ni celle du jeune Soudanais décédé dans l’un des bus de déplacement forcé. Il s’agit des cinq personnes suivantes :
- “Abdenasser Mohamed Ahmed, embarqué dans l’un des bus alors qu’il était dans un état très grave d’après les témoignages de personnes qui se trouvaient avec lui dans le bus. La mort a été confirmée à l’AMDH-Nador par le chauffeur et le propriétaire du bus en question.
- Abdelaaziz Yaakoub Daoud surnommé Anwar, visible sur une séquence vidéo publiée par l’AMDH-Nador, dans laquelle on peut voir et entendre un militaire marocain s’assurer de sa mort.
- Abderrahim Abdellatif Ali Ibrahim surnommé Hanine, dont plusieurs témoignages de survivants récoltés par l’AMDH-Nador et notre équipe ont confirmé la mort au poste frontalier de Barrio Chino. Selon eux, il saignait à cause d’une grave blessure au niveau de la poitrine.
- Mohannad Maamoun Aissa, pour qui de nombreux témoignages de survivants récoltés par l’AMDH-Nador et notre équipe, notamment celui de son frère, nous ont confirmé la mort du côté du poste-frontière de Barrio Chino sous contrôle espagnol. Son cadavre a été récupéré par les militaires marocains lorsqu’ils ont traversé la frontière.
- Qussai Ismail Abdelkader, dont plusieurs témoignages de survivants ont confirmé la mort au poste-frontière de Barrio Chino.”
Les associations et familles des personnes défuntes restent sans aucune nouvelle quant aux dépouilles de ces cinq personnes. Seule une famille a pu identifier son enfant sur la base des photos montrées à la police judiciaire à Nador, après une longue procédure et soutenue par l’AMDH-Nador. Ainsi, le 31 mars 2023, Adam Bikhit a pu être enterré au cimetière Sidi Salem de Nador en présence de deux membres de sa famille venus d’Angleterre, de militants de l’AMDH et d’individuels locaux solidaires. Pour réclamer que lumière soit faite sur le drame du 24 juin et connaître le sort de leurs enfants disparus des familles de victimes se sont constituées en association, depuis le Soudan, en mars 2022.

publiée l’AMDH Nador le 10 mars 2023
Source : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590643499768034&set=pb.100064671673167.-2207520000&type=3
Ainsi de par la gestion opaque des corps des personnes décédées et les barrages multiples à leur identification, jusqu’à ce jour le nombre et l’identité des morts n’a pas pu être établi de manière définitive. Par ailleurs, au moins 70 personnes restent portées disparues depuis le 24 juin 2022 jusqu’à aujourd’hui.
70 personnes toujours portées disparues
Dès le lendemain du massacre, l’AMDH-Nador a commencé à investiguer auprès des personnes éloignées de la frontière. Par la suite, l’association a également tenté de trouver des informations auprès des personnes sorties des différentes prisons de la région ou de celles sorties des hôpitaux des environs. Après plus d’un an de travail méticuleux de recoupement d’informations, c’est une liste provisoire de 70 personnes encore portées disparues qui a été publiée en juin 2023 :
METTRE EN LIGNE LISTE DES 70 DISPARUS DE L’AMDH-NADOR
Si l’on additionne les listes existantes des personnes mortes le 24 juin 2022 et celles qui demeurent portées disparues, on comprend qu’il est possible que le nombre de personnes qui ont perdu la vie le 24 juin 2022 s’élèvent à 107, bien au-delà des 23 morts reconnus par les autorités marocaines. Ni les autorités marocaines et espagnoles, ni les ambassades des pays d’origine des personnes concernées n’ont aidé aux démarches de recherche des disparus.
De la complicité des ambassades africaines au Maroc dans le maintien de l’impunité
Au lieu d’aidé leurs concitoyens dans leurs démarches de recherche des disparus, ou condamné le Maroc pour la violence que les forces de l’ordre on exercées, à la suite de pression les ambassadeurs d’états africains au Maroc se sont solidarisés avec les autorités marocaines.
En effet, deux jours après le massacre, les ambassadeurs d’états africains ont été invités au siège du ministère des affaires étrangères. A cette occasion, les autorités marocaines ont donné à voir leur version des faits, vidéos à l’appui, pour démentir – est-il expliqué dans des médias proches du gouvernement – la ”version mensongère” diffusée sur les réseaux sociaux. À l’issu de cette session dite d’information, les diplomates auraient condamné la violente tentative de passage des migrants et se seraient déclarés solidaires du Maroc, condamnant toute tentative de nuire à l’image du Royaume, et auraient salué la politique migratoire marocaine.
Durant notre enquête en 2023, nous avons recueilli le témoignage de Jean Constant Zéré, ressortissant ivoirien installé de longue date au Maroc. C’est en France que nous l’avons rencontré, en situation de demandeur d’asile. Pour cause, cet ancien travailleur de l’organisation Caritas Maroc (programme migrants), a été forcé de fuir le Royaume marocain. Quelques mois après le massacre du 24 juin 2022, il est directement menacé par les autorités marocaines ainsi que les autorités consulaires ivoiriennes pour ses déclarations sur le massacre du 24 juin 2022 comme « cabale organisée », c’est-à-dire comme évènement prémédité par les autorités marocaines. « Ne t’occupe pas des affaires du Maroc » lui est-il intimé depuis l’ambassade ivoirienne. Les menaces ne cessant pas, craignant pour sa vie, Jean Constant Zéré a fui.
Des procès inéquitables, des sanctions collectives et des emprisonnements sans preuve de survivants du massacre
Au lieu de faire la lumière sur les responsables du massacre du 24 juin et d’identifier les morts et les disparus, ce sont des survivants du massacre eux-mêmes qui ont été poursuivis en justice et enfermé dans des prisons marocaines pour des dizaines d’entre eux.
Les survivants, qui ont en grande partie subi l’acharnement des coups des forces de l’ordre espagnoles et marocaines, ont aussi été la cible d’un véritable acharnement judiciaire, comme l’ont constaté et documenté des associations, avocats et journalistes qui ont suivi les dossiers de dizaines de survivants du 24 juin 2022 poursuivis par la suite à Nador. Notre équipe de recherche a échangé avec plusieurs de ces acteurs de la société civile pour tenter de comprendre l’ampleur de cette dimension de la répression.
Le jour-même du massacre, parmi les personnes arrêtées au poste-frontière de Barrio Chino, certaines sont embarquées par les forces de l’ordre et placées directement en garde à vue. Ces personnes sont visées par une enquête préliminaire de la police judiciaire et sont alors maintenues d’abord au commissariat. A la suite d’une décision du procureur, elles sont placées en détention préventive à la prison de Nador. Plusieurs organisations et journalistes se sont alors mobilisés pour observer les procès tout en mobilisant, pour certaines d’entre elles, des avocats pour assister des groupes d’accusés.

Source : https://enass.ma/2022/08/16/drame-de-nador-melilla-un-acharnement-judiciaire-contre-les-refugies/
Pendant les procès, la majorité des personnes accusées est de nationalité soudanaise et nombre d’entre elles sont demandeuses d’asile, parfois même déjà enregistrées auprès du HCR au Maroc.
Les présumées victimes, elles, sont toutes des membres des forces de l’ordre et des agents des autorités marocaines. D’abord présentes en nombre aux procès, leur effectif a diminué au fil des mois, puisque leurs frais de déplacements à Nador et de procédure n’étaient pas pris en charge par leurs institutions.
Des observateurs des procès qui se sont tenus à la cour d’appel et au tribunal de première instance de Nador entre juillet et octobre 2022 ont dénoncé des audiences organisées très rapidement et de manière expéditive, un traitement collectif des dossiers et un manque flagrant de preuves pour fonder les accusations et les peines octroyées. En somme ce sont des chroniques de procès dont le fondement même d’équité a été bafoué.
Les chefs d’inculpation des personnes migrantes sont principalement en lien avec des articles du code pénal marocain et la loi 02.03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulière . Parmi les plus fréquemment imputés pendant les procès peuvent être cités les chefs d’inculpation suivants :
- Participation à une association de malfaiteurs
- Délit d’organisation et de facilitation de la sortie irrégulière de personnes du territoire marocain
- Délits d’entrée et de séjour irréguliers sur le territoire marocain
- Outrage à l’encontre d’agents d’autorité publique
- Coups et blessures avec usage d’armes, possession d’armes dans des circonstances qui menacent la sécurité des personnes, l’ordre public
- Violences et actes de rébellion commis par plusieurs personnes
- Destruction de biens publics
- Attroupements armés
Si les deux premiers chefs d’accusation mentionnés ont souvent été requalifiés par le juge en “délit d’adhésion à une entente visant à faciliter la sortie de personnes du territoire national”, les autres chefs ont généralement été retenus et les personnes ont été sanctionnées de plusieurs mois de prison en première instance. Les peines ont systématiquement été alourdies après le passage des dossiers à la cour d’appel, passant par exemple de 8 mois à 3 années de prison ferme, assorties à des amendes.
Visuel ? Carte Lieux d’emprisonnement, et nombre connu de personnes emprisonées pour chaque lieu ? (il faudrait liste des lieux d’emprisonnement)

Source : https://enass.ma/2022/09/27/la-main-lourde-de-la-justice-contre-les-refugies-a-nador/
Des avocats et associations considèrent pourtant que ces peines très lourdes ne reposent sur aucune preuve. En effet, lors des procès, aucun lien direct entre les agents – victimes présumées – et les migrants arrêtés le 24 juin 2022 – accusés présumés présents – n’a été établi. Les agents n’ont pas déclaré avoir reconnu directement les personnes accusées présentes dans le tribunal. À chaque procès, le juge a eu un recours exclusif aux procès-verbaux de la police judiciaire comme moyens de preuve. Pourtant, les personnes accusées ont nié devant le juge toutes les charges retenues contre elles, pointant que les propos cités dans les procès-verbaux n’étaient pas les leurs, et ne correspondaient pas à la vérité. Seules des charges concernant les entrées irrégulières sur le territoire marocain ont été admises par les accusés.
Une autre observation d’importance révélant l’aberrance de ces procès tient au fait que les accusés avaient des traces visibles de violences sur leurs visages, leurs corps, et certains présentaient des difficultés à marcher. Tandis que les victimes présumées, c’est à dire des agents des forces de l’ordre et d’autorité marocaines, semblaient physiquement bien-portantes. Pourtant, ces victimes ont toutes alors produit des certificats médicaux attestant de diverses blessures et traumatismes. Les personnes poursuivies, elles, n’ont pas eu accès à des examens médicaux, malgré une procédure pénale qui le prévoit.
Ensuite, les observateurs des procès ont également dénoncé le caractère collectif du traitement des accusés qui ne permet ni de prouver de responsabilité pénale ni civile. Malgré le principe de l’individualisation de la peine et du crime, les personnes ont été inculpées, jugées, et condamnées en groupes de plus de 10 personnes. Les personnes arrêtées le 24 juin 2022 au niveau de la frontière ont été assimilées à des criminels, sur la base de récits répétés à l’identique, par les parties civiles, pour qualifier les faits de dizaines de personnes accusées.
C’est ainsi le principe même du droit à un procès équitable qui a été bafoué. Les garanties des procédures n’ont pas été respectées et les liens de causalité entre les crimes imputés et les accusés n’ont pas été établis, faute de preuves.
Finalement, les observateurs des procès ont aussi soulevé la question des personnes accusées d’entrée irrégulière malgré leur statut de demandeurs d’asile, en violation des engagements du Maroc dans la Convention de Genève.
S’il a été estimé à au moins une centaine par des associations qui ont suivi une partie des procès, jusqu’à aujourd’hui, les informations sur le nombre total de personnes inculpées puis emprisonnées à la suite des évènements du 24 juin 2022 ainsi que tous les lieux où elles sont détenues restent flous.
Les autorités marocaines limitent l’accès aux informations sur les prisonniers, ne permettant pas, là encore, aux proches, familles et à leurs soutiens d’avancer dans l’identification des morts et disparus.
CONCLUSION. LA QUÊTE DE JUSTICE

Le lundi 27 juin 2022, trois jours après le massacre, des dizaines de survivants du massacre se sont rassemblées devant le Centre de séjour temporaire pour immigrants (CETI) de Melilla pour exiger une enquête sur les événements qui se sont produits à la barrière de Melilla.
À travers un manifeste et des pancartes, les survivants arrivés à Melilla dénoncent alors le Maroc et l’Espagne comme partenaires dans le massacre qui a été commis contre de jeunes Africains Noirs.

Les pancartes, rédigées en arabe, en anglais, en espagnol et fen rançais s’adressent au monde entier, mais aussi directement aux responsables politiques. Comme l’une d’entre elle, dirigée au président du gouvernement espagnol pour ses déclarations sur l’intervention du Maroc : « Pedro Sánchez, on dirait que tu apprécies de voir les corps des migrants empilés à la barrière et ton pays faisant semblant d’être respectueux des droits humains ».
Une autre pancarte questionne : « les Ukrainiens reçoivent des roses, pourquoi nous les Noirs on nous envoie en enfer ? ».

Le 29 juin, une nouvelle manifestation est organisée à Melilla. Un olivier a été planté en mémoire des victimes et les demandeurs d’asile se sont allongés sur le sol pour reconstituer la scène du massacre. L’un d’entre eux a pris le micro et a déclaré : « Essayez de dire “asile” quand vous êtes au milieu d’une nuée de tirs et de gaz… ». D’autres manifestations ont lieu sur la péninsule espagnole, en particulier à la suite d’appels des organisations de personnes Noires et afro-descendantes du mouvement antiraciste, ainsi que des associations de défense des droits humains.

Melilla avec les survivants du massacre. Photographie : C. Marmié.
Près de deux ans après le massacre du 24 juin 2022, l’impunité reste totale, et avec elle, la souffrance des rescapés et des familles des victimes.
En Espagne comme au Maroc, loi du silence, rétention d’information et hypocrisie d’État
Depuis le 24 juin 2022, les autorités marocaines n’ont fourni aucun effort pour rapatrier les dépouilles des victimes et au moins 22 corps se trouvent encore dans la morgue de Nador. Les autorités espagnoles et marocaines n’ont pas fourni de liste complète des noms des victimes et des causes de leur décès, ni communiqué d’images enregistrées par les caméras de surveillance qui pourraient contribuer à une enquête. De plus, elles n’ont pas enquêté comme il se doit sur les agissements qui constituent des crimes de droit international et des violations des droits humains, ni sur le racisme et la discrimination à la frontière.
Les autorités espagnoles ont refusé d’ouvrir une enquête indépendante et, en décembre 2022, le parquet a abandonné son enquête sur ces décès en affirmant n’avoir trouvé aucun élément laissant penser que les forces de sécurité espagnoles pourraient avoir commis des agissements répréhensibles. Les forces de l’ordre impliquées dans l’opération du 24 juin 2024 ont été muselées par « un ordre du silence imposé depuis lors par le Ministère de l’Intérieur ».
Les autorités marocaines n’ont diligenté aucune enquête sur le recours à la force par leurs agents à la frontière et ont rendu les recherches des ONG et des familles des personnes mortes et disparues pratiquement impossibles. Les courriers adressés par l’AMDH-Nador, Amnesty International et d’autres organisations aux gouvernements du Maroc et de l’Espagne pour leur demander de partager des informations sont restés sans réponse jusqu’à présent. Pire, les initiatives indépendantes d’enquête n’ont cessé d’être entravées de part et d’autre de la frontière.
Entretemps, si les tentatives de passage aux barrières de Melilla ont presque cessé, du côté de Ceuta, les autorités espagnoles ont continué de se livrer à des pratiques illégales aux frontières, notamment des expulsions collectives – occasionnant souvent un recours excessif à la force. Du côté marocain de la frontière, et dans le cadre de la coopération entre les deux pays, les autorités marocaines continuent d’empêcher des personnes migrantes Noires d’accéder au territoire espagnol pour demander l’asile au poste-frontière.
Les rescapés du massacre restés côté marocain, comme ceux parvenus à entrer sur le sol européen, continuent de demander vérité et justice.
Timeline Heading 1
This is timeline description. Please click here to change this description.
Timeline Heading 2
This is timeline description. Please click here to change this description.
Timeline Heading 3
This is timeline description. Please click here to change this description.
Timeline Heading 4
This is timeline description. Please click here to change this description.
Timeline Heading 5
This is timeline description. Please click here to change this description.